
Que peut-on dire sur Dieu ? (Exode 3:2-15 ; Exode 20:1-4 ; 2 Rois 18:3-5 ; Actes 9:1-8)
Vidéo :
Enregistrement audio de la prédication / Enregistrement du culte entier
(Voir le texte biblique ci-dessous)
prédication (message biblique donné au cours du culte)
à Genève le dimanche 27 mars 2022,
par : pasteur Marc Pernot

Peut-on dire que Dieu serait masculin, ou féminin, ou neutre ? Grands débats dans la presse. Certains disent que cette question est essentielle, d’autres que ce n’est pas un bon sujet, ou que ce n’est pas le moment. Serait-ce inutile de faire de la théologie en période troublée ? Oui et non. La vie biologique a des besoins qui sont souvent d’une grande urgence, c’est vrai, et il est alors temps d’agir plus que de discuter du sexe des anges. D’un autre côté, l’ambiance de ces temps appelle à une autre urgence : notre humanité semble avoir besoin de reprendre pied, comment trouver un socle solide, un nouveau souffle, une visée et un élan ? En faisant de la théologie, qu’elle soit une recherche discutée au cours des repas et des promenades en famille, entre amis.
Seulement, comme tout outil puissant, la théologie peut faire vivre, elle peut aussi être source de peines. A cette occasion je vous propose de regarder comment la Bible nous propose de bien « travailler Dieu ».
o0o
Que peut-on dire sur Dieu ?
La Bible n’en donne aucune représentation, elle s’y refuse explicitement, elle ne développe aucun enseignement sur l’être même de Dieu, juste une brassée de récits assez dépaysants où Dieu reste comme caché dans un buisson, dans une lumière ou une épaisse colonne de fumée. Ce que la Bible montre de Dieu dans ces récits ce sont des impulsions qu’il apporte dans la vie d’une personne.
Abraham se met en route vers une fécondité impensable. Isaac se met à recreuser les sources anciennes qui s’étaient ensablées. Jacob se lance dans une lutte corps à corps pour arracher la bénédiction. Moïse prend en main la libération de son peuple… Chacun a sa propre expérience de Dieu, et pourtant Moïse fait le lien entre « son » Dieu avec le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob… comme s’il y avait autant de « Dieu » que de personnes, car même si c’est le Dieu unique, l’impulsion qu’ont reçue chaque personnage a été particulière. Difficile de mettre ce Dieu si multiple en fiche, si ce n’est qu’à chaque fois c’est le supplément de vie qu’il fallait que chacun a reçu.
Au delà de ce qui est particulier, ce qui est commun c’est le fait d’avoir vécu d’une certaine façon une impulsion de vie à nulle autre comparable. Avec toujours ce Dieu dont la Bible refuse de donner une représentation. Pourquoi ? Parce que cela n’est pas possible. Dieu n’est pas un être parmi tant d’autres, il n’est même pas un être qui serait infiniment grand, beau, fort et tout ce que l’on peut rêver. Dieu est d’un autre ordre. Dieu est pour nous comme une impulsion. Une impulsion qui s’offre, se propose, se négocie volontiers, qui s’adapte, comme nous le voyons dans cette expérience de Moïse et dans bien d’autres récits de la Bible.
La variété même de ces impulsions de Dieu montre « qu’avec Dieu il faut s’attendre à tout » comme Marie, la mère de Jésus, en prend conscience (Luc 1:37).
L’impulsion donnée à Moïse
Moïse se promenait tranquillement avec les moutons de son beau père. Pour lui, l’impulsion de Dieu passe par un titillement de curiosité scientifique devant un buisson qui brûle sans brûler, c’est qui amène d’abord Moïse à un léger changement de trajectoire. C’est ensuite un « Moïse, Moïse » le redoublement évoquant un appel tout à fait profond et personnel auquel Moïse répond « me voici » : cet appel fait écho en moi, m’active. Et tout de suite cette conscience que même si Dieu le rejoint maintenant d’une façon si intime, une distance est à respecter : la distance infinie entre la vie et le principe de la vie, entre le transcendant et l’immanent, disent les philosophes. C’est d’autant plus utile à rappeler que Dieu se fait proche, intimement proche.
Dieu, alors, travaille avec Moïse, main dans la main, à former le Moïse libérateur de son peuple. Le sujet devient très très délicat quand Moïse demande à Dieu son nom, ce qui est une demande de savoir sur Dieu. Dieu se présente alors sous le nom de YHWH, étrange forme mêlant les conjugaisons du verbe être à tous les temps possibles. Nahmanide, philosophe juif du XIIIe siècle traduit ce nom de YHWH par « le faisant être », ce qui fait qu’il y a quelque chose plutôt que rien, ou que le chaos. Dieu est impulsion « de vie, de mouvement et d’être » dit aussi l’apôtre Paul (Actes 17:28). Nous connaissons cet effet, mais de Dieu : mieux vaut se taire que de dire ce que nul mot ne peut dire (2Cor 12:4).
Dieu donne alors à Moïse un signe permettant de vérifier si une impulsion vient de lui, Dieu, et pas d’une de ces multiples voix qui s’expriment en nous et autour de nous. Le signe que c’est Dieu qui nous appelle : c’est que la vie augmente.
Une fois reconnu cela, Dieu donne aux hébreux la mission de « servir Dieu », ce qui est l’inverse d’un asservissement puisque cela consiste à soi-même chercher à faire vivre et affranchir les autres. Cet appel à « servir Dieu » se traduit aussi par « travailler Dieu », travailler la question de Dieu, élargir encore leur écoute de ce qui pourrait survenir comme impulsion nouvelle et encore une fois inouïe venant de Dieu. Cela se fait dans la mémoire de leur propre expérience et aussi dans la mémoire de ce que Dieu a apporté à leurs pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. C’est un travail de mémoire personnelle et familiale. C’est un travail biblique aussi.
C’est bien un travail, car les multiples histoires bibliques nous apportent un grand dépaysement à travers quatre milliers d’années d’histoire et de culture, de prière et de débats incessants. Bien des figures de Dieu, bien des textes nous choquent et nous étonnent. La facilité serait de remplacer la Bible par de jolis poèmes sur l’amour et le printemps, ce ne serait pas « travailler Dieu », ce ne serait pas monter sur les épaules des générations précédentes, ce serait choisir la trajectoire de la feuille morte emportée par les tourbillons du vent. Mieux vaut apprendre à lire les livres que de brûler les livres. Mieux vaut travailler l’histoire que de déboulonner les statues. Mieux vaut apprendre à lire la Bible, la question n’est pas d’être d’accord avec tout dans ce foisonnement de témoignages personnels sur Dieu et de ce qui fait vivre. Y voir non pas une leçon, mais des témoignages et la diversité des impulsions que Dieu peut apporter. Se préparer soi-même pour l’appel inouï qui nous correspondra, pour une vie augmentée, forcément, venant de Dieu.
La représentation ferme à l’action de Dieu
Le décalogue de Moïse rappelle que Dieu est source de vie, et il ajoute immédiatement qu’il est interdit de s’en faire une représentation. C’est pour tous les temps que nous devons tenir les deux : attendre Dieu comme une nouvelle impulsion de vie, et renoncer à vouloir l’enfermer dans une représentation. Car de tout temps aussi, la société demande une représentation de Dieu qu’il puisse adorer ou haïr, au moins quelque chose que l’on puisse saisir, maîtriser. C’est ce que demandent les Hébreux à Aaron, le frère de Moïse : « Allons ! fais-nous un dieu qui marche devant nous » se forger des veaux d’or est de tout temps.
La représentation source de conflits
Nous voyons avec Paul ce que donne le fait de se donner une représentation de Dieu, aussi affinée soit-elle. Paul pense travailler pour Dieu en luttant contre ceux qui ne disent pas Dieu comme lui. Choc de représentations de Dieu. Mais sans doute : Paul n’avait pas finit d’attendre Dieu malgré sa course, il entend que Dieu l’appelle, lui, par son nom redoublé. Paul en tombe à la renverse. La suite est significative : que lui arrive-t-il ? « Saul est relevé de terre » le passif indique que Dieu est l’auteur de cette élévation que Paul dira comme étant au 3e ciel (2 Cor 12). Puis Dieu « lui ouvre les yeux » et que voit-il alors ? Il voit « rien », c’est à dire que toutes les images de Dieu qu’il se faisait deviennent néant (cf. Sermon 71 d’Eckhart). Et c’est une libération pour Paul, la mort est transformée en vie.
Voilà ce qu’est la foi : 1) une ouverture à la transcendance ; 2) dont on renonce à se faire une image. L’un et l’autre, indissociablement.
La représentation illusoire
Ceux qui ne « travaillent pas Dieu » ont d’autant plus de clichés sur lui en tête, et ceux qui disent ne pas croire en Dieu ont en tête une figure de Dieu effectivement assez épouvantable. Ceux qui ont une réelle expérience de ce que Dieu peut nous apporter risquent aussi de se faire une représentation de Dieu en figeant cette précieuse mémoire.
Or, on ne peut pas, en réalité, se faire de représentation de Dieu. Il n’est pas le seul que l’on ne peut pas enfermer dans un bocal, par exemple ce fleuve qu’est le Rhône qui passe au pied de chez nous et qui fait tourner les turbines de la centrale électrique. Un amoureux du Rhône peut avoir envie de prendre une bouteille, la remplir avant la Jonction, et la ramener chez lui en disant : voilà le Rhône. Et bien non. Ce litre d’eau bientôt croupie n’est pas sans rapport avec le Rhône mais il n’est pas le Rhône car le Rhône est d’une eau sans cesse différente et pourtant il reste le Rhône, il est mouvement, il est une force qui n’est pas dans la bouteille. Tels sont les représentations de Dieu, les doctrines sur Dieu. Même tirées d’une expérience authentique, le simple fait de penser capturer Dieu dans une idée est comme d’essayer de mettre le Rhône dans une bouteille. Et encore, le Rhône est un élément de la création comme nous, alors que Dieu n’est pas un être, il est ce qui donne la vie, le mouvement et l’être.
De la juste mémoire à l’idole
C’est pourquoi Ézéchias brise la précieuse relique du serpent d’airain de Moïse. Il est la mémoire d’une impulsion divine particulière, mémoire d’une libération de nos pères, n’est-ce pas à conserver, comme nos textes bibliques ? Tout dépend comment. Quand il devient un objet de culte, quand il est sacralisé, tout morceau de mémoire d’impulsion divine est alors confondu avec Dieu lui-même, et c’est nocif, car aucune nouvelle impulsion divine ne sortira de ce bout de métal forgé, il détourne ses adorateurs de Dieu au lieu de les inciter à s’ouvrir à l’inattendu, à inouï que Dieu a déjà préparé spécialement pour eux.
Ézéchias brise le serpent d’airain, il abat aussi les poteaux sacrés figurant la déesse mère Ashéra ou Astarté qui était la figure féminine de YHWH. Ce n’est pas d’aujourd’hui ni d’hier que les humains dressent des représentations de figures de Dieu et autres lieux sacrés alors vite en conflit. Plutôt que de travailler sur ces représentations de Dieu, mieux vaut « servir Dieu » en faisant vivre, et mieux vaut « travailler Dieu » afin de mieux se préparer à l’étonnement devant ce qu’il nous apporte, et pour cela renoncer à s’en donner une ou des représentations, quelles qu’elles soient.
Amen.
Textes de la Bible
Exode 3:2-15 (Moïse et Dieu)
2 Le messager de l’Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson brûlait dans un feu et le buisson n’était pas mangé. 3 Moïse dit: Je veux me détourner pour voir cette grande vision, et pourquoi le buisson ne brûle pas.
4 L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit: Moïse ! Moïse ! Et il répondit: Me voici ! 5 Dieu dit: N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre de sainteté. 6 Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.
7 L’Eternel dit: J’ai bien vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer… 10 Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël.
11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël? 12 Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie: quand tu auras fait sortir d’Egypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
13 Moïse dit à Dieu: J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14 Dieu dit à Moïse: Je suis : Je suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël: Celui qui s’appelle ‘Je suis’ m’a envoyé vers vous. 15 YHWH, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’as envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon souvenir de génération en génération.
Exode 20:1-4 (Le Décalogue)
1 Dieu prononça alors ces paroles : 2 Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude. 3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 4 Tu ne te feras pas d’image taillée, ni aucune représentation…
2 Rois 18:3-5 (Réforme)
3 Ezéchias fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, comme avait fait David, son père. 4 Il fit disparaître les lieux sacrés, brisa les statues, abattit les Ashérah, et il mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant lui : on l’appelait Nehuschtan. 5 Ezéchias mit sa confiance en l’Eternel.
Actes 9:1-8 (Paul voit Dieu)
1 Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, 2 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem.
3 Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
5 Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? celui-ci dit: Moi, je suis Jésus que tu poursuis. 6 Mais Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 7 Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne.
8 Saul fut relevé de terre, et ses yeux ayant été ouverts il voyait : rien.
(Cf. édition NEG)
Articles récents de la même catégorie
-

-

-

Articles récents avec des étiquettes similaires
-

-

-



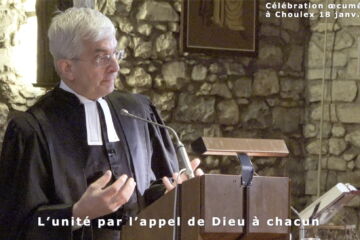
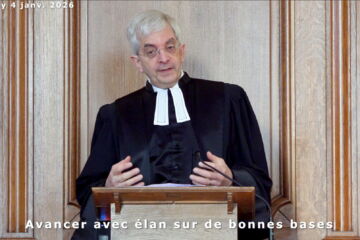



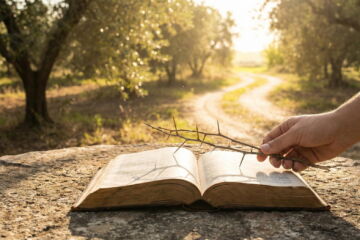
Bonjour,
Merci pour cette prédication qui fait réfléchir, ainsi que pour les commentaires.
En me basant sur les livres bibliques, je me sens un peu perdu à ce sujet entre plusieurs courants bibliques apparemment contradictoires.
Exode et Deutéronome sont plutôt anti-représentations, mais Esaïe et Apocalypse par exemple semblent proposer des grands récits de vision ou de rêve… de Dieu, ou de Jésus en gloire ? Et 1 Jean semble proposer des représentations abstraites de certains attributs de Dieu : Lumière, Amour… A l’inverse, Dieu serait-il hors de l’être, comme le Un de Plotin peut-être, ou comme d’autres sources fondamentales dans d’autres religions (la grande Vacuité de certains courants bouddhistes…) : la Source d’où émane l’être, d’où émane les êtres, un faiseur d’être comme vous dites ? Ou les deux en même temps : un Dieu source de l’être dont émane ou a émané tout l’être, et en même temps une personne dans l’être ?
Exode 20, décalogue :
4. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l’eau plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
Deutéronome 5, variante du décalogue :
8.Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l’eau plus bas que la terre. 9. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux
=> courant « iconoclaste » ?
Esaïe 6
Appel et mission d’Esaïe
1. L’année de la mort du roi Ozias, j’ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé; le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes: deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. 3. Ils se criaient l’un à l’autre: «*Saint, saint, saint est l’Eternel , le maître de l’univers! Sa gloire remplit toute la terre!» 4. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée.
5. Alors j’ai dit: «Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l’Eternel, le maître de l’univers!» 6. Cependant, l’un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu’il avait prise sur l’autel à l’aide de pincettes. 7. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: «Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié.»
8. J’ai entendu le Seigneur dire: «Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous?» J’ai répondu: «Me voici, envoie-moi!»
Apocalypse 1:
4. De la part de Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de [Dieu,] celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône 5. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts et le chef des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang 6. et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la domination aux siècles des siècles! Amen!
7. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l’ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui. Amen! 8. «Je suis l’Alpha et l’Oméga , dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Pantocrator [grec non traduit, titre honorifique des empereurs].»
9. Moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j’étais dans l’île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. 10. Je fus saisi par l’Esprit le jour du Seigneur et j’entendis derrière moi une voix forte comme le son d’une trompette. 11. Elle disait: «Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Eglises: à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.»
12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M’étant donc retourné, je vis sept chandeliers d’or, 13. et au milieu des [sept] chandeliers quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme. Il était habillé d’une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, 15. ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s’ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. 16. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans toute sa force.
17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant: «N’aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, 18. le vivant. J’étais mort et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19. Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite.
Genèse introduit quant à elle une question paradoxale à ce sujet :
Genèse 1.26 : Puis Dieu dit: «Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance! »
=> l’humain lui-même semble être une image de Dieu.
En mathématiques, le symbole infini n’est-il pas une représentation abstraite d’un attribut supposé (au moins par certains) de Dieu ?
Jean 1:1
Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu.
Jean 1:4
Et le Logos s’est fait homme, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
1 Jean
1:5 Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons: Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en lui.
[…]
4:8. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. 10. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Pour conclure, il me semble qu’on peut croire en Dieu (si on n’est pas d’accord, à prendre comme une sorte de témoignage) comme doté d’attributs idéaux : Amour (Agapé), Lumière, Vérité (la Vérité grecque, idéal des énoncés vrais sur la réalité de l’Univers et de la métaphysique), Connaissance, Compréhension, Logos (Raison divine & Parole divine), Source de l’être, Création (processus),…
Ne s’agit-il pas alors de réprésentations ?
Il s’agit de paraboles. D’une façon de parler, dirais-je :
L’exemple de maître Eckhardt, il était un magnifique théologien et pourtant, comme bien des mystiques, il ne confond pas sa théologie et Dieu lui-même.
Voir aussi, par exemple « le nuage de l’inconnaissance ».
Les attributs de Dieu sont des pistes aussi pour avancer nous même vers plus de justice et de bonté. Quand on dit que « Dieu est amour », c’est à mon avis le résumé ultime, le plus pur, de l’Evangile du Christ. Et pourtant, dans cette toute petite phrase de trois mots, chacun est piégé. Le mot « Dieu », bien sûr car il ouvre en nous tout un imaginaire. Le terme « amour » aussi est piégé car il convoque en nous bien des amours que nous avons vécues ou fantasmées, et que Dieu aime à sa façon, unique, transcendante. Quand au verbe être, Dieu n’est pas un être parmi les êtres, il est la source de l’être de sorte que même en disant que « Dieu est » c’est une façon de parler très largement réductrice.
Et pourtant, de là où nous sommes, il est utile de penser et de parler, de discuter, de prier. Mais mieux vaut le faire en sachant ce que l’on fait.
Grand merci d’entrer ainsi en dialogue de façon si approfondie.
Oui, merci à vous de permettre cette recherche théologique. Merci pour les références, j’ai téléchargé une version du « Nuage de l’Inconnaissance », texte attribué à un moine chartreux mystique anglais du XIVème siècle, nom qui m’évoque une sorte de temple asiatique perché au sommet d’une montagne sacrée, avec donc l’envie de visiter un tel monument sacré textuel dont l’évocation semble exotique. Pour ma part, je parlerais plutôt d’incertitude que d’inconnaissance, d’incertitude acceptée de la condition humaine, avec l’Amour, la Sagesse, l’Intelligence, la Connaissance, la Compréhension, et la Vérité idéaux en Dieu, et l’amour, quelques connaissances, recherches et approximations chez l’humain. Il me semble que cela peut être libérateur des écueils de l’orgueil ou de la suffisance (fermeture à Dieu voire à la possibilité de progrès), quel que soit son niveau passé, présent ou futur atteint, on peut et pourra cheminer pour progresser vers un ou plusieurs attributs idéaux de Dieu, perfections qui dépassent les capacités humaines, même à l’échelle de l’ensemble de l’humanité, même augmentées encore d’intelligence artificielle.
J’en ai profité pour me replonger dans un chapitre du livre « Les métamorphoses de Dieu, la nouvelle spiritualité occidentale » du sociologue des religions et philosophe Frédéric Lenoir, chapitre 7 (paragraphe du Dieu personnalisé au divin impersonnel).
Sur la base de ce chapitre, du fait de la différence entre essence et être, il existe deux courants théologiques qui traversent la plupart voire toutes les religions traditionnelles écrites il me semble : d’une part un courant qui vise à révéler la Divinité et certains attributs idéaux de son Être de façon explicite, avec un Dieu personnel, dans l’être, ontologique, et d’autre part un courant apophatique mystique qui vise à contempler et se relier à une Divinité Source de l’être mais a priori hors de l’être, Source dont l’être émane comme un parfum d’une fleur ou un torrent d’un rocher ou d’un glacier. Cela correspond à la différence entre théisme et déisme. La conception apophatique peut également avoir des conséquences en anthropologie : par exemple le Romantisme du XIXème siècle pourrait s’interpréter comme une des transpositions possibles dans les Arts, la littérature et la manière de vivre de la théologie apophatique : recherche d’une source créatrice à l’intérieur de l’humain, au coeur de son être, qui échapperait aux caractérisations « positives » ou présicentifiques de l’humanité issues de la philosophie des Lumières notamment, et donc in fine en réaction à une philosophie qui transpose une théologie « positive », caractérisante.
Ainsi, pour prendre un exemple dans l’Islam soufi, la citation suivante attribuée au poète mystique persan du XIIIème siècle (Djalâl al-Dîn) Rûmi : « Chaque rose dont émane un bon parfum conte les secrets de l’Universel » : les secrets de l’universel sont comme une émanation, donc l’être dérive d’une source préalable. La destinée humaine à l’échelle de l’éternité serait alors selon lui un retour vers cette source originelle dont notre être aurait comme la nostalgie :
« En son errance, ainsi, le cœur de l’homme incline,
Irrépressiblement, vers sa prime origine. »
Dans la Bible, il me semble que les deux courants sont présents, y compris parfois chez un même auteur attribué. Ainsi la vocation d’Esaïe (Esaïe 6) se rattacherait plutôt à la tendance Dieu personnel, même si le récit de la rencontre est une parabole, parabole signifie aussi représentation. J’aurais tendance à ranger Exode 3:2-15 également dans cette catégorie. En revanche le passage de la source du rocher dans le désert en Exode 17:3-6 pourrait appartenir à l’autre courant, avec la symbolique de l’eau source de vie qui jaillit d’une source dans le désert, donc d’un Dieu source de l’être : « Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: «Pourquoi nous as-tu fait quitter l’Egypte, si c’est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux?» Moïse cria à l’Eternel en disant: «Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres!» L’Eternel dit à Moïse: «Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d’Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche! Je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple boira.» Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.
De même en Jean 1:1, « Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. » : le Logos pourrait être identifié avec cette Source mystique de l’être : au commencement, au principe, était la Raison divine, dont a émané les lois physiques de l’Univers et de la Métaphysique, et la substance quantique du vide, poussière, argile, dont les êtres animés ou les éléments sont faits par assemblage. Puis en 1:4, « Et le Logos s’est fait homme, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. », il revient à une conception personnelle de Dieu, dans l’être.
Merci infiniment en tout cas.
Merci à vous pour ces belles recherches. Et d’en faire profiter les autres.
Merci beaucoup pour cette prédication qui pose une question somme toute assez difficile et centrale. Personnellement, je n’ai aucune réponse positive à apporter à votre interrogation hors des niaiseries mais je vous écoute et comme toujours, vous faites réfléchir . Merci 🙂
Alors, je trouve que ça se complique avec cette idée de représentation – c’est votre position très tranchée, radicale que je ne comprends pas trop – pourquoi rendre nécessaire l’éradication de toute représentation de Dieu dans votre théologie ?
Je comprends bien qu’il soit illégitime de représenter Dieu puisqu’il est au-delà de toute représentation – en réalité ce qu’est Dieu je n’en sais rien du tout et je n’ai jamais trouvé quelqu’un qui puisse vraiment le dire non plus car de fait il est, dans son être-même, indicible. En dire quelque chose de positif est délicat et risqué. On ne peut guère s’en approcher me semble-t-il que par la formule négative, la métaphore, l’analogie ou le symbole.
C’est pour cela que condamner toute représentation de Dieu, aussi bien sous forme d’objets matériels que mentaux, est peut-être excessif. Surtout si on a bien conscience qu’il s’agit justement d’une simple représentation et qu’on ne pense pas que ce qui est représenté est présent réellement dans cette représentation. Où est le mal alors de disposer d’images ? Est-ce un problème de théologie pour les protestants ? Avec une volonté de se démarquer du catholicisme dans lequel la profusion des images touche à son comble et confine, sur plusieurs d’entre elles, à l’idolâtrie tant décriée dans votre extrait ? Je ne suis pas sûre non plus que l’idolâtrie soit si présente aujourd’hui et même dans l’Eucharistie, il ne doit quand même pas y avoir beaucoup de catholiques qui soient vraiment convaincus que le corps du Christ est réellement présent dans l’hostie (même si c’est ce qu’affirme le dogme). Je me trompe peut-être.
Dans ce passage de l’Exode 20 où il est explicitement mentionné de ne produire aucune idole aucune image de ce qui est dans les cieux ou sur la terre, je me demande si cette insistance n’est pas due à la volonté des Juifs récemment monothéistes de se distinguer radicalement du polythéisme ambiant. D’éviter un retour vers lui, de refuser toute possibilité d’immanence divine qui viendrait un tant soit peu corrompre l’idée centrale de transcendance absolue. Par ailleurs, on peut remarquer que Dieu est représenté par un buisson qui brûle sans se consumer. Plus loin, c’est une lumière et une voix (Paul sur le chemin de Damas). Buisson, voix, lumière : qu’est-ce, sinon des représentations ? Et dans le Nouveau Testament, qu’est-ce même que l’incarnation sinon la volonté de Dieu de se donner/se révéler donc se représenter aux hommes dans la personne de Jésus-Christ ? Qu’on veuille éviter l’idolâtrie, d’accord, peut-être dans des temps plus reculés était-ce nécessaire – mais pourquoi ne pas aussi faire confiance à un regard éduqué qui devrait pouvoir distinguer entre l’être et l’apparence de l’être, entre l’être et l’être représenté et accepter possiblement ou non certaines images (mais pas tout et n’importe quoi non plus) ? On peut bien distinguer la lettre et l’esprit. N’est-ce pas ce que vous faites dans vos prédications ? Alors pourquoi pas avec les images ?
En fait, je crois qu’on peut voir des aspects positifs dans cet usage des images ou des représentations :
1) d’abord une part de vérité me semble présente dans toute représentation quelle qu’elle soit (pourquoi ne pas aller vers elle plutôt que de la négliger ?) tout comme dans votre comparaison : « le simple fait de penser capturer Dieu dans une idée est comme d’essayer de mettre le Rhône dans une bouteille » ; l’image du fleuve est bien choisie et très riche. Certes le Rhône, en tant que puissance et force vive, n’est pas dans la bouteille. Aucune capture possible ni du Rhône ni de Dieu. Néanmoins, il y a quand même quelque chose dans cette bouteille qui fait dire que vous n’avez capturé ni la Seine ni la Garonne. Qu’est-ce que c’est alors ? Eh bien, quelque chose « qui n’est pas sans rapport avec le Rhône », quelque chose qui fait signe vers le Rhône, qui le désigne même. Et c’est énorme déjà de faire signe, de désigner, non ? Pourquoi s’en priver ? Je crois que c’est ce que Pascale veut dire dans son post et le fait de désigner ne rend plus si illusoire que cela l’usage d’une représentation. « travailler Dieu » pourquoi cela ne serait pas aussi travailler sur ses représentations de Dieu justement (vous soulignez avec raison que certains en ont d’épouvantables) ? Sans gloser pour l’éternité car je suis bien d’accord que l’action doit prendre le pas sur la pensée et même que ce sont nos actions qui disent ce que nous pensons, bien plus que notre parole. Ce en quoi d’ailleurs, on s’arrête sur votre site car on y observe une pensée authentique en action et pas seulement un prêchi-prêcha sans âme. Dans votre genre, vous êtes un ovni.
2) Et puis, ça peut être utile une représentation de Dieu, y compris sous le format naïf d’un vieux bonhomme barbu en haut d’un nuage, auquel il ne s’agit pas de croire dur comme fer, bien sûr. Du moment qu’on ait bien conscience que la représentation n’est pas adéquate, où serait le drame d’user de cette image ? Il peut y avoir une utilité pour de jeunes enfants, même s’il y a sans doute mieux à faire. Une amie m’indiquait un jour (nous randonnions vers Vézelay) les difficultés qu’elle avait à parler de Dieu à ses deux filles de 7 et 9 ans : elle manquait d’idées, avait peur de dire des bêtises. Un peu prise de court, je lui ai conseillé de se procurer des livres pour enfants sur la Bible avec des images… Je n’ai pas pensé mal faire, ça m’a semblé logique… Somme toute, je dirai que peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse en quelque sorte, puisque cela peut permettre de penser/mener à Dieu. Une représentation de Dieu fait quand même signe vers Dieu, non ? C’est vrai qu’il faudrait faire attention de ne pas construire une image inadéquate (surtout auprès des enfants) qui se fossiliserait en un concept abusif et que c’est là une réelle difficulté qui ne doit pas être prise à la légère. Et cela se voit malheureusement (dans certaines religions, cela confine à de graves fantasmes et confusions) car les images sont très puissantes (bonnes ou mauvaises), peut-être, d’ailleurs, est-ce la raison première de leur exclusion dans cet extrait de l’Exode, une extrême défiance devant les pouvoirs de l’imagination, au moins concernant le divin ?
3) Et que dire des oeuvres d’art ? On ne va pas les déclarer toutes idolâtres quand même 😉 ? Je me rappelle d’avoir vu à la Galerie des Offices L’Annonciation, cette extraordinaire peinture de Léonard de Vinci dont il se dégage quelque chose d’incroyable, de quasi mystique qui fait clairement « signe vers », une expérience impressionnante. Quel dommage ce serait de s’en priver. Et que dire des Noces de Cana de Veronèse ou de la magnifique Vierge au rocher de Raphaël devant laquelle tout le Louvre passe sans y prêter la moindre attention. De là, vos temples sont très dépouillés – c’est votre principe et c’est respectable – mais c’est dommage. Est-ce non négociable ? Disons que ça n’incite pas à la réflexion, c’est difficile d’intellectualiser de cette façon. C’est peut-être une question d’habitude aussi, je ne me rends peut-être pas compte. L’aspect dépouillé peut aussi être inspirant pour certaines sensibilités, je veux bien le croire. Mais cette basilique de Vézelay très dépouillée (est-ce systématiquement le cas, était-elle en réfection ?) ne m’a fait aucun effet. Aucune idée vertigineuse ne m’est venue (sans doute ne suis-je pas faite pour les idées vertigineuses), je me souviens de m’y être ennuyée dans un vide sidéral la demi-heure que nous y avions passée. J’ai eu beau me concentrer pour penser je ne sais même pas à quoi. Rien.
4) Et si on veut entrer en dialogue au sujet de Dieu (ou de la liberté, de la générosité, de la justice …etc), il va bien falloir s’entendre à un moment sur ce qu’on veut dire et s’en faire une représentation (sous forme de concepts, d’images) au moins minimale, non ? Sinon la question même « Que peut-on dire de Dieu ? » n’a pas de sens. Cette dernière idée peut se soutenir honorablement d’ailleurs, on peut considérer que tout discours sur Dieu est superflu car inadéquat mais du coup on se prive de tout dialogue. Dans une telle perspective, il me semble que je ne vous aurais pas écrit et que votre site serait inutile. Par ailleurs une représentation de Dieu ne dit peut-être pas grand chose sur Dieu, peut-être même rien du tout, mais elle dit beaucoup sur celui qui se le représente et sur son rapport à Dieu. En ce sens aussi elle peut être intéressante à « travailler », comme vous dites, pour comprendre autrui et avancer ensemble même si les chemins, à un moment, se séparent.
Globalement, est-ce qu’on peut vraiment échapper aux représentations de la transcendance ? Ne sommes-nous pas d’abord des êtres de transcendance ? notre façon d’être au monde à travers le phénomène de notre conscience relève déjà d’une transcendance de soi constitutive et immédiate ; le langage que nous utilisons relève lui aussi dans sa fonction essentielle (atteindre autre chose que lui-même) de la transcendance ; et en plus on veut s’en servir pour évoquer, rendre présent une transcendance. D’où, pour faire vite, l’usage inévitable de représentations pour essayer de combler ces hiatus. Dans l’usage des images, dans la représentation, on pourrait voir un effort pour retrouver ce dont on est séparé et dont on voudrait rejoindre la vérité, même, partiellement..
Et finalement, est-ce que vous ne prenez pas un risque de perdre un peu votre auditoire sur cette question parce que si, Dieu, on ne peut pas le voir ni l’entendre (il n’est pas sensible bien sûr), ni en ressentir la présence (50% des croyants, dites-vous) si on ne peut même pas le représenter, ni se le représenter : « Or, on ne peut pas, en réalité, se faire de représentation de Dieu », eh bien on va répondre à votre question initiale, comme Paul : c’est rien et (je pousse un peu le bouchon) cela vous ferait un petit point commun avec l’athéisme… ce dont je ne vous soupçonne pas bien sûr, ce serait ridicule. C’est que votre exercice semble assez difficile « Voilà ce qu’est la foi : 1) une ouverture à la transcendance ; 2) dont on renonce à se faire une image. L’un et l’autre, indissociablement. » Le verbe « renoncer » me surprend. Pour tout vous dire, je le trouve impossible : la transcendance appuie tellement sur nous qu’on ne peut pas renoncer à l’exprimer, ce serait renoncer à se comprendre soi-même, renoncer à tenter de dire ce qu’on fait là. Du moins, je l’envisage ainsi.
Pour finir, je vous accorde sans problème que lorsqu’on considère que telle ou telle représentation (matérielle ou pensée) ne représente plus une chose mais est la chose elle-même, cela va entraîner idolâtrie, dogmatisme, absence d’ouverture d’esprit, guerre idéologique … etc donc exclure, éloigner de l’amour de Dieu, ce que je crois vous voulez surtout, et à juste titre, éviter. Vous avez raison d’insister aussi sur l’image qu’on peut se faire de Dieu, notamment après un genre d’expérience (mystique éventuellement), si forte qu’elle va s’enfermer dans une représentation. C’est en quoi les mystiques comme Sainte Thérèse d’Avila, par exemple, sont franchement lassants dans leur volonté de rendre communicable ce qui est incommunicable : leur expérience elle-même. Encore que lorsqu’ils sont de grands poètes, comme Jean de la Croix ou Baudelaire, ça fonctionne assez bien.
J’en conclus que la racine de votre refus des images enfermantes de Dieu trouve sa place dans l’idée qu’en cogitant sur un truc impossible à penser (Dieu), avec des représentations idolâtres ou au moins inadéquates, on finit par oublier de « travailler » Dieu, de « vivre Dieu » : « Plutôt que de travailler sur ces représentations de Dieu, mieux vaut « servir Dieu » en faisant vivre » ? Je suis bien d’accord que « vivre Dieu » doit être plus intéressant que de le penser (j’imagine du moins) mais sans doute faut-il d’abord le penser pour savoir comment le vivre ensuite, pour savoir « comment se préparer soi même pour l’appel qui nous correspondra » ? Détrompez-moi si la logique n’est pas la bonne. Surtout qu’à relire, la logique ne me paraît plus si logique…
Alors, j’ai l’impression qu’on pourrait voir ces représentations comme des vérités utiles aussi, des médiums, des passeurs et que, pour certains croyants dont sûrement des protestants aussi, un tel usage peut aider à « faire vivre » justement, « à se préparer à l’étonnement » (j’aime beaucoup cette dernière formule philosophique, même si à mon sens on ne peut pas vraiment s’y préparer). Il me semble du moins, c’est juste une hypothèse. Votre expérience de pasteur doit pouvoir vous éclairer sur ce point.
Merci en tout cas de susciter les réflexions,
Bien cordialement
C’est super intéressant et si bien dit ! Merci !!!
C’est parfois difficile de garder un certain équilibre entre la nécessité de penser Dieu et celle de ne pas s’en faire une représentation. Et ce, d’autant plus si on a en quelque sorte des acquis sans lesquels la foi n’est plus possible, comme, par exemple, l’accueil inconditionnel de chaque personne, ou bien, plus simplement, Dieu ne punit pas, ou encore Jésus image de Dieu parmi les humains.