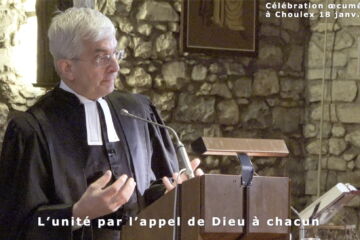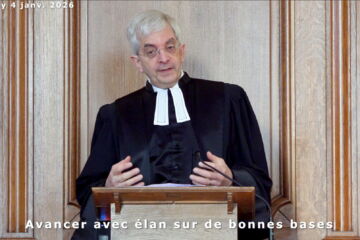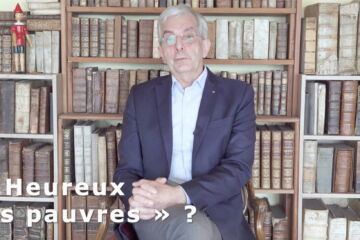Ces réflexions de Paul Tillich explorent la tension entre nos préoccupations quotidiennes et la dimension de l’infini. À travers les concepts d’Être nouveau et de préoccupation ultime, le théologien propose une voie vers la guérison de l’existence, où la foi devient une participation courageuse à une réalité nouvelle, au-delà des structures religieuses traditionnelles.
Après Une introduction à cette série de prédications par leur traducteur, vous trouverez ici ces prédications :
- L’Être nouveau, sur Galates 6,15
- Notre préoccupation ultime, sur Luc 10, 33-42
- Le salut universel, sur Matthieu 27, 45- 46 et 50-54
- Le Messie est-il venu ? sur Luc 2, 25-32
Une introduction à cette série de prédications de Paul Tillich
À propos de la prédication « L’Être nouveau »
Cette prédication, la seconde du recueil qui porte le même titre, a été d’abord publiée en automne 1950 dans la revue The Religious Life de New York Paul Tillich enseigne alors la théologie à l’Union Theological Seminary, la prestigieuse institution d’enseignement supérieur de cette ville dont le renom est associé à celui de Reinhold Niebuhr, l’auteur de Nature and Destiny of Man (Nature et destin de l’homme). Il a enseigné dans ce collège de 1933 à 1955.
Les connaisseurs en théologie observeront que le prédicateur lie étroitement dans son propos les doctrines classiques de la création, de la réconciliation et de l’eschatologie – ce qu’on appelle classiquement les fins dernières… C’est la voie de sortie des désenchantés de la scolastique luthérienne et réformée, celle qu’emprunte aussi Karl Barth dans sa Dogmatique ; elle s’impose à la réflexion des théologiens depuis que la conception objectiviste de l’homme héritée des penseurs de l’Antiquité a été démantelée par la philosophie existentielle d’un Kierkegaard et par la découverte de l’inconscient d’un Freud… On notera que Paul Tillich interprète son sujet de façon très luthérienne – j’entends à la façon même de Luther. La doctrine de la justification par la grâce moyennant la foi occupe la place centrale dans le développement de ce sermon.
Cependant il ne suffit pas de répéter la lettre d’une bonne doctrine, si « bonne » soit-elle, pour que la chose dont elle parle apparaisse en vérité à l’auditeur ou au lecteur. Le lecteur, on s’en doute, à tort ou à raison, n’a que faire personnellement des idées de Luther, de Calvin, des « papistes » et par-dessus tout des chicanes luthéro-réformées de petites cours germaniques. Mords-moi l’œil… Le prédicateur n’emprunte pas les cheminements de la tradition théologique d’autrefois pour que l’auditeur adhère à des « résultats » comme le profane admet sans broncher les conclusions d’une science à laquelle il n’entend que peu ou rien ; il lui propose seulement d’emprunter pour l’heure ses lunettes pour découvrir de ses propres yeux une certaine réalité. Qui se sert de lunettes pour voir ses lunettes ? Ainsi en va-t-il de la théologie en théologie ! En théologie importe la lecture prophétique – ou parabolique, ou symbolique – d’un certain réel de la réalité. Tillich tend trois clés à ses interlocuteurs, avec les trois « re », dont il parle en conclusion de son sermon : re-création, re-conciliation (il dit souvent ré-union) et re-surrection, puis laisse l’auditeur lecteur se laisser saisir – c’est son mot – par la « chose » évidente et cachée dont il vient de lui annoncer l’actualité.
À propos de la prédication « Notre préoccupation ultime«
Le sermon Notre préoccupation ultime (en anglais : Our Ultimate Concern) développe sous la forme d’un commentaire du récit évangélique de la visite de Jésus chez Marthe et Marie ce qu’on appelle dans la tradition chrétienne : la « foi ». On ne peut négliger que ce mot d’usage central est devenu aussi la sorte de valise où l’on transporte à peu près tout et n’importe quoi. Pour les uns, il s’agit surtout de croyances : on croit que… bien que les confessions de foi enseignent à dire Je crois en Dieu et non pas je crois que… D’autres l’entendent comme un appel à l’obéissance romaine ou à la soumission islamique. Pour d’autres encore, le même mot renvoie à un sentiment, ou à une conviction animatrice. Dernièrement, la foi a été associée au martyre, comme ce fut le cas dans l’Antiquité chrétienne, mais selon une perspective différente, incitant à adopter la conduite suicidaire de celui qui se fait meurtrier de foules pour gagner au-delà un paradis de délices compensatoires.
L’auteur du sermon, s’il savait que la « foi » peut pousser au crime, ignorait ce dernier, qui impose à toutes les Églises de clarifier devant leurs fidèles et devant le grand public ce qu’elles encouragent quand elles prêchent la « foi ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Paul Tillich a voulu dé-fanatiser la foi en refondant sa prédication. Qu’est-ce qu’on veut dire quand on prêche la foi ?
Le prédicateur se proposait d’en reprendre à frais nouveaux la signification en contournant les habitudes langagières des sermons et des catéchismes. Qu’est-ce que la « préoccupation ultime » ?
Il s’agit, dit-il, d’une traduction abstraite du grand commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force (1). » Cette sorte d’équivalence joue dans son travail le rôle d’un concept opératoire. C’est le critère chrétien de toute parole prétendant annoncer quelque chose au sujet de Dieu. La théologie a pour objet ce qui nous préoccupe de façon ultime. Seules sont théologiques les propositions qui traitent de leur objet en tant qu’il peut devenir pour nous une affaire de préoccupation ultime (2).
Paul Tillich n’enseigne pas une nouvelle conception de la foi. L’histoire de Marthe et de Marie le fait pénétrer dans le monde des soucis humains sur les traces de ce que Jésus voulait dire quand il fit l’éloge de Marie. Prédicateur apologète, il rencontre nos soucis par la voie du questionnement. Qu’est-ce que nous vivons ? La foi ? Comment la vivons-nous ? La seule solution serait-elle de se résigner à vivre dans l’inquiétude ou dans l’angoisse ? Existe-t-il une autre démarche ? On voit que méditer, ce n’est pas fuir les questions. Ave Maria !
À propos de la prédication « Le salut universel«
La lecture de cette prédication vient à point en cette période de l’année où les fidèles des Églises se préparent aux célébrations de la Semaine sainte et de Pâques. Elle donne à l’annonce de la résurrection toute la saveur de ses résonances bibliques implicites. Elle conduit son lecteur des fantaisies d’un imaginaire asservi à la lettre des récits et à l’étroitesse d’une piété doloriste jusqu’à l’intelligence spirituelle de la révolution religieuse dont la mort de Jésus a été la conséquence dans l’histoire. Le prédicateur l’expose dans son ampleur en usant des ressources d’une vibrante narrativité.
À propos de la prédication « Le Messie est-il venu ? »
Cette prédication est la 11ᵉ du recueil « L’Être nouveau », dans la seconde partie qui concerne la liberté. Une prédication pour Noël.
Jean-Marc Saint (théologien, psychanalyste, auteur, traducteur)
L’Être nouveau, une prédication de Paul Tillich sur Galates 6,15
«Ce qui importe, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, c’est une création nouvelle.» Galates 6,15
Si l’on me demandait de résumer en deux mots pour notre temps le Message chrétien, je dirais avec Paul : C’est l’annonce d’une «nouvelle Création». Nous avons lu un texte sur la nouvelle création dans la seconde lettre aux Corinthiens de Paul. Permettez-moi d’en rappeler l’une des phrases avec les mots d’une traduction exacte: «si quelqu’un est uni au Christ il est un être nouveau ; l’ancien état de choses est passé, voici il y a un nouvel état de choses.» . Le Christianisme est l’annonce de la création nouvelle, de l’être nouveau, de la réalité nouvelle, apparue avec la présence de Jésus, lequel pour cette raison et précisément pour cette raison, est appelé le Christ. Car le Christ, autrement dit, le Messie, l’élu et l’oint, c’est celui qui apporte un nouvel état de choses.
Nous vivons tous dans l’ancien état de choses et notre texte nous demande avec insistance : participons-nous aussi à la création nouvelle? Nous appartenons à l’ancienne création et le Christianisme nous demande de participer aussi à la création nouvelle. Nous avons appris à nous connaître dans notre être ancien ; au cours de cette heure nous allons nous demander si nous avons aussi fait l’expérience d’un être nouveau.
Quel est cet être nouveau? Paul répond d’abord en disant ce qu’il n’est pas. Ce n’est ni la circoncision, ni l’incirconcision. Cela signifie pour Paul et pour les lecteurs de sa lettre quelque chose de bien défini. Cela signifie qu’être Juif ou païen n’a pas d’importance ultime, et que seul compte le fait d’être uni à celui en qui la réalité nouvelle est présente. Circoncision et incirconcision, qu’est ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie quelque chose de très défini et en même temps de très universel. Cela signifie qu’aucune religion comme telle ne crée l’être nouveau. La circoncision est un rite religieux observé par les Juifs ; les sacrifices sont des rites religieux observés par les païens ; le baptême est un rite religieux observé par les Chrétiens. Tous ces rites importent peu, seule importe une création nouvelle. Et puisque dans le langage de Paul ces rites représentent la religion dont ils sont une partie, nous pouvons dire : Aucune religion n’a d’importance, seul importe un état de choses nouveau. Réfléchissons à cette affirmation saisissante de Paul. Elle déclare premièrement que le Christianisme est plus qu’une religion ; c’est l’annonce de la création nouvelle. Le Christianisme comme religion n’est pas important ; il est comme la circoncision ou l’incirconcision, ni plus, ni moins ! Pouvons-nous imaginer les conséquences de cette déclaration de l’apôtre pour notre situation? Dans le monde présent, le Christianisme rencontre diverses formes de circoncision et d’incirconcision. La circoncision peut représenter aujourd’hui ce qu’on appelle la religion et l’incirconcision ce qu’on appelle la laïcité, avec ses exigences quasiment religieuses. À côté du Christianisme, existent de grandes religions: l’Hindouisme, le Bouddhisme, l’Islam et ce qui demeure du Judaïsme classique ; ces religions ont leurs mythes et leurs rites – autrement dit leur «circoncision» – qui leur donnent leurs caractéristiques propres. Existent aussi des mouvements laïques, tels le fascisme et le communisme, l’humanisme laïque et l’Idéalisme éthique. Ces mouvements s’efforcent d’écarter les mythes et les rites et représentent autrement dit l’incirconcision. Ils prétendent à la vérité ultime et exigent une complète consécration. Comment le Christianisme se tournera t-il vers eux? Leur dira-t-il : Venez à nous, nous sommes la meilleure des religions ; notre genre de circoncision ou d’incirconcision est supérieure au vôtre ? Faut-il louer le Christianisme comme s’il était notre style de vie, religieux et laïc ? Faut-il transformer le Message chrétien en récit de réussite, et dire à la façon de la publicité: Faites en l’essai auprès de nous et vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer ! Certains missionnaires, certains clercs et certains laïcs font usage de pareilles méthodes. Ils montrent leur totale incompréhension du Christianisme. L’apôtre, qui fut à la fois un missionnaire, un clerc et un laïc déclare quelque chose de bien différent. Il dit : aucune religion particulière n’a d’importance, ni la nôtre, ni la vôtre ; par contre, je peux vous dire que quelque chose d’important est arrivé, quelque chose qui nous juge vous et moi, votre religion et la mienne : une création nouvelle est intervenue, un être nouveau est apparu ; nous sommes tous appelés à y participer. Quand nous rencontrons des païens et des juifs nous devrions leur dire: Ne comparez pas votre religion à notre religion, vos rites à nos rites, vos prophètes à nos prophètes, vos prêtres à nos prêtres, vos saints à nos saints. Cela ne sert à rien ! Et surtout ne pensez pas que nous voulons vous convertir au Christianisme anglais ou américain, ou à la religion du Monde occidental. Nous ne voulons pas vous attirer à nous ni même aux meilleurs d’entre nous. Cela ne servirait à rien ! Nous voulons seulement vous montrer ce que nous avons vu et vous dire ce que nous avons entendu : il y a une nouvelle création au milieu de l’ancienne création et cette nouvelle création est manifeste en Jésus qu’on appelle le Christ.
Quand nous rencontrons des fascistes et des communistes, des humanistes scientistes et des représentants de l’éthique idéaliste, nous devrions leur dire: Ne vous vantez pas trop de n’avoir pas de rite ni de mythe, d’être libérés de la superstition et d’être parfaitement rationnels, «incirconcis» en tout sens du terme. En premier lieu, vous avez vous aussi vos rites et vos mythes, et votre petite circoncision ; ils sont même très importants pour vous. Si vous en étiez complètement libres, vous n’auriez pas besoin de mettre en évidence votre in-circoncision. Cela ne sert à rien ! Ne pensez pas que nous voulons vous détourner de la laïcité pour vous tourner vers la religion, que nous voulons faire de vous des religieux, membres d’une religion supérieure, la religion Chrétienne, et en son sein d’une grande dénomination: la nôtre ! Cela ne servirait à rien. Nous voulons seulement vous faire connaître l’expérience que nous avons faite ici et maintenant, dans le monde, celle d’une nouvelle création, souvent cachée, parfois manifeste, mais assurément manifeste en Jésus qu’on appelle le Christ.
C’est de cette manière que nous devrions nous adresser à ceux qui, religieux ou laïques, se tiennent en dehors de la sphère du Christianisme. Nous ne devrions pas trop nous préoccuper de la religion chrétienne, de l’état des Églises, de leur fréquentation, de leurs doctrines, de leurs institutions, de leurs ministres, de leurs sermons et de leurs sacrements. C’est la «circoncision» et son absence, la sécularisation, aujourd’hui répandue de plus en plus dans le monde, c’est l’»incirconcision». L’une et l’autre sont sans importance si l’on pose la question ultime, la question de la réalité nouvelle. Cette question infiniment importante devrait nous préoccuper plus que tout sous le ciel et sur la terre. La création nouvelle – c’est notre préoccupation ultime : elle devrait nous passionner infiniment – elle est la passion infinie de tout être humain. Comparativement, la religion ou l’a-religion, le Christianisme ou le non-Christianisme, importent très peu – et comptent pour rien ultimement.
Permettez-moi maintenant de vanter un instant le fait que nous sommes chrétiens ; soyons fous de vantardise, comme le dit Paul quand il commence à se vanter. Il est important qu’étant chrétien on puisse soutenir l’idée que cela n’a pas d’importance. La puissance spirituelle de la religion permet à celui qui est religieux de considérer sans crainte la vanité de la religion. Le fruit le plus mûr la pensée chrétienne consiste à comprendre que le Christianisme comme tel ne sert à rien. Voilà de la vantardise, non pas une vantardise personnelle, mais une vantardise à propos du Christianisme. Comme vantardise, c’est une folie. Mais comme vantardise relativement au fait qu’il n’y a pas de quoi se vanter, c’est de la sagesse et de la maturité. Avoir sans avoir – est une attitude juste à l’égard de tout ce qui est grand et merveilleux dans la vie, même à l’égard de la religion et du Christianisme. Par contre, ce n’est pas une attitude juste à l’égard de la création nouvelle. L’attitude juste a l’égard de la création nouvelle est un désir passionné et infini.
Soulevons de nouveau la question: Quel est cet être nouveau ? L’être nouveau n’est pas quelque chose qui remplacerait simplement l’être ancien. C’est un renouveau de l’ancien, lequel a été corrompu, déformé, divisé, presque détruit, mais pas détruit complètement. Le salut ne détruit pas la création ; il fait de l’ancienne création une création nouvelle. Aussi faut-il parler du nouveau en termes de re-nouveau : du triple «re» de la re-conciliation, de la re-union, de la re-surrection.
Paul associe dans sa lettre la création nouvelle et la réconciliation. Le message de la réconciliation est : Soyez réconcilié avec Dieu. Cessez de lui être hostile, car jamais il n’est hostile envers vous. Le message de la réconciliation n’est pas que Dieu a besoin d’être réconcilié. Comment pourrait-il l’être? Il est la source et la puissance de la réconciliation, qui pourrait le réconcilier ? Mais païens, juifs, et chrétiens – nous avons tous essayé et essayons encore de nous réconcilier avec lui à l’aide de rites, de sacrements, de prières et de services, d’actions morales et d’œuvres de charité. Si nous tentons de le faire, si nous essayons de lui donner quelque chose, de lui montrer des bonnes œuvres pour l’apaiser, nous échouons. Il n’y en a jamais assez ! Nous ne pouvons jamais le satisfaire ; l’exigence est infinie. Du fait que nous ne pouvons pas l’apaiser, nous devenons hostiles envers lui. N’avez-vous jamais remarqué la somme d’hostilité envers Dieu qu’on trouve dans les profondeurs de gens honnêtes et bons qui excellent en œuvres de charité, en piété et en zèle religieux ? Il ne peut pas en être autrement ; chacun est hostile, consciemment ou inconsciemment, envers ceux dont il se sent rejeté. Tout le monde se trouve ans cette situation, que l’on nomme «Dieu», «nature», «destin» ou «condition sociale» ce qui nous rejette. Chacun éprouve de l’hostilité envers l’existence dans laquelle il est jeté, envers les puissances cachées qui déterminent sa vie et celle de l’univers, envers ce qui le rend coupable et le menace de destruction parce qu’il est devenu coupable. Nous-nous sentons tous rejetés et hostiles envers ce qui nous a rejeté. Nous essayons de l’apaiser et l’échec nous rend encore plus hostiles encore. Cela se produit souvent à notre insu. Mais il y a deux symptômes que nous ne pouvons pas éviter de voir: l’hostilité envers nous-même et l’hostilité envers les autres. On parle souvent de l’orgueil, de l’arrogance, de la suffisance et de la complaisance des gens. C’est souvent le niveau le plus superficiel de leur être. En dessous, au niveau plus profond, il y a un refus de soi, un dégoût et même une haine de soi. Soyez réconciliés avec Dieu signifie aussi: soyez réconciliés avec vous-mêmes ! Car nous ne le sommes pas ; nous cherchons à nous apaiser nous-mêmes. Nous-nous efforçons de nous rendre plus acceptables. Celui qui se sent rejeté par Dieu et qui se rejette se sent aussi rejeté par les autres. Plus il éprouve d’hostilité envers son destin, plus il en éprouve envers lui-même et envers les autres. S’il nous arrive d’être saisi d’horreur devant l’hostilité inconsciente ou consciente que les autres trahissent à notre égard, ou en découvrant notre propre hostilité envers ceux que nous croyons aimer, n’oublions pas qu’eux aussi se sentent rejetés par nous et que nous-nous sentons rejetés par eux. Ils se sont efforcés de se faire accepter et ils ont échoué. Nous-nous sommes efforcés de se faire accepter et nous avons échoué. Leur hostilité comme la nôtre s’accroît. Soyez réconciliés avec Dieu ! Cela signifie aussi : soyez réconciliés avec les autres ! Mais cela ne signifie pas : essayez de vous réconcilier avec les autres ! Cela ne signifie pas non plus : essayez de vous réconcilier avec vous-mêmes ! Essayez de vous réconcilier avec Dieu, vous échouerez ! Voici le message : Une nouvelle réalité est apparue au sein de laquelle vous êtes réconciliés. Nous n’avons rien à montrer pour entrer dans l’être nouveau ; nous devons seulement nous ouvrir pour qu’il nous saisisse : Rien à montrer !
Le premier signe de la réalité nouvelle est d’être réconcilié, le second signe est d’être réuni. La réconciliation rend possible la réunion. La nouvelle création est la réalité qui réunit ce qui est séparé. L’être nouveau s’est manifesté en Christ parce chez lui la séparation ne l’a jamais emporté sur son unité avec Dieu, avec l’humanité et avec lui-même. C’est ce qui confère à l’image que les évangiles présentent de lui une puissance irrésistible et inépuisable. Nous découvrons en lui une vie humaine qui maintient l’unité en dépit de tout ce qui la pousse à la séparation. Il représente et médiatise la puissance de l’être nouveau, parce qu’il représente et médiatise la puissance d’une unité ininterrompue. Là où apparaît la réalité nouvelle, on se sent uni à Dieu, fond et sens de toute existence. On éprouve ce qu’on appelait jadis l’amour du destin ; ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui, le courage d’assumer sa propre angoisse. On fait alors l’expérience étonnante d’être uni à soi, non dans l’orgueil et la suffisance, mais dans l’acceptation profonde de soi. On s’accepte soi-même comme une réalité d’une importance éternelle, éternellement aimée, éternellement acceptée. Le dégoût de soi, la haine de soi disparaissent. La vie trouve un centre, une direction, un sens. Toute guérison – physique ou mentale – crée une réunion de soi avec soi. Là où intervient une véritable guérison, là est l’être nouveau, la création nouvelle. Mais pour qu’advienne une guérison véritable il ne suffit pas qu’une partie du corps ou de l’esprit soit réuni à l’ensemble, il faut que cet ensemble – notre être entier notre personnalité entière – soit uni à lui-même. La nouvelle création est une création qui guérit, parce qu’elle réuni à soi et qu’elle réunit aux autres. Rien de plus caractéristique de l’ancien être que la séparation entre les hommes. Rien n’est recherché plus passionnément que la guérison de la société, que l’être nouveau au sein de l’histoire et dans les relations humaines. La lourde accusation de n’avoir pas contribué à l’union de l’humanité pèse lourdement sur la Religion et sur le Christianisme. Qui peut nier le bien fondé de ce défi ? Néanmoins, l’humanité continue de vivre, et elle ne vivrait plus si la puissance de la réunion, de guérison, de la création nouvelle ne l’emportait en permanence dans l’histoire humaine sur la séparation. Chaque fois que l’un de nous est saisi par un visage humain en tant qu’humain, chaque fois que sont surmontés des répugnances personnelles, des préjugés raciaux, des conflits nationaux, la différence des sexes, de l’âge, de la beauté, de la force, de la connaissance et beaucoup d’autres causes de séparation – alors advient la création nouvelle ! L’humanité ne vit que parce que cela se produit sans cesse. Si l’Église, en tant qu’assemblée de Dieu a une signification ultime, elle-ci tient au fait qu’on y proclame, qu’on y reconnaît, et qu’on y réalise, même partiellement, dans la faiblesse et les distorsions, la réunion des l’humains les uns avec les autres. L’Église est le lieu où la réunion de l’homme avec l’homme est un événement effectif, en dépit du fait que l’ Église de Dieu soit trahie continuellement par les Églises chrétiennes. Trahie et repoussée, la création nouvelle sauve et maintient les Églises, l’humanité et l’histoire, qui pourtant la trahissent et la repoussent.
L’Église, comme tous ses membres, rechute de l’être nouveau dans l’ancien être. C’est pourquoi le troisième signe de la création nouvelle est la re-surrection. Le mot «résurrection» évoque auprès de beaucoup un cadavre surgissant de la tombe, ou tout autre image fantastique. Or le mot «résurrection» désigne le triomphe d’un état de choses nouveau, la naissance d’un être nouveau à partir de la mort de l’ancien. La résurrection n’est pas un événement qui pourrait se produire dans un certain futur lointain, elle est, ici et maintenant, aujourd’hui et demain, la puissance de créer la vie à partir de la mort de l’être nouveau, Là où est l’être nouveau, là est la résurrection, autrement dit la création éternelle de tout moment du temps. L’être ancien porte la marque de la désintégration et de la mort. L’être nouveau place une marque nouvelle sur l’ancien. De la désintégration et de la mort naît une réalité d’une signification éternelle. Ce qui fut immergé dans la dissolution émerge dans la création nouvelle. La résurrection se produit maintenant ou jamais. Elle se produit en nous et autour de nous, dans l’âme, dans l’histoire, dans la nature et dans l’univers.
Réconciliation, réunion, résurrection – telle est la création nouvelle, l’être nouveau, l’état de choses nouveau. Y participons-nous ? Le Message du Christianisme n’est pas le Christianisme, mais une réalité nouvelle. Un état de choses nouveau est apparu. Il apparaît encore. Il est caché et il est visible, il est ici et il est là. Acceptez-le, entrez et laissez-vous saisir par lui.
Paul Tillich
Notre préoccupation ultime, une prédication de Paul Tillich sur Luc 10, 33-42
Pendant qu’ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut. 39 Sa sœur, appelée Marie, s’était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. 40 Marthe, qui s’affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : Seigneur, tu ne te soucies de ce que ma soeur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m’aider. 41 Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. 42 Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas retirée. Luc 10, 33-42.
Les paroles que Jésus a dites à Marthe comptent parmi les plus célèbres de la Bible. Marthe et Marie sont de l’homme dans toute l’humanité, de deux sortes de préoccupation . Marthe est préoccupée par beaucoup de choses, mais toutes choses sont finies, préliminaires, éphémères. Marie est préoccupée par une seule chose, infinie, ultime, durable.
L’attitude de Marthe n’est pas méprisable. Au contraire ! C’est ainsi que marche le monde. C’est la force qui conduit, conserve et enrichit la vie et la culture. Sans elle, Jésus n’aurait jamais pu parler à Marie et Marie n’aurait pu écouter Jésus. J’ai entendu une fois un sermon dédié à la gloire et à la justification de Marthe. Pourquoi pas ? Dans notre vie et, d’une manière générale en toute vie humaine, d’innombrables préoccupations réclament notre attention, notre ardeur et notre passion. Elles sont souvent importantes pour vous et pour moi et pour toute l’humanité. Cependant aucune n’a d’importance ultime. C’est pourquoi Jésus ne loue pas Marthe, mais Marie. Elle a choisi la meilleure part, la seule chose dont l’homme a besoin, celle qui peut le préoccuper de façon ultime.
L’heure du culte à l’église et chaque moment de lecture et de méditation, sont consacrés à une écoute semblable à celle de Marie. Quelque chose nous est dit, – au prédicateur comme à ses auditeurs – qui peut nous préoccuper infiniment. C’est la raison d’être du sermon : il doit éveiller une préoccupation infinie.
Que signifie être préoccupé par quelque chose ? Cela signifie que nous y sommes en jeu, qu’une partie de nous-même s’y trouve engagée et que nous y prenons part de tout notre cœur. Cela peut encore vouloir dire davantage. Cela montre de quelle manière nous sommes en jeu, autrement dit, avec inquiétude. La sagesse du langage identifie souvent la préoccupation et l’inquiétude. Beaucoup de chose nous mettent en jeu et nous font éprouver de l’inquiétude. Beaucoup de choses nous intéressent, et certaines nous font pitié ou horreur. Ce ne sont pourtant pas de véritables préoccupations ; elle n’engendrent pas cette l’angoisse qui nous torture quand est véritablement et sérieusement préoccupés. Dans l’histoire, Marthe était sérieusement préoccupée. Rappelons-nous ce qui nous préoccupe dans notre vie de tous les jours, du lever à la minute à notre coucher et au-delà, quand nos inquiétudes apparaissent dans nos rêves.
Nous sommes préoccupé par notre travail ; c’est la base de notre existence. Nous pouvons l’aimer ou le détester, ou l’accomplir comme un devoir ou comme une dure nécessité. L’inquiétude nous saisit dès que nous éprouvons les limites de nos forces, notre manque d’efficacité, que nous sentons combien il faut lutter contre la paresse, ou se préserver des dangers d’un échec. Nous sommes préoccupés par nos relations avec les autres. Nous ne pouvons pas imaginer vivre sans la bienveillance d’autrui, sans amitié, sans amour, sans communion. Nous sommes inquiets et souvent profondément désespérés à la vue de l’indifférence, du déchaînement de la colère et de la jalousie, de l’animosité cachée et souvent empoisonnée que nous découvrons en nous et chez ceux que nous aimons. S’immisce dans nos cœurs et rend notre amour fiévreux. Nous sommes préoccupés par nous-même. Nous-nous sentons responsable de la croissance de notre maturité, de notre ténacité dans la vie, de notre sagesse et notre vie spirituelle. En même temps, nous recherchons le bonheur, nous avons le souci de nos plaisirs, celui d’avoir du « bon temps ». Cette préoccupation compte à nos yeux énormément. Mais l’inquiétude nous saisit quand nous-nous voyons dans le miroir de notre conscience, ou dans le jugement des autres. Nous sentons que nous pris de mauvaises décisions, que nous avons fait fausse route, que nous perdons la face à nos propres yeux et devant les autres. Nous-nous comparons aux autres et nous-nous sentons inférieurs à eux ; nous sommes alors déprimés et frustrés. Nous croyons avoir gaspillé notre bonheur en le recherchant avec trop d’impatience, en le confondant avec le plaisir, ou encore par manque de courage au moment où il fallait prendre la juste décision qui nous rendrait heureux.
N’oublions pas la préoccupation la plus naturelle et la plus universelle parmi les vivants : se maintenir en vie. C’est la préoccupation du « pain quotidien » ! On l’avait presque oubliée dans de larges secteurs du monde occidental. Elle est revenue en force aujourd’hui dans une grande partie de l’humanité. Elle fait disparaître la plupart des autres tant elle absorbe l’esprit beaucoup de gens.
Quelqu’un dira: n’existe t-il pas de préoccupations plus hautes que celles de la vie quotidienne ? Jésus lui-même n’en témoigne t-il pas? Son émotion devant la misère des masses ne consacre t-elle pas les préoccupations sociales qui saisissent de nos jours nombre de contemporains? Quand Jésus a été pris de compassion pour les malades et qu’il les guérit, ne consacrait-il pas la préoccupation de tous les médecins et de tous les soignants du corps et de l’âme ? Quand Jésus a rassemblé autour de lui un petit groupe pour constituer une communauté, ne consacrait-il pas la préoccupation de la vie sociale ? Quand il disait venir rendre témoignage à la vérité, ne consacrai-il pas la préoccupation de la vérité et la passion de la connaissance, qui deviennent l’un des courants moteur de notre temps. Quand il enseignait les foules et ses disciples ne consacrait-il pas la préoccupation de l’enseignement et de l’éducation ? Quand il racontait des paraboles, quand il décrivait la beauté de la nature et formulait des sentences d’une perfection classique, ne consacrait-il pas la préoccupation de la beauté, avec l’élévation spirituelle et le repos qu’elles nous accordent après l’agitation de la journée.
Toutes ces nobles préoccupations sont-elles la seule chose dont nous avons besoin, la chose nécessaire choisie par Marie? Ou sont-elles, au contraire la formes supérieure de la préoccupation représentée par Marthe ? Somme-nous encore préoccupés comme Marthe par beaucoup de choses, même si celles-ci sont nobles et grandes ?
Sommes-nous réellement au-delà de l’angoisse quand les problèmes sociaux nous préoccupent et que nous prenons conscience de notre situation de privilégiées face à la misère et aux injustices dont souffrent les masses du monde entier ? Ne sommes nous pas atterrés ? Cela ne nous coupe t-il pas le souffle? Connaissez-vous la torture de ceux qui veulent soigner un malade et qui savent qu’il est trop tard ; de ceux qui veulent donner une éducation et qui rencontrent la stupidité, la méchanceté et la haine ; de ceux qui doivent gouverner et qu’accablent l’ignorance populaire, l’ambition de leurs adversaires, de mauvaises institutions ou la malchance ? Voilà des inquiétudes plus grandes que celles que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Connaissez vous l’inquiétude liée à toute recherche honnête ? Celle de tomber dans l’erreur, en particulier quand la pensée doit explorer de nouvelles voies ? Avez vous ressenti le sentiment de vide presque intolérable qu’on éprouve quand en retournant vers les soucis de la vie journalière après avoir admiré une grande oeuvre d’art ? Même s’il ne s’agit pas de la seule chose dont nous avons besoin, comme le déclare Jésus quand il annonce devant la beauté du temple qu’il est condamné à la destruction. L’Europe a appris que la créativité millénaire dont elle se vantait n’était pas la « seule chose nécessaire » ; les monuments de ces millénaires sont maintenant en ruine.
Pourquoi ces multiples choses qui nous préoccupent sont-elles en rapport avec le souci et l’angoisse ? Nous leur consacrons nos forces, notre passion et il faut qu’il en soit ainsi, sinon nous ne pourrions rien accomplir. Pourquoi nous laissent-t-elles alors les profondeurs de notre cœur sans repos? Pourquoi Jésus les écarte t-il comme n’étant rien d’ultimement nécessaire ?
Jésus montre, par ses paroles au sujet de Marie, que toutes ces choses peuvent nous être retirées. Elles sont toutes finies. Ce sont des préoccupations finies. Dans la courte durée de notre vie beaucoup d’entres elles ont disparues, d’autres ont surgies qui disparaîtrons à leur tour. De nombreuses préoccupations du passé se sont évanouies et beaucoup d’autres prendront fin tôt ou tard. La loi mélancolique de l’éphémère régit nos préoccupations même les plus passionnées. L’angoisse de la fin habite les joies quelles nous accordent. Les choses qui nous préoccupent, et nous avec elles, aurons une fin. Un moment viendra – peut-être n’est-il pas loin – où toutes ces préoccupations ne nous préoccuperont plus ; leur finitude nous sera révélée avec l’expérience de notre propre finitude – autrement dit, de notre propre fin.
Nous tenons à nos préoccupations préliminaires comme si elles étaient ultimes. Elles nous maintiennent sous leur emprise même nous essayons de nous en libérer. Toute préoccupation est tyrannique. Elle réclame tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre force. Toute préoccupation tend à devenir notre préoccupation ultime, notre dieu. La préoccupation du travail réussit souvent à être notre dieu, comme le font aussi la préoccupation des autres ou celle du plaisir. La préoccupation de la science a réussi à devenir le dieu de toute une période de l’histoire. La préoccupation de l’argent est devenu un dieu encore plus important. La préoccupation de la nation a été le dieu le plus important de tous. Toutes ces préoccupations finies combattent les unes avec les autres et elles accablent notre conscience parce que nous ne pouvons pas leur faire justice à toutes.
Nous pouvons essayer d’éliminer toute préoccupation pour adopter le détachement du cynique. Nous décidons que rien ne nous préoccupera, sauf peut-être occasionnellement, mais pas sérieusement. Nous essayons d’être détaché de nous-même, des autres, de notre travail, de nos plaisirs, du nécessaire et du luxe, des affaires sociales et politiques, du savoir et de la beauté. Finalement, nous pouvons estimer que notre détachement a quelque chose d’héroïque. Une chose est vraie : c’est la seule alternative à la préoccupation ultime. Le détachement ou la préoccupation ultime : voilà la seule alternative. Le cynique est passionnément préoccupé par une seule chose : son détachement. C’est la contradiction interne à tout détachement. Voilà pourquoi, il n’y a qu’une seule possibilité, c’est la préoccupation ultime.
Quelle est alors la seule chose dont nous avons besoin ? Qu’elle est la meilleure part que Marie a choisie ? Comme l’histoire que nous avons lue, j’hésite à répondre, car toute réponse devient source de malentendus. Si je réponds : c’est la « religion », on se méprendra. On croira qu’il s’agit d’un ensemble de croyances et de pratiques. Comme le montre d’autres récits du Nouveau Testament, Marthe était pour le moins aussi religieuse que Marie. La religion peut devenir une préoccupation humaine du niveau des autres, créant de l’angoisse comme les autres ce qu’on constate en histoire et en psychologie des religions. Il existe même des gens censés cultiver cette préoccupation particulière. On les appelle des « religionistes » ! C’est une appellation très blasphématoire, qui en révèle davantage sur la décadence de la religion à notre époque, que n’importe quoi d’autre. Si la religion est la préoccupation particulière de certaines personnes et non pas la préoccupation ultime de tout le monde, elle n’est qu’un non sens et un blasphème. Revenons encore à la question : Quelle est la seule chose dont nous avons besoin ? La réponse est difficile à donner. Elle peut-être mal comprise. Même Dieu peut être changé en objet d’une préoccupation finie ; en quelque chose à laquelle croient certaines personnes et d’autres pas. Un tel Dieu, bien sûr, ne peut nous préoccuper d’une manière ultime. C’est une personne, semblable aux autres personnes, avec lesquelles il est utile d’être en relation. Une personne comme celle-là peut être l’objet d’une préoccupation finie, mais jamais celui d’une préoccupation infinie.
La seule chose nécessaire – c’est la première réponse et d’une certaine façon la dernière que je peux donner – c’est d’être préoccupé ultimement, inconditionnellement, infiniment. Marie l’était ainsi. Marthe l’a senti et s’est mise en colère. Jésus a loué en Marie. On ne peut pas dire grand chose de Marie et c’est bien peu en regard de tout ce qu’on peut de Marthe. Marie était infiniment préoccupée. C’est la seule chose nécessaire
Si sous l’emprise et la passion d’une de cette préoccupation ultime, nous considérons l’ensemble de nos préoccupations finies – le domaine de la vie Marthe – tout semble être ce qu’il était et pourtant tout a changé. Nous sommes encore préoccupé par beaucoup de choses, mais différemment – l’angoisse est partie! Elle existe encore et elle tente de revenir, mais sa puissance est brisée. Elle ne peut plus nous détruire. Celui qui est saisi par la seule chose nécessaire a toutes les autres sous ses pieds. Elles le préoccupent, mais pas de manière ultime. Quand il les perd, il ne perd pas la seule chose qui lui est nécessaire ; elle ne peut lui être retirée.
Paul Tillich
Le salut universel, une prédication de Paul Tillich sur Matthieu 27, 45- 46 et 50-54
Matthieu 27, 45- 46 et 50-54
Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix : « Eli, Eli, lema sabaqthani » , c’est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » … 51 Jésus poussa un grand cri et rendit l’esprit. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d’en haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les tombeaux s’ouvrirent, les corps de beaucoup saints endormis se réveillèrent. 53 Sortis des tombeaux, après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. 54 Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d’une grande crainte et dirent : « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. »
Dans les récits de la crucifixion l’agonie et la mort de Jésus sont mis en relation avec une série d’événements dans la nature. Des ténèbres couvrent le pays ; le rideau du temple se déchire en deux, la terre tremble et des corps de saints se sortent de leurs tombes. La nature participe en tremblant à l’événement décisif de l’histoire. Le soleil se voile la tête ; le temple accomplit un geste de deuil ; les fondements de la terre sont ébranlés ; les tombeaux s’ouvrent. La nature est bouleversée parce que quelque chose se produit qui concerne l’univers.
Depuis le temps des évangélistes, partout où l’histoire du Golgotha a été raconté comme l’événement décisif du drame mondial du salut, on a aussi raconté le rôle joué par la nature dans ce drame. Les peintres de la crucifixion ont fait usage de puissance expressive de leur art pour représenter avec des couleurs presque étrangères à la nature les ténèbres recouvrant la terre. Je me souviens de ma plus lointaine impression personnelle du Vendredi saint ; c’était le sentiment d’une mystérieuse souffrance divine dans la compassion de la nature. Ce sentiment fut celui du centurion, le premier païen à rendre témoignage au crucifié. Saisi de crainte, pris d’un effroi sacré, il a compris à la foi naïvement et profondément que venait de se produire quelque chose de plus que la mort d’un saint et d’un innocent.
Inutile de se demander si des nuages ou une tempête de poussière a obscurci le soleil un certain jour d’une certaine année, ou si un tremblement de terre est survenu en Palestine précisément à moment-là, si rideau devant le saint des saints du temple de Jérusalem a été réparé et si les corps des saints sont morts de nouveau. Nous devrions plutôt nous demander avec les évangélistes et les peintres, avec les enfants et les soldats romains, si l’événement du Golgotha est un évènement qui concerne l’univers, la nature entière et toute l’histoire. Ces questions présentes à l’esprit, considérons les signes relatés par notre évangéliste.
Le soleil se voile la face devant le mal profond et devant la honte qu’il voie sous la croix. Le soleil se voile aussi parce que son pouvoir sur le monde prend fin une fois pour toutes en ces heures de ténèbres. Le dieu éclatant et brûlant de tous les vivants de la terre, le soleil adoré par une multitude d’hommes de millénaires en millénaires, a été dépossédé de sa puissance divine lorsqu’un homme en agonie ultime est resté uni à ce qui est plus grand que le soleil. Depuis ces heures de ténèbres, il est devenu manifeste que l’image du Très haut n’est plus le soleil mais le douloureux combat d’une personnen que les toutes les forces de l’univers n’ont pu briser. On ne peut désormais louer le soleil qu’à la façon de Saint François d’Assise, qui l’appelait notre frère et non pas notre dieu.
« Le voile du temple se déchira en deux ». Le temple a déchiré son vêtement comme un pleureur en grand deuil parce que celui auquel appartenait le temple plus qu’à quiconque a été rejeté et tué par les serviteurs du temple. Le temple – avec lui tous les temples sur la terre – se lamente sur son destin. Le rideau qui faisait du temple un lieu saint séparé de tout autre lieu a perdu son pouvoir de séparation. Celui qui a été éliminé comme blasphémateur a déchiré le rideau et il ouvert le temple à tout le monde et à tout moment. Personne ne pourra réparer ce rideau, malgré les prêtres, les pasteurs et les gens pieux qui s’efforcent de le raccommoder. Ils n’y réussiront pas, parce que celui pour qui tout lieu est un lieu saint, un lieu où Dieu est présent, à été mis en croix au nom du lieu saint. Quand le rideau du temple a été déchiré en deux, Dieu a jugé la religion et rejeté les temples. Les temples et les églises ne peuvent être après que des lieux de méditation sur la sainteté qui fonde et donne un sens à tout lieu. Comme le temple, la terre a été jugée au Golgotha. Avec craintes et tremblements, elle a participé à l’agonie de l’homme sur la croix et au désespoir de ceux qui voyaient en lui le commencement d’un âge nouveau. Ses craintes et ses tremblements montrent qu’elle n’est plus le sol maternel sur lequel fonder en toute sécurité maisons, cités, cultures et systèmes religieux. Ses craintes et ses tremblements de la terre désignent un autre sol, celui lequel la terre elle-même repose : l’amour sans réserve sur lequel se concentre l’hostilité de tous les pouvoirs et de toutes les valeurs terrestres sans pouvoir le vaincre. Depuis cet instant où Jésus lança son grand cri, où il respira une dernière fois, où les rochers se fendirent, la terre a cessé d’être le fondement de tout ce nous construisons à sa surface. Tout cela ne subsiste qu’à condition de plonger ses racines dans le fondement même où la croix est enracinée.
La terre ne cesse pas seulement d’être le fondement solide de la vie, elle cesse aussi d’être l’antre dernier de la mort. La résurrection n’est pas quelque chose d’ajouté à la mort de celui qui est le Christ, elle est impliquée dans sa mort, comme l’indique dans l’histoire de la résurrection avant la résurrection. Désormais l’univers n’est plus soumis à la loi de la mort surgissant de la naissance. Il est soumis à une loi plus haute, à la loi de la vie surgissant de la mort par la mort de celui qui représentait la vie éternelle. Les tombeaux se sont ouverts et les corps se sont levés quand l’homme en qui Dieu était présent sans limite a remis son esprit entre les mains de son Père. Depuis ce moment, l’univers n’est plus ce qu’il était, la nature a reçu une autre signification ; l’histoire a été transformée et vous et moi aussi. Nous ne sommes plus maintenant ce que nous aurions été.
Paul Tillich
Le Messie est-il venu ? une prédication de Paul Tillich sur Luc 2:25-32
Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l’Esprit saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et comme les parents apportaient l’enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d’après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s’en aller en paix selon ta parole, car les yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation des nations et gloire de ton peuple Israël. Luc 2, 25-32
Se tournant vers ses disciples, il leur dit en privé : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que, vous, vous regardez, et ils ne l’ont pas vu ; ils ont voulu entendre ce que vous entendez, et ils ne l’ont pas entendu. Luc 10, 23-24.
Il y a quelques jours, j’ai eu une conversation avec un ami juif sur l’idée de Messie dans le Judaïsme et dans le Christianisme. Finalement, nous avons formulé la différence d’une manière très semblable au choix devant lequel les disciples de Jean-Baptiste placèrent Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Nous étions d’avis que les juifs cherchent quelqu’un d’autre, alors que les chrétiens affirment que « Celui qui doit venir » est déjà venu. Les chrétiens disent avec Siméon : « Nos yeux ont vu son salut ». Les Juifs répliquent : « Nous n’avons pas vu son salut, nous l’attendons. » Les chrétiens se sentent bénis – selon les mots de Jésus – parce qu’ils ont vu la puissance salvatrice dans le monde et dans l’histoire. Les Juifs considèrent un tel sentiment comme un blasphème, parce que, selon leur foi, rien de ce qu’ils s’attendent à voir arriver l’âge messianique ne s’est effectivement produit. Et, quand nous défendons notre foi chrétienne, ils font valoir que le monde ne s’est pas amélioré depuis les jours d’Osée et de Jérémie, que les Juifs, et avec eux la plus grande partie de l’humanité, ne souffrent pas moins qu’il y a deux mille ans ; que les visions de jugement des prophètes s’avèrent plus réalistes qu’elles l’étaient de leur temps. Il est difficile de répondre à cela, mais nous devons répondre, car non seulement les Juifs mais d’innombrables chrétiens et de non chrétiens, nos amis et nos enfants, et nous-même, posons souvent ces questions.
Il est difficile de leur donner une réponse. Que pouvons-nous répondre à nos enfants, quand ils nous demandent, au sujet de l’enfant de la crèche, par exemple, pourquoi, dans certaines parties du monde, « tous les enfants de deux ans et au dessous » sont morts, ou sur le point de mourir, non sur ordre d’Hérode, mais à cause de la cruauté grandissante de la guerre et du manque croissant d’initiative du peuple chrétien? Ou, que pouvons-nous répondre aux juifs, quand les rescapés de camps de concentration, pires que n’importe quoi à Babylone, ne peuvent trouver un lieu de paix sur terre, et certainement pas dans les grands pays chrétiens?
Que répondre aux chrétiens, ou aux non chrétiens, réalisant que le fruit de siècles de civilisation technicienne et chrétienne est la menace imminente d’une autodestruction totale et universelle de l’humanité ? Et quelle réponse pouvons-nous nous donner quand nous voyons l’état inguérissable et la déchéance de nos vies après que le message de guérison et de salut ait été écouté chaque Noël, depuis près de deux mille ans?
Devons-nous say : le monde, bien sûr, n’est pas sauvé, mais en chaque génération des hommes et des femmes sont sauvés du monde ? Mais, ce n’est pas le message de Noël ! Dans la légende de Noël, tous ceux, qui attendent le Christ et accueillent le divin, recherchent le salut d’Israël, celui des païens et celui du monde. Pour eux tous, comme pour Jésus lui-même et pour les apôtres, le Royaume de Dieu, le salut universel, est à portée de la main. Mais si telle a été l’attente, n’a t-elle pas été complètement réfutée dans la réalité ?
La question est aussi vieille que le message chrétien lui-même et la réponse également aussi vieille, comme le montre notre texte. Jésus prend ses disciples à part pour leur parler et c’est en privé qu’il les loue d’avoir vu ce qu’ils voient. La présence du Messie est un mystère, elle ne peut être visible de tout le monde, mais seulement de ceux qui, comme Siméon, sont dirigés par l’Esprit. L’apparition du salut a quelque chose de surprenant et d’inattendu. Le mystère du salut est le mystère d’un enfant. Ainsi Esaïe le préfigurait, ainsi la Sibille le voyait en extase, Virgile en poète ; ainsi les religions à mystères le célébraient dans la naissance du nouvel éon leurs rites. Tous, comme les premiers chrétiens, sentaient que l’événement du salut, est la naissance d’un enfant. Un enfant est réel et ne l’est pas encore. Il est dans l’histoire, sans être déjà historique. Sa nature est visible et invisible. Il est là et ne l’est pas encore. C’est exactement la caractéristique du salut. Le salut a la nature d’un enfant.
Comme les chrétiens s’en souviennent chaque année, en fêtant avec solennité à Noël la naissance de l’enfant Jésus : si visible qu’il puisse être, le salut reste invisible. Celui qui veut un salut seulement visible ne peut voir l’enfant divin dans la crèche, ni la divinité de l’homme en croix, ni le cheminement paradoxal de l’action de Dieu. Le salut est un enfant ; quand il grandit, il est crucifié. Celui qui voit la puissance sous la faiblesse, la partie dans le tout, la victoire sous la défaite, la gloire sous la souffrance, l’innocence sous la faute, la sainteté sous le péché, la vie sous la mort, celui-là seul peut dire : « Mes yeux ont vu ton salut »
Il est difficile de dire cela de nos jours. Mais il en a toujours été ainsi. Ce fut, c’est et ce sera un mystère, le mystère d’un enfant. Aussi profond que le monde puisse tomber, même dans l’autodestruction le plus complète, tant qu’il y aura des hommes, ils feront l’expérience de ce mystère et diront : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! ».
Paul Tillich
Les prédications de Paul Tillich sur ce site :
- Paul Tillich : 4 Prédications sur le sens de l’existence et l’Être nouveau
- Paul Tillich : 3 prédications pour trouver la Joie et le Sens dans la Profondeur de l’Existence
- Paul Tillich : 3 Prédications sur le Mystère du Temps et la Signification de l’Éternel Maintenant
- Paul Tillich : 5 Prédications sur Romains 8 pour une spiritualité de l’être
Notes :
- 1. Texte n° 2 de l’édition anglaise, p. 15 à 24.
- 2. Nouvelle traduction Segond
- 3. Paul Tillich fait référence à la lecture précédemment faite du contexte du verset qu’il cite
- 4. 2 Corinthiens 5, 17. La NTS propose la traduction: Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une créature nouvelle. Ce qui est ancien est passé ; il y a du nouveau.
- 5. Paul Tillich cite implicitement 2 Corinthiens 5, 20.
- 6. Amor fati. NDR.
- 1. Concern. On a retenu la traduction « préoccupation » plutôt que celle de « souci » adoptée par le premier traducteur de la Théologie Systématique, sous l’influence de la philosophie de Martin Heidegger.
- 2. Anxiously, peut être traduit : anxieusement, avec inquiétude, avec impatience.
- 3. Anxiety, peut être traduit avec les mots : inquiétude, anxiété, angoisse.
- 4. Citation implicite de Marc 13, 1 et 2.
- 5. Aux Etats-Unis. NDT
- 1. Cette prédication est la vingt-troisième et dernière du recueil l’Être nouveau.
- 2. Traduction de la Nouvelle Bible Segond.
- 3. éon.
- 4. Self surrending love, littéralement : l’amour s’abandonnant soi-même, c’est l’agapè chanté dans 1 Corinthien 13. Note du traducteur.