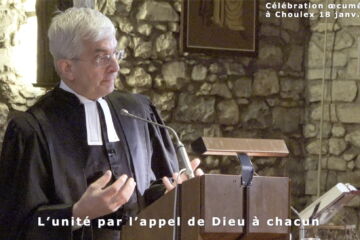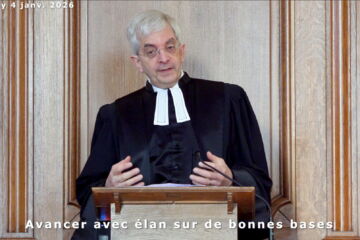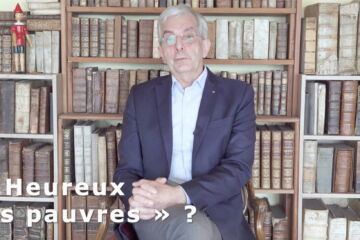Une bonté provocatrice (Matthieu 20:1-16)- prédication par le professeur Andreas Dettwiler (Université de Genève)
Les paraboles de Jésus,sont toujours une histoire de notre monde, et nous posant des questions. Celle-ci choque notre idée de justice, pour mieux nous ouvrir à la bonté, à l’image de Dieu.
Texte, vidéo et poscasts de la prédication. Ceci est un témoignage personnel. N’hésitez pas à donnez votre propre avis ci-dessous.
Podcast audio de la prédication / Podcast audio du culte
(Voir le texte biblique ci-dessous)
prédication (message biblique donné au cours du culte)
à Genève, le dimanche 23 février 2025,
par Andreas Dettwiler, Professeur de Nouveau Testament à l’UNIGE
Prédication
Le récit raconté par Jésus lui-même que l’on nomme habituellement la parabole des ouvriers de la 11e heure ou encore la parabole des ouvriers dans la vigne nous est relayée uniquement par l’évangile de Matthieu. Cette parabole est encadrée au début et à la fin par une parole bien connue, mais qui reste quelque peu énigmatique : « Beaucoup de premiers seront les derniers et de derniers qui seront les premiers » (Mt 19,30) ; puis : « Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers derniers » (Mt 20,16).
Avant de nous plonger dans le monde du récit biblique, une remarque générale s’impose. En fait, les paraboles de Jésus – ces petits récits inventés par le maitre de Nazareth qui parlent de Dieu sans pour autant le mentionner explicitement – ne nous propulsent pas vers un monde hors de notre expérience, hors de notre portée. Le monde déployé par les récits de Jésus est un monde profane, un monde non pas peuplé par des entités surnaturelles comme des anges ou des démons, mais un monde ordinaire, familier aux contemporains de Jésus. Tout ce qui se passe dans le monde des paraboles aurait pu se passer ainsi ; rien de ce qui se dit ne transcende de manière fondamentale le monde que nous habitons. Les paraboles ne nous amènent pas vers un monde fantaisiste ou métaphysique qui se cacherait mystérieusement derrière le monde que nous connaissons. Ce constat est d’une grande portée théologique : Jésus ne demande pas de nous un effort intellectuel difficile pour accéder à son message, ni une confession de foi correcte préalable, et encore moins le sacrifice de notre intelligence pour nous amener sur le chemin de la foi. Les paraboles de Jésus ont ceci de particulier qu’elles s’inscrivent au cœur de notre quotidien afin de nous surprendre là où nous vivons, avec notre vision du monde, nos soucis, nos angoisses, nos espoirs, mais aussi nos perplexités et nos illusions.
Regardons alors de plus près ce récit et soyons attentifs à comment il évolue et à quel moment et pourquoi il nous surprend. Notre récit nous amène vers le monde paysan du judaïsme de l’époque, probablement en Galilée. Il s’agit du monde familier des contemporains du Christ. Avant le lever du soleil, autour de six heures du matin, un paysan va sur la place du village afin d’engager quelques ouvriers pour travailler dans sa vigne. Le récit reflète bien la réalité sociale de l’époque. Comme l’a bien dit un commentateur de ce passage : « Dans la viticulture, il était courant d’embaucher des journaliers en période accrue de main-d’œuvre, notamment lors des vendanges à la fin de l’été et lors de la taille de la vigne en hiver » (Matthias Konradt 2023, 325). Notre vigneron commence à négocier avec quelques-uns des journaliers et conclut avec eux un contrat de travail d’une journée pour une pièce d’argent, le salaire habituel de l’époque pour un travail manuel. Avec une pièce d’argent, on pouvait s’acheter une dizaine de pains de taille plutôt modeste, avec trois ou quatre pièces d’argent entre12 et 15 kilos de farine ou un agneau. Le salaire convenu entre notre vigneron et les journaliers est donc décent, sans être particulièrement élevé ; il assure ce qui est nécessaire pour vivre correctement et nourrir une famille.
Trois heures plus tard, le propriétaire sort à nouveau pour engager d’autres personnes. Nous aimerions bien savoir ce qu’il leur promet comme salaire, mais le récit reste discret, ne parlant que d’un juste salaire : « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste ». A partir de ce moment, nous commençons à nous interroger pour la première fois. En effet, le propriétaire sort encore deux fois, une fois à midi, et encore une fois à trois heures de l’après-midi. C’est bien étrange. Les commentateurs de notre récit ont vite proposé des solutions. On a par exemple dit que toute personne supplémentaire serait bienvenue pour terminer les vendanges avant que la pluie automnale en Palestine ne commence ! On a aussi suggéré que notre vigneron aurait simplement mal calculé le volume du travail. Mais le texte biblique reste silencieux. Il ne nous donne aucun indice sur les motivations du comportement assez étrange du vigneron.
Notre étonnement ne cesse d’augmenter avec la suite des événements. Car le vigneron retourne une dernière fois sur la place du marché, à la 11ème heure, donc vers cinq heures de l’après-midi. Une telle attitude est très étrange puisqu’elle contredit toute logique économique. Un petit dialogue s’installe entre le propriétaire de la vigne et les personnes sans emploi qui se trouvent encore sur la place du marché à cette heure. Le récit ralentit un instant : « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour, sans travail ? » Réponse lapidaire : « C’est que personne ne nous a embauchés » – « Eh bien ! allez, vous aussi, à ma vigne ! ». De nouveau, les commentateurs bibliques ont essayé de trouver des réponses au sujet de ces personnes. S’agit-il des personnes âgées ou de malades que personne ne voulait engager ? ou bien de lève-tard qui ont raté leur chance ? Nous ne le savons pas. Il vaut mieux respecter le silence du récit à cet endroit. Ce qui intéresse avant tout le narrateur, c’est le contraste entre les personnes qui ont été engagées le matin et celles qui l’ont été à la fin de la journée, entre les « premiers » et les « derniers ».
Vers la fin de la journée, lors du coucher du soleil, a lieu la paie. Et là, c’est la grande surprise ! L’intendant du maitre de la vigne commence à rembourser d’abord ceux qui ont commencé le travail à cinq heures de l’après-midi et leur paye exactement le même montant que celui qui a été convenu avec les ouvriers de la première heure. Ceux là « pensèrent qu’ils allaient recevoir davantage », comme dit le texte. Mais il n’en est rien, ils reçoivent le montant qui a été convenu avec eux tôt le matin : « ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’argent ».
Le comportement étrange du maître de maison suscite de vives protestations : « Ces derniers venus n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur ». N’auraient-ils pas raison, au moins un peu ? Le comportement étrange du propriétaire ne semble-t-il pas injuste ? Ne met-il pas en question le sentiment de justice et d’équité en matière de salaire, à savoir la corrélation entre la durée du travail et le montant du salaire ? Un tel comportement du maître ne met-il pas fondamentalement en question la notion même de salaire ?
Le propriétaire de la vigne ne fuit pas le débat, au contraire. Il se positionne à l’égard des ouvriers de la première heure qui se sentent injustement traités. En regardant de plus près, le propriétaire avance trois arguments pour défendre sa position et ainsi permettre aux protestataires de revoir leur sentiment d’injustice. Ses arguments sont basés sur sa compréhension de la justice d’abord, puis sur celle de la liberté, et enfin sur celle de la bonté.
Le premier argument du maitre de maison est formel, basé sur la justice : « Mon ami, je ne te fais pas de tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’une pièce d’argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t’en ! ». Le maitre de maison se réfère, lui aussi, à un principe de justice. Il a respecté le contrat qu’il a conclu tôt le matin. Au sentiment de l’injustice des ouvriers de la première heure, le maître oppose un argument qui, formellement, est parfaitement juste et correct.
Le deuxième argument du maitre met en avant sa totale liberté sur les biens qui lui appartiennent : « Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? » La réponse implicite à cette question ne souffre aucun doute (et la formulation de la phrase en grec le confirme) : bien entendu que oui ! En tant que propriétaire, je peux disposer en toute liberté de mes moyens financiers ; je n’ai de compte à rendre à personne. Un auditeur, une auditrice de l’Antiquité aurait sans autre accepté cet argument.
C’est le troisième et dernier argument pourtant qui suscite tout notre intérêt – et ce n’est pas par hasard que Jésus place cet argument tout à la fin de son récit : « Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? ». L’expression de « l’œil mauvais » – ou son opposé, « l’œil sain » – se trouve régulièrement dans la littérature du judaïsme de l’époque. Elle dit que le caractère de l’être humain se révèle dans son regard (cf. Konradt 2023, 130). L’œil sain désigne alors l’honnêteté, la sincérité ou encore la bonté de l’être humain, tandis que « l’œil mauvais » représente l’envie, l’avarice ou encore la jalousie. Nous pourrions alors paraphraser la question du maitre de la vigne comme suit : « pourquoi es-tu rongé par la jalousie en te comparant avec les autres ? Pourquoi est-ce que tu ne supportes pas que j’agisse par pure bonté aux derniers venus ? ». Nous touchons ici au cœur du récit – qui, en fait, est le cœur de l’Évangile – en nous posant la question suivante : d’où vient cette bonté et quelle est sa nature ?
Le texte ne nous donne aucune réponse. Et c’est précisément cette absence d’une explication rationnelle qui nous invite à découvrir le cœur du message. La bonté dont il est question ici ne réagit pas à un élément qui le précède, que ce soit l’investissement extraordinaire des travailleurs, ou leur qualité morale ou leur ferveur religieuse, ou que sais-je. La bonté dont il est question ici n’est pas réactive, mais entièrement active, créative. Elle a sa raison d’être et sa finalité en soi. Elle advient, soudainement, de manière tout à fait surprenante, on ne sait pourquoi. Elle est pure donation, gratuité débordante, grâce imméritée. Angelus Silesius, un poète de langue allemande de l’époque baroque (1624-1677) a bien saisi l’expérience d’une telle bonté. Il la compare à une rose qui fleurit, on ne sait pourquoi : La rose est sans pourquoi / Elle fleurit parce qu’elle fleurit / Elle ne se soucie pas d’elle-même / Ne se demande pas si on la voit (in : Cherubinischer Wandersmann I, 289). Ainsi en est-il de la bonté, de la grâce. Au milieu de notre monde, avide de performance et de reconnaissance, séduit par la puissance des maitres auto-proclamés, surgit une tout autre puissance, celle d’une bonté gratuite, à la manière d’une rose qui fleurit parce qu’elle fleurit et qui étale discrètement sa grâce, son charme, à quiconque veut bien être attentif.
Mais cette bonté qui porte sa raison d’être en soi et qui échappe à tout calcul ne reçoit pas uniquement un accueil favorable. Comme le montre notre parabole, elle provoque aussi de l’incompréhension et de la résistance. « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? », dit le Seigneur (le κύριος) de la vigne (v. 8) aux ouvriers de la première heure. Leur sentiment de jalousie, et peut-être plus encore leur sentiment d’être injustement traité, ne leur permet pas de s’étonner de la bonté et de la miséricorde du propriétaire de la vigne et de se réjouir avec les autres ouvriers, ceux venus en dernier. Par leur attitude pleine de ressentiment et en s’enfermant dans leur murmure – comme la génération de l’ancien Israël lors de la traversée du désert (cf. Ex 15,24 ; 16,2 ; Nb 14,2 ; Ps 106,25 ; etc.) –, ils se mettent eux-mêmes en marge. Bien entendu, il est facile de dénoncer leur sentiment de jalousie, voire de se moquer de leur petitesse et de leur aveuglement. Mais soyons prudents de ne pas les juger hâtivement. Il se pourrait que leur aveuglement ne soit que le reflet de notre aveuglement et de notre manque d’accueil. Il me semble que la parabole nous invite aussi à nous demander si nous sommes à la hauteur de la bonté dont parle notre récit. Nous connaissons l’avertissement que Jésus a adressé aux hommes et aux femmes qui avaient décidé de le suivre : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? […] » (Mt 7,3-5).
Qui est Dieu ? Et comment se manifeste-t-il à ses disciples et, à travers la communauté de ses disciples, au monde, aux humains ? Dieu n’apparaît pas explicitement dans notre parabole des ouvriers de la vigne. C’est précisément le propre du langage allusif et indirect de la parabole de ne pas parler directement de Dieu. Et pourtant, notre récit, du début à la fin, est saturé de l’expérience d’un Dieu qui est présent au monde, d’un Dieu dont la bonté échappe à tout calcul et à toute maitrise, d’un Dieu libre qui suscite notre liberté, d’un Dieu qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes » (Mt 5,45). Le chemin que nous sommes invités à prendre est celui de la foi à l’égard de Dieu et de l’amour à l’égard du prochain. Martin Luther, à la fin de son célèbre traité « De la liberté du chrétien », a décrit ce chemin de la manière suivante – et c’est avec ces paroles du réformateur allemand que j’aimerais terminer ma méditation :
« […] un chrétien ne vit pas en lui-même, mais dans le Christ et dans son prochain, dans le Christ par la foi, dans son prochain par l’amour : par la foi il s’élève au-dessus de lui-même en Dieu, de Dieu il redescend en-dessous de lui-même par l’amour, et demeure cependant toujours en Dieu et en l’amour divin, comme le dit le Christ, [dans l’évangile de] Jean 1 : ‘Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l’Homme’. Vois, telle est la véritable liberté chrétienne, la spirituelle, qui libère le cœur de tout péché, loi et commandement et qui dépasse toute autre liberté comme le Ciel dépasse la Terre. Que Dieu nous donne de bien la comprendre et la conserver, AMEN. »
Textes de la Bible
Évangile selon Matthieu 20:1-16
Le Royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison qui sortit de grand matin, afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 2Il convint avec les ouvriers d’une pièce d’argent pour la journée et les envoya à sa vigne. 3Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres qui se tenaient sur la place, sans travail, 4et il leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste.” 5Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de même. 6Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d’autres qui se tenaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour, sans travail ?” – 7“C’est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne.” 8Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers, et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” 9Ceux de la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d’argent. 10Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu’ils allaient recevoir davantage ; mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’argent. 11En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison : 12“Ces derniers venus, disaient-ils, n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur.” 13Mais il répliqua à l’un d’eux : “Mon ami, je ne te fais pas de tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’une pièce d’argent ? 14Emporte ce qui est à toi et va-t’en. Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. 15Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?” 16Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers.
(Traduction Œcuménique de la Bible)
Articles récents de la même catégorie
-

-

-

Articles récents avec des étiquettes similaires
-

-

-