Paul Tillich est l’un des théologiens les plus influents du XXe siècle, il est une figure de proue de la théologie existentialiste. Son concept du « Ground of Being » (le fondement de l’être) résonne particulièrement aujourd’hui, alors que la recherche de sens se détache des structures dogmatiques rigides. À travers trois prédications majeures, il explore le passage de la vie superficielle à la profondeur de l’existence, définissant la joie véritable non comme un plaisir éphémère, mais comme l’accomplissement de notre être au contact du divin.
Une introduction à cette série de prédications de Paul Tillich
Les trois prédications réunies ici sous le titre : Trois sermons sur la joie, sont extraites de The Shaking of the Foundation pour La profondeur de l’existence ; de The New Being pour Le sens de la joie et de The Eternal Now pour Remerciez…
La quête de profondeur dans la spiritualité
Le sermon sur la « profondeur (1) » de Paul Tillich eut son moment de célébrité quand la recherche d’ « autres » théologies ébranlait la quasi-hégémonie de théologiens « barthiens » sur les facultés de théologie et les instances ecclésiastiques du Protestantisme français. Hormis quelques travaux de traduction, et d’introduction, de théologiens autour de la faculté de théologie de Strasbourg (2), l’œuvre de Paul Tillich était ignorée, voire suspectée d’ « hérésie », un mot alors redoutablement à la mode. C’était l’horreur de la religion réputait un « barthien » très zélote ! Un même sort fut réservé à Rudolf Bultmann et de façon paradoxale à Karl Barth lui-même, dont l’œuvre n’était connue que d’après quelques opuscules catéchétiques, alors que depuis 1953 les nombreux volumes de la traduction française de sa Dogmatique paraissaient régulièrement. On s’occupait plus d’opinion correcte que de vérité.
En 1963-1964, parut à Londres un ouvrage très discuté de l’évêque anglican de Woolwich, John Arthur Thomas Robinson (3) sous le titre d’Honest to God. Son édition à fort tirage eut en quelques mois plus d’exemplaires que le très classique The Pilgrim’s Progress de John Bunyan (4). L’idée qu’on devrait être « honnête » avec Dieu faisait soudainement « tilt » dans les esprits largement Outre-Manche, beaucoup moins ici ! L’ouvrage fut presque aussitôt traduit en français, et non sans véhémence, par un grand éditeur protestant francophone. Il sera traduit et publié plus tard par une plume et un éditeur du catholicisme intransigeant, au titre, sans doute, d’avertissement devant les dangers du Protestantisme, en des temps, par ailleurs, de bienveillance œcuménique.
Exégète de formation, J. A. T. Robinson s’étonna du succès d’un livre vulgarisant par de larges citations les œuvres de Bultmann, de Bonhoeffer et de Tillich. Le sermon La Profondeur de l’existence rencontra là plus de lecteurs que dans Les fondations sont ébranlées. Les maîtres vigilants du Protestantisme se tenaient à l’écart de débats dont il fallait préserver leurs ouailles. Seul un petit groupe d’étudiants de la Fédération française des associations chrétiennes d’étudiants, fasciné par quelques Lettres de prison de Bonhoeffer et par l’idée qu’une théologie séculière allait régler tous les problèmes connus et à venir, entra en lice avec les maîtres régnants à Paris. Trois numéros de leur revue Le Semeur (6), se firent l’écho des interrogations de cette petite « avant-garde » qui n’avait lu, en théologie, qu’un peu de Barth, de Calvin, et de Luther. C’était alors la situation théologique commune dans l’Hexagone ! Le lecteur averti mesure aujourd’hui le chemin parcouru. Il se demande : Pour quel gain ? Un petit gain, sans doute, de liberté, mais plus peut-être pour la facilité, le négligé. Depuis, on s’est rabattu sur l’histoire, ou la sociologie, pour éviter, quoi ? La théologie ? Reste que la liberté de l’esprit prit des voies inattendues. Il est juste de rendre hommage aux théologiens et aux éditeurs catholiques sans lesquels la recherche théologique protestante serait restée, au mieux confidentielle, à commencer par l’œuvre de Paul Tillich.
Comme la plupart des sermons de Paul Tillich, ce dernier est l’une des clés de sa pensée. Quelques lignes empruntées à la biographie de Renate Albrecht – sa traductrice allemande – et de Werner Schüssler, le rappellent opportunément : Quand on lui demandait quel était le meilleur moyen d’entrer à fond dans son œuvre, il répondait : « Lisez d’abord mes sermons ». Il passait beaucoup plus de temps à préparer ses sermons que ses conférences ; il les mettait toujours par écrit mot pour mot. Il prêchait, en partie, parce qu’il y était tenu dans le cadre de son activité professorale, en partie à l’invitation des églises de New York, de Cambridge, ou du dehors. (7)
On a supposé que son usage de la métaphore de la profondeur n’était qu’un procédé spéculatif repris des thèmes classiques de la philosophie « chrétienne ». Quelques lignes du sermon pourraient le laisser supposer, notamment celle-ci, à première vue simplificatrice : Le nom de cette profondeur et de ce fondement infini et inexhaustible est Dieu. Le mot Dieu désigne cette profondeur. Mais le langage théologique de Tillich ne s’est pas construit méthodiquement en l’absence de l’objet singulier dont il parlait, pour de simples raisons démonstratives, propres à son souci de trouver un terrain d’entente avec des auditeurs devenus étrangers aux discours ecclésiastiques conventionnels. Tillich souhaitait être à la fois « édifiant » et « intelligent », non à partir d’un raisonnement prétendument universel, mais à partir de la « révélation ». Aussi, n’est-il, sur le fond, aussi éloigné qu’on l’a dit de son contemporain Karl Barth, l’ami de l’autre bord (8) ? La recherche d’une « entente » qui guide la rhétorique des prédications, autant que la rédaction des œuvres académiques suppose d’emblée ce qui ne sort pas tout armé du cœur ou de la raison humaine et qui a son « lieu » dans l’histoire. En avant-propos du numéro du Semeur, cité précédemment, Jean Beaubérot observait alors, – pieu désir ! – …la Théologie protestante ne progresse pas dans sa réflexion dans un monologue à voix alternée avec elle-même (9). Ce serait maintenir un malentendu que d’imaginer que la théologie de Tillich s’est construite sur la base d’un système philosophique préalable à sa théologie. Entrer dans la pensée d’autrui pour nouer un dialogue, ne suppose pas qu’on abandonne sa position de témoin de l’automanifestation de Dieu. Déjà en 1922, il affirmait : …c’est Dieu et non pas la religion qui est le commencement, la fin, le centre de toutes choses, et que toute religion et toute philosophie se perdent si elles quittent le sol de la parole : Impossibile est, sine deo discere deum. Dieu ne peut être connu qu’à partir de Dieu. (10) Dieu et non pas la religion ! Est-ce du Barth ou du Tillich ? Comme les autres théologiens de sa génération Tillich ne parle pas d’un dieu cueilli à la surface des « opinions » communes, comme un produit de l’évolution de l’humanité, mais de celui qui « saisit » l’humain. Affirmer que Dieu se rencontre dans les profondeurs suppose qu’on prenne conscience du tremblement de terre qui a secoué les théologies antérieures, libérales et orthodoxes, d’ecclésiastiques ou de francs tireurs. Nul n’aura à choisir entre une pensée de perroquet ou une pensée de nigaud, seul importe de creuser vers Dieu, disait le poète Jean-Paul de Dadelsen, ou encore : C’est agaçant, l’esprit n’apporte rien, ne trouve rien, simplement cherche (11). Grégoire de Nysse lui fait écho : Ce serait l’objet d’une longue recherche de savoir comment vient celui qui est toujours présent (12). Creuser suppose le terrain où l’on creuse, ici la culture, mais nullement ce qu’on peut découvrir : le trésor caché. La prédication de Paul Tillich est la clé de sa théologie, parce qu’elle nous présente ses leçons de terrassement à la recherche de Dieu.
Jean-Marc Saint (théologien, psychanalyste, auteur, traducteur)
Notes
1. Ce sermon a d’abord été publié sous le titre Profondeur dans la revue Christendom de New York en été 1944 ; puis il a été réimprimé sous celui de La profondeur de l’existence dans The Shaking of the Foundations, p. 52-63.
2. Religion biblique et ontologie est publié en 1959 par la Revue d’histoire et de philosophie religieuse, dans une traduction de Jean-Paul Gabus, et Amour, pouvoir justice, en 1963 par la même publication dans une traduction de Théo Junker. En 1969 Jean-Paul Gabus publie une Introduction à la théologie de la culture de Paul Tillich, sa thèse de doctorat en sciences en religieuses.
3. 1919-1983.
4. 1628-1688.
5. Dietrich Bonhoeffer : Résistance et Soumission, en particulier les pages 321-322, 336 à 340 ; 352-353 ; 355 à 357 et 371-372.
6. La théologie protestante aujourd’hui, Le Semeur, n°3 avril-mai 1962.
7. Paul Tillich : Documents biographiques, p.236.
8. Karl Barth : L’humanité de Dieu, page 17.
9. P.5.
10. Paul Tillich : Le dépassement du concept de religion en philosophie de la religion, dans : La dimension religieuse de la culture, p.84.
11. Jean-Paul de Dadelsen, Jonas, p. 120.
12. Cité par Olivier Clément, dans Transfigurer le temps. P. 51
La profondeur de l’existence, une prédication de Paul Tillich sur 1 Corinthiens 2, 10
C’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
1 Corinthiens 2, 10
Depuis les profondeurs, je t’invoque SEIGNEUR !
Psaume 130, 1.
Concentrons notre attention sur un seul verset de la lettre de Paul aux Corinthiens : l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et résumons ce verset avec le mot : « profondeur », sujet de notre méditation.
Concentrons-nous aussi sur un seul verset du Psaume 130 : Depuis les profondeurs, je t’invoque SEIGNEUR, et résumons-le avec le mot « profondeur », sujet de notre méditation.
Les mots « profond » et « profondeur » s’emploient dans la vie quotidienne, en poésie, en philosophie, dans la Bible, et dans beaucoup d’autres documents religieux, pour désigner une attitude spirituelle, bien que ces mots eux-mêmes soient empruntés à l’expérience de l’espace. La profondeur est une dimension de l’espace, et, pourtant, elle est en même temps le symbole d’une qualité spirituelle. Nombre de nos symboles religieux ont ce caractère qui nous rappelle notre finitude et notre asservissement aux choses visibles. Nous sommes et nous restons des êtres liés à leur sens (1), même quand nous nous occupons de choses spirituelles. Il y a, d’autre part, une grande sagesse dans notre langage. Il intègre d’innombrables expériences du passé. Ce n’est pas au hasard que nous employions certains symboles tirés du domaine des choses visibles, plutôt que d’autres. C’est pourquoi il est souvent utile de chercher la raison des choix collectifs des générations précédentes. Cela peut avoir pour nous une signification ultime de découvrir ce qu’implique pour nous l’emploi de mots comme « profond », « profondeur » et « abyssal (2) ». Cela peut nous donner l’impulsion de rechercher notre propre profondeur.
« Profond », au sens spirituel, a deux significations : soit il s’oppose à « superficiel », soit à « élevé (3) ». La vérité est profonde et non pas superficielle ; la souffrance est profonde, et non pas « élevée ». La lumière de la vérité et les ténèbres de la souffrance sont toutes deux profondes. Il y a une profondeur en Dieu, et il y a une profondeur d’où le psalmiste crie vers Dieu. Pourquoi la vérité est-elle profonde ? Pourquoi la souffrance est-elle profonde ? Pourquoi emploie-t-on le même symbole spatial pour les deux expériences ? Ces questions guideront notre méditation.
Toutes les choses visibles ont une surface. La surface est le côté des choses qui nous apparaît en premier. Si nous le regardons, nous savons ce que semblent être les choses. Mais, si nous agissons d’après ce que les choses et les personnes semblent être, nous sommes déçus. Nos attentes sont frustrées. Alors, nous essayons de pénétrer sous la surface des choses afin d’apprendre ce que les choses sont réellement. Pourquoi les hommes ont-ils toujours cherché la vérité ? Parce que la surface les décevait, et qu’ils ont appris que la vérité qui ne déçoit pas réside sous la surface, dans la profondeur. C’est pourquoi les hommes ont creusé niveaux après niveaux. Ce qui leur semblait vrai un jour, ils le trouvaient superficiel le lendemain. Quand nous rencontrons une personne, elle nous fait une certaine impression, souvent nous réagissons en fonction de cette impression, et nous sommes déçus par son comportement effectif. Nous pénétrons un niveau plus profond de son caractère, et, pour quelque temps, nous sommes moins déçus. Mais, vite, cette personne peut faire quelque chose de contraire à nos attentes ; nous réalisons alors que ce que nous connaissons d’elle est encore superficiel. À nouveau, nous creusons plus profondément dans son être véritable.
La Science s’est développée de cette manière. La science met en question les affirmations ordinaires qui semblent vraies aux yeux de tous, des profanes comme des savants. Vient un génie, qui interroge les bases de ces affirmations admises ; quand il a prouvé qu’elles ne sont pas vraies, un tremblement de terre intervient dans la profondeur. Un tremblement de terre de ce genre s’est produit quand Copernic a mis en question qu’on puisse fonder l’astronomie sur les impressions des sens, et quand Einstein a cherché s’il existait un point absolu, à partir duquel le mouvement de toute chose deviendrait visible. Un tremblement de terre s’est produit quand Marx a mis en question l’existence d’une histoire intellectuelle et morale indépendante de ses bases économiques et sociales. Un tremblement de terre très violent s’est produit quand les premiers philosophes (4) mirent en question le sens de l’être-même, considéré de mémoire d’homme comme une évidence. Quand on a pris conscience du fait étonnant que sous tous les faits, il y a quelque chose et non pas rien, la pensée a atteint un niveau de profondeur insurpassable.
À la lumière de ces pas importants et audacieux vers les choses profondes de notre monde, nous devrions nous interroger sur nous-mêmes et sur les opinions qui nous paraissent aller de soi. Et nous verrions en tout cela ce qu’il y a de préjugés découlant de nos préférences individuelles et de notre milieu social. Nous devrions être scandalisés par la découverte que peu de choses dans notre univers spirituel se trouvent au-dessous de la surface, et combien peu résisteraient à un coup de vent. Il se produit quelque chose de terriblement tragique à toutes les périodes de la vie spirituelle de l’humanité : les vérités profondes et fortes, que les plus grands génies ont découvertes au travers de souffrances profondes et d’un travail incroyable, deviennent les banalités superficielles des discussions de tous les jours. Comment cela est-il possible ? Comment se peut-il qu’une telle tragédie se produise ? Elle se produit et se reproduira inévitablement, parce qu’il ne peut y avoir de profondeur sans chemin vers la profondeur. La vérité, sans chemin vers la vérité, est morte ; on peut encore s’y référer, mais elle n’apporte de contribution qu’à la surface des choses. Voyez cet étudiant, qui connaît le contenu des cent livres les plus importants sur l’histoire mondiale, et, cependant, sa vie spirituelle demeure aussi superficielle qu’auparavant, et, peut-être, l’est-elle devenue encore plus. Puis, voyez cet ouvrier sans instruction, qui accomplit jour après jour une tâche machinale, et qui se demande soudain : Qu’est ce que ça veut dire, que je fasse ce travail ? Qu’est ce que ça veut dire dans ma vie ? Quel est le sens de ma vie ? Parce qu’il pose ces questions, cet homme est sur la voie de la profondeur, alors que l’autre, l’étudiant en histoire, demeure à la surface parmi les corps pétrifiés exhumés des profondeurs par un tremblement de terre spirituel passé. Le simple ouvrier peut comprendre la vérité, même s’il ne parvient pas à répondre à ses questions ; l’étudiant instruit peut ne posséder aucune vérité, même s’il connaît toutes les vérités du passé.
La profondeur de la pensée fait partie de la profondeur de la vie. Une grande part de notre vie se déroule à la surface. Nous sommes les esclaves des routines de la vie quotidienne, de notre travail et de nos plaisirs, de nos occupations et de nos distractions. Nous sommes dominés par des hasards innombrables, à la fois bons et mauvais. Nous sommes menés par les choses beaucoup plus que nous ne les menons. Nous n’arrêtons pas de regarder les sommets au-dessus de nous, ou les profondeurs au-dessous de nous. Nous allons toujours de l’avant, bien que nous tournions en rond, et revenions finalement à notre point de départ. Nous sommes constamment en mouvement, et nous ne nous arrêtons jamais pour plonger dans la profondeur. Nous parlons beaucoup, et nous n’écoutons jamais les voix qui parlent des profondeurs à notre profondeur. Nous nous acceptons tels que nous estimons être, sans nous soucier de ce que nous sommes réellement. Comme des chauffards roulant à toute vitesse, nous blessons nos âmes, et nous les abandonnons seules et meurtries au bord de la route. Nous passons à côté de notre profondeur et de notre vie véritable. Quand l’image que nous nous sommes faite de nous-mêmes se brise complètement ; quand nous découvrons que nous avons agi à l’encontre de toutes nos attentes ; quand un tremblement de terre ébranle et bouleverse la superficialité de notre connaissance de soi, alors, et alors seulement, nous acceptons de voir un niveau plus profond de notre être.
La sagesse des nations de tous les temps parle de la voie de la profondeur. Elle la décrit d’innombrables manières. Tous ceux qu’elle a préoccupé – mystiques et prêtres, poètes et philosophes, ignorants et savants – ont témoigné dans leurs confessions, leurs prières ou leurs contemplations d’une même expérience. Ils ont découvert qu’ils n’étaient pas ce qu’ils croyaient être, même après l’apparition d’un niveau plus profond après que la surface s’est évanouie. Ce niveau plus profond devient lui-même superficiel, après la découverte d’un niveau plus profond, et cela se reproduit sans cesse au cours d’une vie, tant qu’on se tient sur la voie de leur profondeur.
Aujourd’hui, une forme nouvelle de cette méthode est devenue célèbre, sous le nom de « psychologie des profondeurs ». Elle conduit de la surface de la connaissance de soi aux niveaux où sont enregistrées ce que nous ignorons à la surface de notre conscience. Elle nous montre des traits de caractère qui contredisent tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes. Elle peut nous aider à trouver le chemin de notre profondeur, mais elle ne peut pas nous aider de façon ultime, parce qu’elle ne peut pas nous guider jusqu’au fondement (5) le plus profond de notre être, et de tout être, la profondeur même de la vie.
Le nom de cette profondeur et de ce fondement infini et inexhaustible est Dieu. Cette profondeur est ce que le mot Dieu signifie. Si ce mot n’a pas grand sens pour vous, traduisez-le, et parlez des profondeurs de votre vie, de la source de votre être, de ce qui vous préoccupe de façon ultime, de ce que vous prenez au sérieux sans restriction. À cette fin, vous devrez, peut-être, oublier tout ce que traditionnellement vous avez appris sur Dieu, et jusqu’au mot lui-même. Mais, si vous savez que « Dieu » signifie « profondeur », vous en savez déjà beaucoup sur lui. Vous ne pouvez pas vous déclarer athée ou incroyant. Vous ne pouvez pas dire : La vie n’a pas de profondeur ! La vie est superficielle. L’être-même n’est que surface. Si vous pouvez le dire cela avec le plus grand sérieux, vous êtes « athée ; sinon vous ne l’êtes pas. Celui qui connaît la profondeur connaît Dieu.
Nous avons considéré la profondeur du monde et la profondeur de nos âmes. Mais, nous ne sommes au monde qu’au sein d’une société humaine. Nous ne pouvons découvrir nos âmes que dans le miroir de ceux qui nous voient. La vie n’a pas de profondeur sans la profondeur de la vie en communauté. Nous vivons habituellement dans l’histoire aussi superficiellement que nous vivons en tant qu’individus. Nous comprenons notre existence historique telle qu’elle nous apparaît, et non pas telle qu’elle est en réalité. Les courants de l’actualité, les vagues de la propagande, les marées des conventions et de la recherche du sensationnel, occupent nos esprits. Le bruit de ces averses nous empêche d’écouter ce qui retentit dans les profondeurs, ce qui se produit réellement dans le fondement des structures de la société, dans les aspirations du cœur des masses, dans l’esprit militant de ceux qui sont sensibles aux changements de l’histoire. Nos oreilles sont aussi sourdes aux cris venus des profondeurs de la vie sociale, qu’elles le sont aux cris des profondeurs de nos âmes. Nous laissons seul sans entendre leurs cris dans le brouhaha de la vie quotidienne, les victimes blessées de notre système social, après les avoir meurtris ; aussi seules que nos propres âmes blessées. Nous croyions que nous vivions une époque de progrès inéluctable pour la condition humaine. Mais, dans les profondeurs de la structure de la communauté, les forces de destructions avaient déjà rassemblé leurs efforts. Il avait semblé que la raison humaine dominait la nature et l’histoire. Mais, ce n’était qu’en surface ; dans la profondeur de notre vie en communauté, la révolte contre la surface avait déjà commencé. Nous avions fabriqué les instruments et les moyens les meilleurs et les plus parfaits pour la vie de l’homme. Mais, dans les profondeurs, ils étaient déjà changés en instruments et en moyens d’autodestruction. Il y a quelques décennies, certains esprits prophétiques ont regardé dans la profondeur. Des peintres ont brisé l’apparence de l’homme et de la nature pour exprimer leur sentiment d’une catastrophe imminente. Des poètes ont usé de mots, et de rythmes étranges et violents, pour éclairer le contraste entre ce qui semble être et ce qui est réellement. Une sociologie des profondeurs est apparue, à côté de la psychologie des profondeurs. Mais, c’est seulement maintenant, au cours de cette décennie où est intervenu le plus terrible tremblement de terre de tous les temps, qui ait secoué toute l’humanité, que les yeux des nations se sont ouverts sur les profondeurs au-dessous d’elles, et sur la vérité de leur existence historique. Il y a encore des gens, même hauts placés, qui se détournent de cette profondeur et qui souhaitent rester à la surface disloquée, comme si de rien n’était. Mais, nous savons que la profondeur de ce qui s’est produit ne se contentera pas de rester au niveau que nous avons atteint. Ce serait désespérer de soi et se mépriser !
Plongeons plus à fond dans le fondement de notre vie historique, dans le fondement ultime de l’histoire. Le nom du fondement infini et inexhaustible de l’histoire est Dieu. C’est ce que signifie ce nom, et c’est aussi ce que signifient les mots Royaume de Dieu et Providence divine. Si ces mots n’ont plus grand sens pour vous, traduisez-les, et parlez de la profondeur de l’histoire, du fondement et du but de la vie sociale, de ce que vous prenez au sérieux sans restriction dans votre action politique et morale. Vous pourrez peut-être nommer cette profondeur : espérance, tout simplement espérance. Si vous trouvez l’espérance dans le fondement de l’histoire, vous êtes unis aux grands prophètes, qui furent capables de regarder en face la profondeur de leur temps. Ils essayèrent d’éviter la catastrophe, car ils ne pouvaient pas soutenir l’horreur de leurs visions ; cependant, ils eurent la force de voir un niveau plus profond et d’y trouver l’espérance. Leur espérance ne les a pas confondus. L’espérance ne nous confondra pas, si nous ne la cherchons pas à la surface, où les fous cultivent leurs vains espoirs, mais dans la profondeur, où les cœurs frémissants et contrits reçoivent la force d’une espérance, qui est vérité.
Ces derniers mots nous conduiront à l’autre signification des mots « profonds » et « profondeur », à la fois dans le langage profane et dans le langage religieux : à la profondeur de la souffrance, qui est la porte, la seule porte de la profondeur de la vérité. Vraiment, il est facile de vivre à la surface tant qu’elle n’est pas ébranlée. Il est douloureux de s’en détacher, et de descendre vers un fondement inconnu. La formidable résistance que tout être humain oppose à cet acte, et les nombreux prétextes qu’il invente pour éviter la route des profondeurs, sont très naturels. La souffrance qu’on éprouve à la vue de ses propres profondeurs est trop forte pour beaucoup de gens. Ils préfèrent plutôt revenir à la surface ébranlée et dévastée de leur vie et de leurs pensées antérieures. Il en va de même des milieux sociaux, qui créent toutes sortes d’idéologies et de rationalisations pour résister à ceux qui veulent les conduire sur la voie de la profondeur de leur existence sociale. Ils préfèrent colmater les fissures de la surface avec de petits expédients, plutôt que creuser dans la profondeur. Les prophètes de tous les temps peuvent nous parler de la résistance haineuse que rencontraient leurs tentatives courageuses de dévoiler les profondeurs de l’injustice et de l’espérance dans la société de leur temps. Qui peut réellement supporter la profondeur ultime, le feu dévorant au fondement de tout être, sans dire avec le prophète : Quel malheur pour moi ! Je suis perdu… et mes yeux ont vu le SEIGNEUR des Armées. (6)
Nos tentatives pour éviter le chemin conduisant à cette profondeur de la souffrance, et les prétextes que nous utilisons pour l’éviter sont tout naturels. La méthode la plus superficielle de toutes consiste à affirmer que les choses profondes sont trop complexes et trop incompréhensibles pour les esprits inéduqués. Pourtant, la marque de la profondeur réelle est sa simplicité. Si vous dites : C’est trop profond pour moi, je n’y comprends rien. Vous vous trompez vous-mêmes. Car vous devriez savoir que rien de réellement important n’est trop profond pour personne. La vérité n’est pas trop profonde ; elle est plutôt inconfortable ; c’est pourquoi on fuit la vérité. Ne confondons pas les choses complexes avec les choses profondes de la vie. Les choses complexes ne nous concernent pas de façon ultime ; il est sans importance que nous les comprenions, ou non. Mais les choses profondes doivent nous concerner toujours, parce qu’elles nous concernent infiniment, qu’elles nous saisissent, ou non.
Un fait plus sérieux peut être présenté comme excuse par ceux qui veulent éviter le chemin de la profondeur. Dans le langage religieux, le mot profondeur désigne souvent le séjour des forces du mal, des puissances démoniques (7) de la mort et de l’enfer. Le chemin des profondeurs n’est-il pas contrôlé par ces forces ? Ne sont-elles pas les éléments destructeurs et morbides de la pulsion de mort ? Lorsqu’un de mes amis Américains exprimait devant un groupe de réfugiés allemands son admiration pour la profondeur germanique, nous nous sommes demandés si nous pouvions admettre cet éloge. Cette profondeur n’a t-elle pas été le terrain où surgirent les forces les plus démoniques de l’histoire moderne ? Cette profondeur n’était-elle pas une profondeur morbide et destructrice ? Permettez-moi de répondre à ces questions avec un mythe antique magnifique. Quand l’âme quitte le corps, elle doit traverser plusieurs sphères dominées par les forces démoniques ; seule l’âme connaissant la parole juste et efficace peut poursuivre son chemin vers la profondeur ultime du fondement divin. Aucune âme ne peut éviter cette épreuve. Il suffit de considérer les luttes des saints, des prophètes, des réformateurs et des grands créateurs dans tous les domaines, pour qu’apparaisse la vérité de ce mythe. Chacun doit affronter les profondeurs de la vie. Que ce soit dangereux n’est pas une excuse. Le danger doit être vaincu par la connaissance de la parole libératrice. Le peuple allemand, et beaucoup de peuples parmi les nations, ne connaissaient pas la parole ; c’est pourquoi, manquant de la profondeur salutaire ultime, ils ont été rattrapés par les forces malfaisantes de la profondeur.
Aucune excuse ne permet d’éviter la profondeur de la vérité, dont la seule voie se trouve dans la profondeur de la souffrance. Que la souffrance vienne de l’extérieur, et qu’on la prenne sur soi comme la voie de la profondeur ; qu’on la choisisse, volontairement, comme la seule voie menant aux choses profondes ; qu’elle soit la voie de l’humilité, ou la voie de la révolution ; que la « croix » soit intérieure, ou qu’elle soit extérieure ; cette voie mène à l’opposé des chemins que nous préférions suivre auparavant. C’est pourquoi Ésaïe loue Israël, serviteur de Dieu dans de profondes souffrances. C’est pourquoi Jésus déclare « bénis » ceux qui pleurent, qui sont persécutés, qui éprouvent la faim et la soif dans leur corps et dans leur esprit ; c’est pourquoi il nous demande de perdre notre vie pour trouver notre vie. C’est pourquoi deux grands révolutionnaires, Thomas Müntzer, au seizième siècle, et Karl Marx, au dix-neuvième siècle, ont parlé en termes semblables de la vocation de ceux qui se trouvent aux marges de l’humanité – dans le vide le plus profond, dit Münzer, dans l’inhumanité la plus profonde, dit Marx – ce prolétariat, qu’ils pensaient être porteur du salut à venir.
Il en va de notre vie comme de notre pensée : Tout semble y être mis sens dessus dessous. On a souvent accusé la Religion et le Christianisme d’être irrationnels et paradoxaux. C’est clair qu’on leur a associé nombre d’inepties, de superstitions et de fanatismes. Le commandement de sacrifier sa raison est plus démonique que divin. L’homme cesse d’être humain quand il rejette la raison. Mais la profondeur du sacrifice, de la souffrance et de la Croix est demandée à la pensée. Tout pas avancé sur la voie de la profondeur de la pensée rompt avec la surface des pensées précédentes. Quand cette rupture a eu lieu, chez Paul, Augustin et Luther, ceux-ci ont ressenti une souffrance extrême, qu’ils ont éprouvé comme une mort et comme un enfer. Mais, ils ont accepté cette souffrance comme la voie menant aux profondeurs de Dieu, comme la voie de la spiritualité, comme la voie de la vérité. Ils ont énoncé en langage spirituel la vérité qu’ils entrevoyaient, autrement dit, en des termes opposés à ceux des raisonnements de surface, mais en harmonie avec la profondeur de la raison, qui est divine. Le langage paradoxal de la religion révèle que la voie de la vérité est la voie de la profondeur, et, par conséquent, la voie de la souffrance et du sacrifice. Seul celui qui désire suivre ce chemin peut comprendre les paradoxes de la religion.
La dernière chose que je veux dire au sujet du chemin de la profondeur concerne l’un de ces paradoxes. La fin du chemin est la joie. La joie est plus profonde que la souffrance. Elle est ultime. Permettez-moi d’exprimer ce point avec les mots d’un homme qui a cherché passionnément la profondeur, mais dont les forces destructrices se sont emparées, car il ignorait la parole qui permet de les vaincre. Frédéric Nietzsche écrit : Le monde est profond, plus profond qu’aucun ne peut le dire. Son malheur est profond. La joie est plus profonde encore que le chagrin. Le malheur dit : va-t’en ! Mais, la joie veut toute l’éternité. Elle veut profondément l’éternité abyssale.
La joie éternelle est la fin des voies de Dieu. Le message de toutes les religions est que le Royaume de Dieu est paix et joie. C’est aussi le message du Christianisme. Mais, on ne parvient pas à la joie éternelle en vivant à la surface. On n’y parvient qu’en traversant la surface, en pénétrant profondément dans les choses profondes de notre vie, de notre monde, et de Dieu. Le moment où nous atteignons la profondeur dernière de nos vies est le moment où nous pouvons avoir l’expérience de la joie qui contient l’éternité, de l’espérance indestructible, et de la vérité sur laquelle la vie et la mort sont bâties. Car, dans la profondeur est la vérité, dans la profondeur est l’espérance, et dans la profondeur est la joie.
Paul Tillich
Le sens de la joie, une prédication de Paul Tillich sur le Psaume 126
Quand le Seigneur a rétabli Sion, Nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rires, Et notre langue poussait des cris de joie ; alors on disait parmi les nations ; Le SEIGNEUR a fait pour eux de grandes choses ! Le SEIGNEUR a fait pour nous de grandes choses ; Nous nous réjouissons. SEIGNEUR, rétablis notre situation, comme les torrents dans le Néguev ! Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s’en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, revient avec des cris de joie, quand il porte ses gerbes.
Psaume 126 (1).
Amen, amen, je vous le dis, vous, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira : vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu’elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue ; mais quand elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu’un homme soit venu au monde. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie.
Jean 16, 20-22.
Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète.
Jean 15, 11.
La Bible abonde d’exhortations à la joie. Les paroles de Paul aux Philippiens : Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ! (2), évoquent un élément sans cesse présent dans la religion biblique. Le manque de joie est pour les hommes de l’Ancien et du Nouveau Testament une conséquence de la séparation d’avec Dieu, et la présence de la joie une conséquence de la réunion avec Dieu.
La joie est exigée et elle peut être donnée. Ce n’est pas une chose qu’on a tout simplement. Elle n’est pas facile à atteindre. Elle est, et elle a toujours été, une chose rare et précieuse. Elle a toujours été un problème difficile parmi les Chrétiens. Les Chrétiens sont accusés de détruire la joie de vivre, ce don naturel de toute créature. Le plus grand des adversaires modernes du Christianisme, Frédéric Nietzsche, lui-même fils d’un pasteur protestant, a exprimé son jugement sur Jésus en ces termes : Ses disciples devraient avoir l’air plus rédimés. Nous devrions nous plier à la vigueur percutante de ces paroles, et nous demander si notre manque de joie tient au fait que nous sommes Chrétiens, ou au fait que nous ne le sommes pas assez. Peut-être pouvons-nous nous défendre de façon convaincante d’être des gens qui méprisent la vie, et dont la conduite met en accusation la vie en permanence. Peut-être pouvons-nous montrer que c’est une distorsion de la vérité.
Mais soyons honnêtes. Cette critique est-elle sans fondement ? D’innombrables Chrétiens – pasteurs, étudiants en théologie, évangélistes, missionnaires, éducateurs, travailleurs sociaux, pieux et pieuses laïcs, et même leurs enfants de ces parents – s’enveloppent d’un air pesant et d’une sévérité étouffante, et manquent d’humour et d’ironie à l’égard d’eux-mêmes ? C’est indéniable ! Nos critiques en dehors de l’Église ont raison. Mais nous pourrions peut-être nous montrer plus critiques qu’eux, avec plus de profondeur.
Comme Chrétiens, nous connaissons nos conflits intérieurs à propos de l’acceptation ou du refus de la joie. Nous nous défions des dons naturels qui concourent à la joie, parce que nous nous défions de la nature, tout en confessant qu’elle est une création divine dont Dieu a dit : C’était très bon ! (3) Nous nous défions des créations de la culture qui concourent à notre joie, parce que nous nous défions de la créativité de l’homme, tout en confessant que Dieu lui a commandé de cultiver le jardin de la terre, et qu’il le lui a soumis. Si nous dominons notre défiance et si nous déclarons que nous acceptons les dons de la nature et les créations de la culture, nous le faisons souvent avec mauvaise conscience. Nous savons que nous devrions être libres pour la joie, comme l’a dit Paul : Tout est à vous, mais notre courage n’est pas à la hauteur de notre savoir. Nous n’osons pas assumer notre monde et nous assumer nous-mêmes, et si nous l’osons, en des moments de courage, nous essayons de nous racheter en nous culpabilisant et en nous en punissant ; nous attirons sur nous la critique malicieuse de ceux qui n’ont jamais osé le faire. C’est pourquoi de nombreux Chrétiens essayent de faire des compromis. Ils s’efforcent de cacher leur sentiment de joie, ou essayent d’éviter les joies trop fortes, pour n’avoir pas à se les reprocher trop rudement. Cette expérience d’élimination de la joie, de la culpabilité à cause de la joie, dans certains milieux Chrétiens, m’a presque conduit à rompre avec le Christianisme. Ce qu’on tient dans ces milieux pour de la joie est insipide, squelettique, délibérément infantile, sans enthousiasme, sans couleur et sans danger, sans élévation et sans profondeur.
Il est indéniable que c’est un état de fait dans beaucoup d’Églises chrétiennes. Mais, maintenant, écoutons une question posée à la fois du côté des Chrétiens et du côté des non-chrétiens. « La joie mentionnée par la Bible est-elle complètement différente de la joie qui manque à beaucoup de Chrétiens ? Le Psalmiste, Paul, et le Jésus du Quatrième Évangile ne parlent-ils pas d’une joie qui transcende la joie de vivre naturelle ? Ne parlent-ils pas de la joie en Dieu ? Être chrétien n’est-ce pas se décider pour la joie en Dieu au lieu de la joie de vivre ? »
La première, la plus simple des réponses à ces questions, est que la vie est de Dieu, et que Dieu est le fondement (4) créateur de la vie. Il est infiniment plus que tous les processus de la vie. Mais il est à l’œuvre en tous de façon créatrice. Donc, il n’y a pas nécessairement de conflit entre la joie en Dieu et la joie de vivre. Mais cette première réponse, aussi joyeuse et magnifique qu’elle est, ne suffit pas, car la « joie de vivre » peut désigner bien des choses.
La joie semble l’opposé de la souffrance. Or nous savons que joie et souffrance peuvent coexister. Ce n’est pas la joie mais le plaisir l’opposé de la souffrance. Certains croient que la vie humaine est un évitement continuel de la souffrance et une recherche constante du plaisir. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un en qui cela soit vrai. Ce n’est vrai que d’êtres ayant perdu leur humanité ; dans une complète désintégration, ou dans la maladie mentale. L’être humain ordinaire est capable de sacrifier les plaisirs et de prendre sur soi la souffrance pour une cause, pour quelqu’un ou quelque chose qu’il aime, qu’il juge digne de sa souffrance et de son sacrifice. Il peut ne pas tenir compte à la fois de la souffrance et du plaisir, parce qu’il n’est pas orienté par ses plaisirs, mais par ce qu’il aime et auquel il veut être uni. Si nous désirons quelque chose à cause du plaisir qu’il peut nous procurer, nous pourrons obtenir ce plaisir, mais nous ne trouverons pas la joie. Si nous cherchons quelque chose pour nous éviter la souffrance, nous pourrons éviter la souffrance, mais nous n’éviterons pas la tristesse. Si nous essayons de nous servir d’autrui pour nous protéger de la souffrance, nous pourrons être protégés de la souffrance, mais nous ne serons pas protégés de la tristesse. Le plaisir peut être obtenu et la souffrance peut être évitée, en usant ou en abusant d’autrui. Mais la joie ne peut être ainsi obtenue et la tristesse ne peut être vaincue. La joie est seulement possible quand nous sommes attirés par les personnes et par les choses pour ce qu’elles sont, et non pour ce que nous pouvons obtenir d’elles. La joie de notre travail est gâtée quand nous l’accomplissons non pour ce qu’il accomplit mais pour le plaisir qu’il peut nous procurer, ou pour la souffrance qu’il nous permet d’éviter. Le plaisir de l’expérience de la beauté et de la vérité sont gâtés quand nous ne nous réjouissons pas de la vérité et la beauté, mais du fait que nous, nous en obtenons de la jouissance.
Le pouvoir ne donne de la joie qu’affranchi du plaisir d’avoir du pouvoir, et s’il est le moyen de créer quelque chose de valable. Les relations amoureuses, spécialement les relations entre les sexes, demeurent sans joie si nous nous… Cette menace pèse sur toutes les relations humaines. Nous ne sommes mis en garde par une contrainte extérieure contre certaines formes de ces relations, mais par la sagesse issue des expériences passées, qui nous enseigne que certaines expériences peuvent procurer du plaisir sans donner de la joie. Elles ne donnent pas la joie parce qu’elles n’accomplissent pas ce que nous sommes, et ce que nous recherchons. Toute relation humaine est sans joie quand l’autre n’est pas recherché pour ce qu’il est, mais pour le plaisir qu’il peut nous procurer, ou pour la protection qu’il peut nous assurer contre la souffrance.
La recherche du plaisir pour le plaisir évite la réalité, celle des autres et la nôtre. Mais seul l’accomplissement de ce que nous sommes réellement peut nous procurer la joie. La joie n’est rien d’autre que la conscience de l’accomplissement de notre être véritable, dans le centre de notre personne. Cet accomplissement n’est possible que si nous nous unissons à ce que sont les autres réellement. C’est la réalité qui donne la joie, et elle seulement. La Bible parle souvent de la joie, parce qu’elle est le plus réaliste de tous les livres. Réjouissez-vous ! Cela signifie : « Passez de ce qui vous semble réel, à ce qui est réellement réel ! » Le pur plaisir, en nous et chez les autres, reste dans le domaine des illusions sur la réalité. La joie naît de l’union avec la réalité elle-même.
L’une des racines du besoin de plaisir est le sentiment de la vacuité et la souffrance de l’ennui qui en découle. La « vacuité » est un manque de relation avec les choses, les personnes et les significations : c’est même un manque de relation avec soi-même. C’est pourquoi nous essayons de nous fuir et de fuir notre solitude, mais nous n’atteignons pas ainsi, dans une relation authentique, les autres et leur monde. Aussi, nous nous servons d’eux pour ce genre de plaisir qu’on appelle « l’amusement ». Mais ce n’est pas l’amusement inventif souvent lié au jeu, mais une façon frivole, avide, folle, de « s’amuser ». Ce n’est pas par hasard que ce genre d’amusement peut être facilement commercialisé ; il repose sur des réactions prévisibles, sans passion, sans risque, sans amour. C’est le plus dangereux de tous les dangers qui menacent notre civilisation. Le désir d’échapper à la vacuité en s’ « amusant » rend la joie impossible.
Réjouissez-vous ! Cette exhortation biblique est plus utile à ceux qui s’ « amusent » beaucoup et y trouvent beaucoup de « plaisir », qu’à ceux qui éprouvent peu de plaisir et beaucoup de souffrance. Car il est souvent plus aisé d’unir la souffrance avec la joie, que d’unir l’« amusement » avec la joie.
Le commandement biblique de se réjouir interdit-il le plaisir ? La joie et le plaisir s’excluent-ils mutuellement ? D’aucune manière ! L’accomplissement du centre de notre être n’exclut aucunement des accomplissements partiels, à la périphérie. Nous devons l’affirmer avec autant d’insistance que lorsque nous avons opposé la joie et le plaisir. Non seulement nous devons combattre ceux qui recherchent le plaisir pour le plaisir, mais aussi ceux qui rejettent le plaisir parce que c’est du plaisir. L’homme se réjouit de manger et de boire au-delà de ses besoins physiologiques. C’est la manifestation partielle et répétée de son désir de vivre ; c’est pourquoi c’est un plaisir, et il peut donner la joie de vivre. L’homme se réjouit de la danse et du jeu, de la beauté de la nature et des transports amoureux ; ils réalisent certains des désirs les plus forts de la vie ; c’est pourquoi ce sont des plaisirs, qui donnent la joie de vivre. L’homme se réjouit de son pouvoir de connaître et de son attirance pour l’art ; ils réalisent certaines des plus hautes aspirations de la vie ; c’est pourquoi ce sont des plaisirs qui donnent la joie de vivre. L’homme se réjouit de la communauté humaine, de la famille, de l’amitié, de son milieu social ; ils réalisent certaines des aspirations fondamentales de la vie ; c’est pourquoi ce sont des plaisirs, qui donnent la joie de vivre.
Cependant toutes ces relations soulèvent la question : Notre façon d’éprouver ces plaisirs est-elle juste ou fausse ? Les recherchons-nous pour le plaisir qu’elles nous donnent, ou parce que nous désirons que l’amour nous unisse à tout ce auquel nous appartenons ? Nous ne le savons jamais avec certitude. Comme ceux qui au cours de l’histoire du Christianisme en ont éprouvé de l’angoisse, beaucoup préfèrent renoncer aux plaisirs, en dépit du fait que Dieu les a créés bons. Ils cachent leur angoisse sous des interdits parentaux, sociaux, ou ecclésiastiques, et ils disent que ces interdits sont des commandements de Dieu. Ils justifient leur peur d’affirmer la joie de vivre, en en appelant à leur conscience, qu’ils estiment être la voix de Dieu, ou à leur besoin de discipline, de maîtrise de soi et de désintéressement, qu’ils appellent une « imitation du Christ ». Pourtant, à la différence de Jean-Baptiste, Jésus a été traité de glouton et de buveur par ses détracteurs (5). Malgré tout, dans ces mises en garde contre les plaisirs, il y a un mélange de vérité et de non-vérité. Dans la mesure où elles renforcent notre responsabilité, elles sont vraies ; dans la mesure où elles minent notre joie, elles sont fausses. Permettez-moi d’indiquer un autre critère d’acceptation, ou de rejet, des plaisirs : celui que donne notre texte. Sont bons, les plaisirs qui vont de pair avec la joie ; sont mauvais, ceux qui interdisent la joie. À la lumière de cette norme, nous devrions oser prendre le risque d’assumer les plaisirs, même s’il est prouvé que ce risque a été une erreur. Il n’est pas plus Chrétien de rejeter les plaisirs, que de les accepter. N’oublions pas que leur rejet implique un rejet de la création, ou, comme le nommaient les Pères de l’Église : un blasphème contre le Dieu créateur. Chaque Chrétien devrait savoir ce dont beaucoup de non-chrétiens sont vivement conscients : la répression de la joie de vivre engendre une haine de la vie, dissimulée ou effective, qui peut mener à l’autodestruction, comme le montrent beaucoup de maladies physiques et mentales.
La joie est plus que le plaisir, et elle est plus que le bonheur. Le bonheur est un état d’esprit qui dure plus ou moins longtemps, et qui dépend de beaucoup de conditions extérieures et intérieures. Les Anciens estimaient que c’est un don que les dieux accordent et reprennent. La « poursuite du bonheur » est un droit humain fondamental dans la Constitution américaine. Le plus grand bonheur du plus grand nombre est le but de l’activité humaine, selon l’Économie. Les contes de fées disent : Ils vécurent heureux et longtemps. Le bonheur peut supporter beaucoup de souffrances et le manque de plaisir. Mais le bonheur ne peut supporter le manque de joie. Car la joie est l’expression de notre accomplissement central essentiel. Aucun accomplissement périphérique, ni aucune condition favorable, ne peuvent remplacer l’accomplissement central. Une grande joie peut transformer le malheur en bonheur, même dans une situation misérable. Qu’est-ce, alors, que la joie ?
Demandons-nous, d’abord, à quoi elle s’oppose. C’est à la tristesse. La tristesse est le sentiment d’être dépossédé de notre accomplissement central, parce que nous sommes privés de quelque chose qui nous appartient, et qui est nécessaire à notre accomplissement. Nous pouvons être privés de parents et d’amis proches, d’un travail créateur, du soutien d’une communauté enrichissante pour notre vie, d’un foyer, de l’honneur, de l’amour, de la santé mentale ou physique, de l’unité personnelle, ou de bonne conscience. Tout cela provoque de la tristesse, sous toutes ses formes : la tristesse du chagrin, la tristesse de la dépression, la tristesse du dénigrement de soi. Mais c’est précisément dans ce genre de situation que Jésus dit à ses disciples que leur joie est en eux et qu’elle sera parfaite. Paul rappelle que si la tristesse peut être la tristesse du monde, qui produit la mort (6) et l’extrême désespoir ; elle peut être aussi la tristesse selon Dieu, qui conduit à une transformation et la joie. La joie a quelque chose au-delà de la joie et de la tristesse ; c’est ce qu’on appelle : félicité (7).
La félicité est dans la joie l’élément éternel, qui lui permet d’intégrer, quand elle surgit, la tristesse et de la prendre sur soi. Dans les Béatitudes, Jésus déclare « heureux » : les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont persécutés. Il leur dit : Réjouissez-vous et soyez transportés d’allégresse ! (8) La joie dans la tristesse est possible à ceux qui sont « heureux (9) », à ceux dont la joie a la dimension de l’éternel.
Il faut répondre encore à ceux qui critiquent le Christianisme parce qu’il détruirait la joie de vivre. Considérant les Béatitudes, ils disent que le Christianisme mine la joie de la vie présente, en annonçant et en préparant une autre vie. Ils dénoncent la promesse de la félicité, comme une forme subtile de report de la recherche du plaisir dans une vie future. À nouveau, reconnaissons que de nombreux Chrétiens repoussent la joie à après la mort, et que certains versets de la Bible apportent cette réponse. Néanmoins, c’est faux ! Jésus a donné maintenant sa joie à ses disciples. Ceux-ci la trouvent après son départ, ce qui signifie, dans cette vie. Paul demande aux Philippiens d’être joyeux maintenant. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la félicité est l’expression de l’accomplissement éternel de Dieu. Heureux ceux qui participent, ici et maintenant, à cet accomplissement. Certes, cet accomplissement éternel ne doit pas être considéré seulement comme la présence de l’éternité mais aussi comme le futur de l’éternité. Si on ne voit pas cela dans le présent, on ne le voit pas du tout.
La joie, qui en elle a la profondeur de la félicité, est prescrite et promise dans la Bible. Elle maintient en elle la tristesse, son opposé. Elle donne un fondement au bonheur et au plaisir. Elle est présente à tous les niveaux du désir d’accomplissement de l’homme. Elle les sanctifie et elle les oriente. Elle ne les diminue pas, et elle ne les affaiblit pas. Elle n’écarte pas de la joie de vivre les risques et les dangers. Elle rend possible la joie de vivre dans le plaisir et la souffrance, dans le bonheur et le malheur, dans l’enthousiasme et la douleur. Là où est la joie, la finalité de la vie, le sens de la création, et le but du salut se réalisent dans l’accomplissement et dans la joie.
Paul Tillich
Remerciez… , une prédication et une prière de Paul Tillich sur 1 Thessaloniciens 5, 16-18
Réjouissez-vous toujours, Priez continuellement, Rendez grâces en toute circonstance…
1 Thessaloniciens 5, 16-18.
En toute circonstance, rendez grâce. Nous désirons placer ces mots au centre de notre méditation. Cette exhortation est-elle nécessaire ? Le mot « merci », n’est-il pas l’un des mots les plus fréquemment employés de notre langue ? Nous l’utilisons constamment à l’occasion du moindre service rendu : pour un mot amical, pour des paroles nous félicitant ou faisant l’éloge de nos actions. Nous l’employons en éprouvant ou non un sentiment. Dire merci est devenu une simple formule. C’est pourquoi il faut beaucoup insister, et user de paroles fortes, quand il faut remercier réellement. Quiconque connaît le comportement des milieux religieux – des pasteurs et des laïcs – est habitué à leur tendance à remercier Dieu, presque aussi souvent que leur prochain. En conséquence, il semble important de s’interroger sur les raisons de ce comportement vis-à-vis de nos semblables et de Dieu. Pourquoi remercions-nous ? Qu’est-ce signifie remercier, ou recevoir des remerciements ? Ce fait de la vie quotidienne – et de la vie religieuse quotidienne – doit-il être compris comme un fait profond et élevé, ou comme un automatisme superficiel ? Si on prouve qu’il est profond, on pourra découvrir que ce mot dont on use et abuse peut révéler les niveaux les plus profonds de notre être.
Dire merci n’est pas simplement une forme de la relation sociale. Nous sommes souvent poussés par une émotion réelle ; nous nous sentons presque obligés de remercier quelqu’un, qu’il s’y attende ou non. Quelquefois l’émotion nous empoigne tellement que nous remercions en des termes trop forts pour le don que nous avons reçu. Ce n’est pas malhonnête. C’est honnêtement ressenti sur le moment. Mais, peu après, nous nous sentons un peu vides, un peu honteux, non pas trop, mais tout de même un peu ! Il peut arriver, occasionnellement, que nous nous éprouvions un moment un sentiment de gratitude très fort. Mais, si pour des raisons extérieures, nous n’avons pas l’occasion immédiate de l’exprimer, nous l’oublions, et il n’atteint jamais celui que nous voulions remercier. Aucun des dix lépreux guéris par Jésus ne manquait de gratitude à son égard, mais un seul est revenu le remercier après s’être présenté aux prêtres. Et Jésus s’en est étonné et en a été déçu (1).
Non seulement une émotion profonde peut nous pousser à remercier, mais nous avons un profond besoin de recevoir des remerciements, quand nous nous sommes beaucoup, ou peu donnés, aux autres. Quand les remerciements ne viennent pas, nous ressentons en nous une sorte de vide, une vacuité dans notre être intérieur, que des paroles ou des actes de remerciements auraient pu remplir. De même que nous nous sentons honteux d’exprimer trop fortement notre gratitude, nous nous sentons également mal à l’aise quand on nous adresse des remerciements exagérés. Il n’y a pas en nous de place où les recevoir ; que nous l’admettions ou non. Il est toujours difficile de recevoir des remerciements sans éprouver de résistance. Les Américains disent : Vous êtes bienvenus et les Allemands répondent : s’il vous plaît ! pour exprimer leur refus d’accepter des remerciements sans manifester d’hésitation. N’en parlons plus, est la façon la plus simple d’exprimer cette résistance à accepter les remerciements… qu’on accepte !
Ces incertitudes concernant l’acte tout simple de donner ou de recevoir des remerciements nous renseignent sur nos relations avec les autres, et sur notre situation. Chaque fois que nous remercions, ou que nous recevons des remerciements, nous acceptons ou nous rejetons quelqu’un, et nous sommes acceptés et rejetés par quelqu’un. Ni nous, ni les autres, n’en sommes toujours conscients. Si nous sommes sensibles, nous le sentons souvent, et nous réagissons avec joie ou avec tristesse, avec honte ou orgueil, le plus souvent avec un mélange de ces sentiments. Un simple merci peut être une attaque ou un repli. Il peut exprimer le fait que nous faisons place à l’autre, ou que nous réussissons à nous protéger de celui qui cherche à trouver une place en nous. Un mot de remerciement peut exprimer un rejet complet de celui que nous remercions, ou, au contraire, que notre cœur lui est ouvert. Bien souvent, c’est probablement une façon polie de dire que celui que nous remercions ne nous concerne réellement pas beaucoup.
Le Psaume 50 dit : En sacrifice à Dieu offre la reconnaissance, et : Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie… (2) Ici le sens originel du remerciement est clair. Remercier est un sacrifice. C’est le sens littéral de « remercier » (3). Le remerciement s’exprime par un acte sacrificiel. Des objets précieux prélevés de leur usage ordinaire sont offerts aux dieux. L’homme reconnaît ainsi qu’il ne s’est pas créé lui-même ; que rien ne lui appartient ; que nu il est venu au monde, et que nu il en sera retiré. Il possède ce qui lui a été donné. L’acte sacrificiel exprime sa conscience de ce destin. Il donne une partie de ce qui lui a été donné, mais quelque chose d’ultime ne lui appartient pas. En sacrifiant avec action de grâce, il est le témoin de sa finitude de sa vie éphémère. L’homme capable de remercier avec sérieux accepte d’être une créature, et en l’acceptant, il montre qu’il est religieux, même s’il nie la religion. L’homme capable d’accepter honnêtement et sans embarras les remerciements fait preuve de maturité. Il connaît sa finitude autant que celle des autres ; il sait que les sacrifices d’action de grâce mutuels confirment qu’il est, comme l’autre, une créature.
L’objet de notre gratitude est ordinairement apparent chaque fois que nous exprimons nos remerciements aux autres. Nous savons, au moins, qui nous remercions et pourquoi, bien que nous ne sachions pas souvent comment remercier. Mais il existe aussi une gratitude sans objet défini à proprement parler. Non pas parce que nous ne connaissons pas son objet, mais parce qu’il n’y a pas d’objet. Nous sommes simplement reconnaissants. La reconnaissance nous a saisi, non en raison de ce qui nous est arrivé, mais simplement parce que nous le sommes, parce que nous participons à la gloire et à la puissance de l’être. C’est une disposition à la joie, et plus qu’une disposition, plus qu’une émotion éphémère. C’est un état de l’être. Et c’est plus que de la joie. C’est une joie qui inclut le sentiment que quelque chose est donné, que nous ne pouvons accepter sans offrir un sacrifice, autrement dit sans remercier. Mais il n’y a personne à qui le présenter. Il demeure en nous, à l’état de gratitude silencieuse.
Vous pouvez demander : Pourquoi Dieu n’est-il pas l’objet de cette gratitude ? Cela n’explique pas ce qui se produit chez beaucoup d’hommes – Chrétiens ou non, croyants ou non. Ils éprouvent de la gratitude. Mais ils ne s’adressent pas directement à Dieu, avec les paroles d’une prière. Ils sont juste remplis par une pure gratitude. Si on leur dit de s’adresser à Dieu avec une prière de remerciement, ils sentent qu’un tel commandement pourrait détruire leur expérience spontanée de la gratitude. Comment juger un état d’esprit qu’à un moment ou à un autre, beaucoup d’entre nous ont éprouvé ? Dirons-nous qu’il s’agit d’une action de grâce sans Dieu, et, par conséquent, qu’il ne s’agit pas d’un remerciement véritable ? Dirons-nous que dans cet état d’esprit nous ressemblons à ces païens dont Paul dit qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce ? (4) Certes, non ! L’abondance d’un cœur reconnaissant fait honneur à Dieu, même quand elle ne s’adresse pas à lui en paroles. L’incroyant plein de reconnaissance pour son être cesse d’être un incroyant. Son allégresse obéit spontanément à l’exhortation de notre texte : Réjouissez-vous toujours !
Il est alors possible de comprendre pourquoi notre texte dit : Réjouissez-vous toujours, Priez continuellement, Rendez grâces en toute circonstance ! Cela ne veut certainement pas dire : Ne soyez jamais tristes, prononcez jours et nuits des prières et des actions de grâce ! Jésus caractérise cette façon de s’imposer à Dieu comme une perversion de la religion. Que signifient donc ces exhortations ? Elles désignent précisément ce que nous appelons un état de gratitude silencieuse, lequel peut ou non s’exprimer par des prières. Nous n’avons pas à raconter à Dieu sans arrêt ce que nous désirons, ou ce qu’il a fait pour nous. Il nous est demandé de nous élever sans cesse vers Dieu, et en toute circonstance. Il ne sera jamais absent de notre conscience. En vérité, il est présent de façon créatrice en chacun, à tout moment, que nous en soyons ou non conscients. Mais quand nous sommes dans l’état de gratitude silencieuse, nous sommes conscients de sa présence. Nous faisons l’expérience d’une élévation de la vie qui ne s’atteint pas par une profusion de paroles de remerciements, mais qui peut advenir en nous si nous lui sommes ouverts. Un jour qu’on demandait à un homme s’il priait, celui-ci répondit : « Toujours et jamais ! » Il voulait dire qu’il était conscient de la présence divine, mais qu’il formulait rarement des prières et des actions de grâce pour exprimer cette conscience. Il n’était pas du nombre de ceux qui ne remercient pas parce qu’ils ne sont jamais conscients de la présence divine, mais au nombre de ceux qui croient connaître Dieu et qui s’adressent à lui constamment. Il pensait que les paroles adressées à Dieu viennent avec l’élévation de l’esprit, de la gratitude silencieuse. On a demandé à un autre homme s’il croyait en Dieu ; ce dernier répondit : « Je ne sais pas, mais s’il m’arrive quelque chose de bien, j’ai besoin de remercier ». Cet homme, comme le précédent, avait fait l’expérience de l’élévation dans la gratitude, mais il était poussé à exprimer directement son sentiment avec des paroles de remerciement. Il avait besoin d’un autre à qui sacrifier. Ces deux hommes représentent le fait que remercier Dieu, c’est à la fois s’élever vers lui sans parole et désirer sacrifier avec des paroles adressées à Dieu.
Ces deux manières de remercier rendent manifestes deux types de relation avec Dieu. Dans l’une, Dieu est l’autre auquel nous nous adressons avec des paroles de remerciements, et dans la seconde, il est l’autre au-dessus de moi et de tout autre ; celui auquel je ne peux parler, mais qui peut se manifester à moi dans l’état de gratitude silencieuse.
L’une des expériences les plus grandes et les plus libératrices des Réformateurs Protestants fut de réaliser que notre relation avec Dieu ne repose pas sur la répétition continuelle de prières et d’actions de grâce, de sacrifices et d’autres rites, mais sur la sérénité et la joie qui répondent à la bonne nouvelle que Dieu nous cherche et qu’il nous a accepté, sans tenir compte de ce que nous disons, ou faisons, dans l’Église et hors de l’Église.
Pourquoi remercier ? Remercier aurait-il des limites ? Notre texte dit : en toute circonstance, remerciez … Cela ne signifie pas remercier pour tout, mais remercier en toute situation ! Les occasions sont sans limites ; par contre, les choses pour lesquelles remercier sont, elles, limitées. La réponse à cette nouvelle question peut nous conduire à comprendre d’une manière renouvelée notre condition d’homme.
Nous lisons dans la première lettre à Timothée : que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâce, car tout est consacré par la parole de Dieu et la prière. (5) Remercier reçoit avec ces paroles une nouvelle fonction. C’est consacrer tout ce qui a été créé par Dieu. Le remerciement est une consécration ; elle transfère quelque chose du monde appartenant au monde séculier dans la sphère du sacré. Cette chose n’est pas transformée, comme le voudrait la superstition, dans et hors de la foi chrétienne, mais elle est élevée en représentant du divin. Elle devient porteur de la grâce. C’est pourquoi nous disons merci quand nous sommes reconnaissants pour notre nourriture et, ainsi, nous la consacrons. Tout ce qui est créé peut être porteur de sainteté, objet d’action de grâce, objet de consécration. À cet égard, il n’y a pas de limite au remerciement. Nous pouvons remercier pour nos forces corporelles ou mentales, pour l’obscurité de notre inconscient et pour la lumière de notre conscience, pour l’abondance de la nature, pour les créations de l’histoire, pour tout ce qui est et qui manifeste son pouvoir d’être. Nous pouvons remercier pour tout cela, en dépit de son rejet par tous ceux qui haïssent le monde par ascétisme, ou par puritanisme fanatique, et qui blasphèment contre le Dieu de la création. Tout ce pourquoi nous remercions avec bonne conscience est consacré par nos remerciements. Ce n’est pas simplement une vision théologique profonde ; c’est aussi un principe pratique pour les situations où nous sommes incertains quant à leur acceptation ou à leur rejet. Si après les avoir acceptés, nous pouvons remercier à leur sujet, nous sommes les témoins de la bonté des créatures. En remerciant avec sérieux, nous les consacrons à la source sacrée de l’être dont elles proviennent. Nous prenons le risque que les Chrétiens protestants doivent prendre : le risque que leur conscience se trompe et consacre quelque chose qui devrait être rejeté.
Il n’y a pas de limite à l’action de grâce dans la création. Mais notre vie n’a t-elle pas des limites ? Pouvons-nous honnêtement rendre grâce pour les frustrations, les accidents et les maladies qui nous frappent ? Nous ne le pouvons pas au moment où elles nous saisissent. C’est l’une des nombreuses situations où la piété peut dégénérer en malhonnêteté. Car nous résistons justement contre ces maux. Nous voulons les éliminer ; nous éprouvons de la colère à l’égard de notre destin et du fondement divin. Il existe des souffrances corporelles ou mentales profondes, pour lesquelles la question de remercier, ou non, ne se pose pas. Le psalmiste crie à Dieu : Depuis les profondeurs, je t’invoque, SEIGNEUR (6) ; il ne le remercie pas. C’est honnête, réaliste ; c’est d’un réalisme issu de la présence divine. Je crois que nous tous, à un moment ou à un autre, nous avons fait l’expérience que ce qui nous arrivait n’était rien que du mal, mais que cela devenait plus tard du bien et l’objet de remerciements honnêtes.
Et nous ne pouvons pas rendre grâce pour les actes qui nous ont rendu coupables, ou pour ceux qui nous ont rendus meilleurs. Nous ne pouvons pas rendre grâce pour ce qui nous rend coupable ; Il arrive que ce pourquoi nous avons rendu grâce soit devenu mauvais par notre propre faute. De même, nous ne devons pas remercier pour les choses qui nous ont rendus meilleurs. Les remerciements du pharisien pour ses bonnes œuvres sont un exemple éminent de remerciement à ne pas faire (7). En fait, il ne remercie pas Dieu, par reconnaissance de sa bonté, mais il se remercie lui-même. Combien d’entre nous se remercient en remerciant Dieu ! On ne peut pas se remercier soi-même, parce qu’un sacrifice d’action de grâce, s’il s’adresse à soi-même, cesse d’être un sacrifice. Se remercier soi-même, ce n’est pas remercier, même quand des prières de remerciement à Dieu se dissimulent dans les remerciements qu’on s’adresse à soi-même. Par exemple, après avoir réussi un travail, ou après un succès durement remporté.
Lire la Bible avec ces questions à l’esprit nous ménage des surprises – la troisième partie du livre des Psaumes, en particulier. On découvre que la louange de Dieu remplit maintes pages décrivant en même temps de façon très dramatique la misère des hommes – y compris de ses auteurs. Nous avons l’impression de pénétrer, en les lisant, dans un autre domaine. Nous ne pouvons pas reproduire en nous ce qui est arrivé à ces hommes. Nous voyons notre situation et nous n’y trouvons que peu de raisons de louer et de remercier. Et si nous pensons que c’est un devoir de rendre grâce à Dieu, ou si nous prenons part dans une église à un culte de louange et d’action de grâce, nous n’avons pas vraiment le sentiment d’exprimer notre état d’esprit. Bien que cette expérience ne soit pas invariable, elle est un trait dominant dans la situation religieuse aujourd’hui. Le message des meilleurs prédicateurs et des meilleurs théologiens contemporains l’exprime. C’est un thème dominant chez nos grands poètes et chez nos grands philosophes. Nous ne sommes pas appelés à juger ces hommes. Nous nous reconnaissons en eux. Ils nous expriment autant qu’ils s’expriment. Nous devrions remercier ceux qui le font avec sérieux et souvent au prix d’une profonde souffrance.
La différence entre notre situation et celle des périodes précédentes devient visible quand nous considérons la passion et la force avec lesquelles les membres de l’Église primitive ont rendu grâce pour le don du Message chrétien, dans le monde des gloires païennes destructives et désespérantes. Avons-nous la même passion et la même force quand nous remercions Dieu pour le don qu’il nous a fait en Christ et dans son Église ? Qui peut honnêtement répondre « oui » ?
Ne sentons-nous pas le sentiment d’une même différence quand nous lisons comment les protagonistes de la Réformation remerciaient Dieu pour la redécouverte de la bonne nouvelle de l’acceptation divine des pécheurs ? Avons-nous la même préoccupation infinie ? Qui peut répondre honnêtement « oui » ? Par conséquent, nous devons être reconnaissant à l’égard de ceux qui expriment notre situation présente avec honnêteté.
Il existe une consolation : nous ne sommes pas séparés de la présence toujours active de Dieu, et nous pouvons en devenir conscients à chaque instant. Nos cœurs peuvent se remplir de louanges et de remerciements, sans les exprimer avec des mots ; quelquefois, nous pouvons trouver des mots pour l’exprimer. Mais ce n’est pas le premier pas, ni même souvent le dernier. Ne suivons pas ceux qui utilisent le soi-disant « renouveau religieux » pour nous forcer à revenir à des formes de prière et d’actions de grâce que nous ne pouvons honnêtement accepter, ou qui crée la joie et la gratitude par autosuggestion. Mais restons ouverts à la puissance qui soutient notre vie ici et maintenant et à tout moment, et qui vient à nous dans la nature et avec le message de Jésus-le Christ. Puissions-nous lui rester ouverts, remplis de gratitude silencieuse pour le pouvoir d’être présent en nous. Alors, les paroles de remerciement, les paroles du sacrifice et de la consécration pourront, peut-être, venir sur nos lèvres, afin qu’à nouveau nous puissions rendre grâce avec vérité et honnêteté.
Prière de Paul Tillich
Dieu tout-puissant ! Nous élevons nos cœurs à toi pour te louer et te remercier. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, et nous n’avons rien, sauf ce que tu nous as donné. Nous sommes dans la finitude ; nous n’avons rien apporté dans notre monde ; nous n’emporterons rien de notre monde. Tu nous as donné la vie que nous avons tant que c’est ta volonté. Nous te remercions d’être et de partager, dans les petites et les grandes choses, les richesses inépuisables de la vie. Nous te louons, quand nous éprouvons de la force dans notre corps et dans notre âme. Nous te remercions quand la joie emplit nos cœurs. Nous sommes conscients de ta présence avec gratitude, silencieusement, ou en paroles.
Éveille cette conscience, quand notre vie journalière nous cache ta présence, et que nous oublions combien tu es, toujours et partout, proche de nous, plus proche de nous que tout ce qui est auprès de nous, plus proche de nous que nous le sommes de nous-mêmes. Ne nous laisse pas nous détourner de ta présence donatrice et créatrice, pour les choses que les dons que tu nous as faits. N’oublions pas le créateur derrière la création. Rends-nous toujours prêts au sacrifice d’action de grâce.
Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est à toi. Nous te le consacrons. Reçois nos remerciements quand nous te disons « Merci mon Dieu », pour notre nourriture et avec elle, pour tout ce que nous recevons chaque jour. Garde-nous de la routine et des pures conventions, quand nous osons te parler.
Nous te remercions en revoyant tout ce que notre vie, longue ou brève, nous a permis de rencontrer. Nous te remercions, non seulement pour ce que nous avons aimé et qui nous a donné du plaisir, mais aussi pour ce qui nous a déçu, peiné, et fait souffrir, parce que nous savons maintenant que cela nous a aidé à réaliser pourquoi nous étions nés. Et si de nouvelles déceptions et de nouvelles souffrances s’emparent de nous, et que les paroles de remerciement meurent sur nos lèvres, rappelle-nous qu’un jour nous serons prêts à te remercier pour la route obscure où tu nous as conduit.
Nos paroles de remerciement sont pauvres ; souvent nous ne trouvons pas les mots pour les exprimer. Pendant des jours des mois et des années, nous avons été incapables de te parler, et cela continue. Donne-nous la force, à ces moments-là, de maintenir nos cœurs ouverts à la surabondance de la vie, et de faire l’expérience de ta présence éternelle et immuable dans la gratitude silencieuse. Reçois le sacrifice silencieux de nos cœurs, quand les paroles de reconnaissance se font rares en nous. Accepte notre gratitude silencieuse et garde nos cœurs et nos esprits toujours ouverts pour toi !
Nous te remercions pour tout ce que tu as accordé à cette nation, plus qu’à tout autre ! Restons-en reconnaissants afin de surmonter les dangers d’une vie superficielle et d’un cœur vide, qui menacent notre peuple. Préserve-nous de transformer tes dons en cause de préjudices et d’autodestruction. Que la gratitude nous protège de la désagrégation de nos personnes et de notre nation. Tourne-nous vers toi, Dieu éternel, source de notre être ! Amen.
Paul Tillich
Les prédications de Paul Tillich sur ce site :
- Paul Tillich : 4 Prédications sur le sens de l’existence et l’Être nouveau
- Paul Tillich : 3 prédications pour trouver la Joie et le Sens dans la Profondeur de l’Existence
- Paul Tillich : 3 Prédications sur le Mystère du Temps et la Signification de l’Éternel Maintenant
- Paul Tillich : 5 Prédications sur Romains 8 pour une spiritualité de l’être


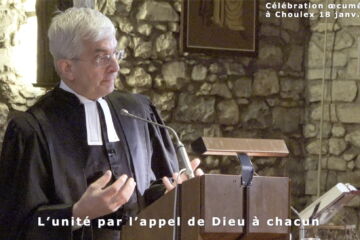
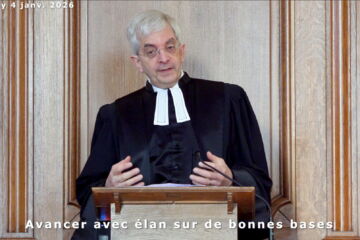



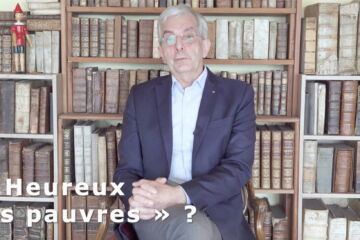
Marc, merci infiniment pour ce partage, ces passionnantes lectures qui donnent à penser !
Je suis très étonnée des propos de Tillich qui vont très très loin. Chacune de ses prédications est extrêmement poussée. Il va falloir un peu de temps pour les digérer.
Je m’arrête sur la notion de profondeur d’abord. C’est un terme qui m’interpelle car je l’emploie très souvent pour indiquer que le sens de la lecture n’est pas horizontal mais vertical, qu’il s’agit bien de s’immerger et que nous serons affectés un tant soit peu par une expérience de lecture, que ce soit celle d’un ouvrage ou de n’importe quelle autre expérience et ce parce qu’il se produira une confrontation. Un texte qui n’offre aucune résistance relève, lui, de la lecture littérale, c’est même à cela qu’on peut le reconnaître, on ne rentre pas dedans.
Et comme il le dit, la confrontation ou la résistance peut provoquer le demi-tour au motif que c’est trop compliqué. Ou, comme on dit, que ce n’est « pas intéressant », pour éviter de chercher. Moi aussi, j’ai su faire cela très bien. Alors qu’il y a très peu de choses qui soient inintéressantes en réalité. C’est pourquoi on trouve des passionnés dans tous les domaines, ceux qui ont réussi à atteindre les profondeurs donc. Mais ensuite, associer la profondeur à Dieu c’est presque étrange car cela le rend extrêmement flou, et bouleverse des représentations traditionnelles. J’imagine que Tillich n’a pas dû se faire que des amis.
Et j’ai eu du mal à saisir pourquoi l’association aussi insistante de la souffrance sur le chemin de la profondeur :
« la profondeur de la vérité, dont la seule voie se trouve dans la profondeur de la souffrance »,
« la profondeur du sacrifice, de la souffrance et de la Croix est demandée à la pensée »,
« Le langage paradoxal de la religion révèle que la voie de la vérité est la voie de la profondeur, et, par conséquent, la voie de la souffrance et du sacrifice », Tillich pousse assez loin ici.
Ce chemin est dérangeant sans doute, on est en déséquilibre mais de là à parler de sacrifice ? de Croix ? Il y a certes toute une tradition chrétienne même platonicienne qui y réfère à ce type de schéma mais le Christ ne dit pas : « je suis le chemin, le sacrifice et la vie ». Si ?
Tillich affirme quand même heureusement que cela débouche sur la joie. Il arrive qu’on en bave dans une randonnée en montagne mais arrivés au sommet, quelle joie ! C’est pareil pour tout effort qui coûte et même sans résultat un effort pénible peut déjà se réaliser dans la joie voire être joie.
Mais le contraire me semble aussi vrai : une approche superficielle du monde – une approche de surface comme il le dit – est aussi malaisante et loin de se montrer satisfaisante. Les dépressions, les mal-être, l’angoisse ne se font-ils pas sentir lorsque nous sommes sur cette surface – volontairement ou non, lorsque nous avons l’impression d’assister à un film et que nous ne nous sentons plus concernés par rien ? Quel esprit pourrait « avec sérieux » se satisfaire de la simple matérialité, de la surface de l’être, sans en ressentir un malaise sinon immédiat du moins à long terme ? Et dans ce cas lorsqu’on aborde cette profondeur, ce n’est pas toujours dans la souffrance ou le sacrifice, au contraire, c’est une bouffée d’oxygène. Peut-être est-ce une illusion et n’y a -t-il rien finalement dans cette profondeur, pas plus de sens qu’à la surface, mais bizarrement on cherche et on respire.
Grand merci, c’est très intéressant comme retour.
Cet accent sur la croix et le sacrifice est un peu inquiétant, il est vrai.
Bien fraternellement
Marc