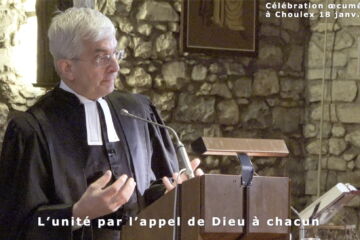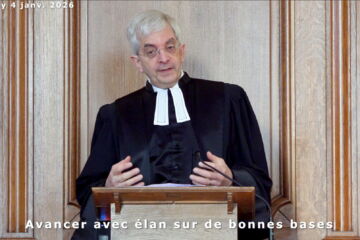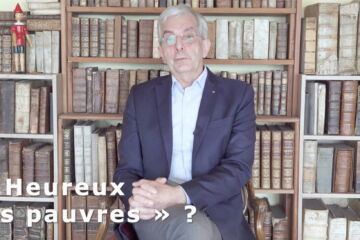Paul Tillich est l’un des théologiens les plus influents du XXe siècle, il est une figure de proue de la théologie existentialiste. Ces prédications de Paul Tillich offrent une lecture existentielle du chapitre 8 de l’épître aux Romains. Le théologien y explore la tension entre la fragilité humaine et la présence de l’Esprit, proposant un sens renouvelé à la providence et à la prière au cœur des épreuves du monde moderne. Une réflexion où la foi se décline comme un courage d’être en dépit de l’incertitude.
Après Une introduction à cette série de prédications par leur traducteur, vous trouverez ici ces prédications :
- Le témoignage de l’Esprit, sur Romains 8, 1-16, 26-27.
- Attendre, sur Romains 8, 24-25
- Le paradoxe de la prière, sur Romains 8, 26-27
- Principats et puissance, sur Romains 8, 36-39
- Le sens de la providence, sur Romains 8, 38-39
Une introduction à cette série de prédications de Paul Tillich
L’affinité de Paul Tillich pour la pensée de l’apôtre des «païens» est manifeste. Sur les soixante et un sermons publiés dans les trois volumes de prédication, dix sept interprètent des péricopes empruntées au corpus des écrits pauliniens, dont les cinq sur des versets du chapitre Romains 8 réunis dans cette anthologie. L’expérience humaine de Paul, qu’on peut dire «mystique» et que Tillich qualifie d’«extatique», retient spécialement l’attention du prédicateur. Il considère d’abord que certains aspects de l’anthropologie contemporaine, notamment de la psychanalyse freudienne, se trouvent préfigurés dans les textes de l’apôtre. «Une figure subjective de première importance» écrit le philosophe Alain Badiou (1). Mais surtout, Paul (l’apôtre) parle à Paul Tillich (théologien du XXè siècle).
Celles et ceux qui assument de bon cœur la charge redoutable et magnifique de la prédication, trouveront, plus d’un demi siècle après la rédaction de ces textes, quelques leçons d’herméneutique pratique encore valides, peut-être plus actuelles qu’elles ne le furent à l’époque où le public francophone découvrait au tournant des années soixante le «théologien de la culture» Quant au lecteur, il creusera, méditera, approfondira ce qu’il découvrira au fil de sa lecture, comme le scribe instruit du règne des cieux, dont parlait Jésus, semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses d’anciennes.
Les prédications : La signification de la Providence (v.38-39), Attente (v. 24-25) et Le témoignage de l’Esprit (v. 16 et 26-27) proviennent du volume The Shaking of the Foundations de 1949 (Les fondations sont ébranlées). Principats et puissances (v. 38-39), et Le Paradoxe de la Prière (26-27) sont extraits de The New Being publié en 1955 (l’être nouveau).
Le témoignage de l’Esprit, une prédication de Paul Tillich sur Romains 8, 1-16, 26-27
L’expérience de la vie dans l’Esprit
Ce texte sonne difficilement à nos oreilles de modernes. Il semble étrange et presque inintelligible. Des mots comme «esprit» et «chair», «péché» et «loi», «vie» et «mort», et leurs différentes combinaisons, semblent des abstractions philosophiques plutôt que des descriptions concrètes de l’expérience chrétienne. Mais, pour Paul, ils expriment l’expérience la plus réelle et la plus concrète de sa vie. Le chapitre huit de sa lettre aux chrétiens de Rome ressemble à un hymne louant en paroles extatiques la réalité nouvelle qui lui est apparue, qui a été révélée dans l’histoire, et qui a transformé son existence entière. Paul appelle «Christ» cet être nouveau, pour autant qu’il est d’abord été vu en Jésus le Christ. Il l’appelle «Esprit», dans la mesure où c’est une réalité dans l’esprit de chaque chrétien et dans l’esprit qui construit l’assemblée des chrétiens, en tout lieu et en tout temps. Les deux noms désignent la même réalité. Christ est l’Esprit et l’Esprit est l’Esprit du Christ. Le chrétien est celui qui participe à cette réalité nouvelle, autrement dit, celui qui a l’Esprit. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Être chrétien signifie avoir l’Esprit ; toute description du Christianisme doit être une description des manifestations de l’Esprit. Suivons la description de l’Esprit donnée par Paul et comparons la avec notre expérience. Ce faisant, nous pourrons découvrir combien nous sommes loin de l’expérience de Paul, et en même temps, combien notre expérience ressemble à la sienne. Ses paroles étranges peuvent nous en révéler davantage sur notre vie que tout ce que nos contemporains ont pu penser et écrire sur la nature, la vie et le destin de l’homme.
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ces mots supposent que notre esprit est incapable de nous donner une telle assurance. Notre esprit – c’est-à-dire, notre raison, notre pensée, notre volonté, nos sentiments, notre vie intérieure tout entière – ne peut pas nous donner la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Cela ne signifie pas que Paul déprécie la nature et l’esprit de l’homme. Au contraire, en parlant de notre esprit, il reconnaît la créativité de l’homme, sa similitude avec Dieu qui est Esprit, sa capacité de se libérer de la vanité et de s’affranchir de la corruption, et, en se libérant, de libérer toute la nature avec lui. Nous sommes aussi sa lignée, dit-il aux Athéniens dans le célèbre discours sur l’Aréopage (8) où il approuve leurs philosophes. Paul évalue l’homme aussi haut que les modernes. Un célèbre philosophe de la Renaissance a décrit lyriquement la place de l’homme au centre de la nature, son infinité, sa créativité, et, en lui, un accomplissement de toutes les puissances naturelles. Paul approuverait. Mais Paul sait aussi ce que les philosophes grecs ne savaient pas et que les philosophes de la Renaissance avaient oublié : l’esprit de l’homme est lié à la chair de l’homme, et la chair de l’homme est l’ennemie de Dieu.
La «chair de l’homme» ne désigne pas le corps de l’homme. Selon Paul, le corps de l’homme peut devenir le temple de l’Esprit. La «chair de l’homme» désigne les penchants naturels, les désirs, les besoins, la façon de penser, le but de la volonté, le caractère de la vie affective de l’homme, pour autant que séparé de l’Esprit, il lui est hostile. La «chair» est une distorsion de la nature humaine, une créativité abusive – en premier lieu un abus de son caractère infini au service de ses désirs et de sa volonté de puissance sans limites. Ce désir- que nous connaissons mieux par la psychologie récente- et cette volonté de puissance – que nous montre la sociologie moderne – ont, dans le temps et l’espace, leurs racines dans notre existence individuelle, dans notre corps et dans notre âme. C’est ce que Paul appelle la puissance de distorsion de la chair.
Paul décrit la volonté de la chair avec une profondeur inégalable. L’esprit charnel (l’esprit dans la chair) est l’ennemi de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu ; elle en est même incapable. Si une loi nous est donnée, que nous devons reconnaître, et que nous ne pouvons respecter, notre âme nourrit inévitablement de la haine à l’égard de celui qui nous a donné cette loi. Le père, comme représentant de la loi qui s’oppose au désir de l’enfant, devient inévitablement l’objet de la haine inconsciente de l’enfant qui peut devenir consciente et peut se manifester avec une violence formidable. Ce ne serait pas le cas, si la loi s’opposant aux désirs désordonnés et sans limites de l’enfant, n’était pas ressentie, par lui, comme arbitraire et injustifiée. Mais il sent qu’elle est justifiée. Elle est devenue une partie de son «surmoi», comme on dit en psychologie récente, ou, elle est devenue un impératif de la conscience comme le dit l’ éthique traditionnelle. Parce que la loi que le Père donne à l’enfant est bonne et que l’enfant ne parvient pas à reconnaître que la loi est inéluctable, ce dernier doit haïr le père, qui il lui semble la cause de la déchirure qui torture son âme. Voilà la situation de l’homme devant Dieu. L’homme naturel hait Dieu et le regarde comme un ennemi, parce qu’il représente à ses yeux la loi inaccessible contre laquelle il lutte, et qu’il doit la reconnaître en même temps comme juste et bonne. Sur ce point, il n’y a pas de différence entre «théiste» et «athée». L’athéisme n’est qu’une forme de l’inimitié contre Dieu, c’est-à-dire, de Dieu en tant que représentant de la loi, et, avec la loi, de la déchirure, du désespoir et de l’insignifiance de l’existence. L’«athée», comme le «théiste», refuse d’être confronté à son devoir, au sens et au bien ultime, qu’il ne peut nier ni atteindre. L’«athée» nomme autrement le Dieu qu’il hait et auquel il ne peut échapper, de même qu’il ne peut échapper à la haine qu’il lui porte. Voilà pourquoi Paul dit : L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre esprit témoigne seulement du fait que nous sommes ses ennemis !
Quand le Christianisme nous parle de Dieu, du Dieu d’amour dans la vie de tous les jours, il doit nous rappeler que la majesté de Dieu est défiée chaque fois que nous en faisons un Père aimant avant d’avoir reconnu sa loi qui nous condamne et que nous haïssons au tréfonds de notre cœur.
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il s’est produit quelque chose de nouveau : une réalité nouvelle, un être nouveau, un Esprit distinct de notre esprit, et cependant apte à se faire comprendre de notre esprit, un Esprit au-delà de nous et cependant en nous. Le message du Christianisme se résume dans cette affirmation. Le Christianisme vainc la loi et le désespoir avec la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Il n’y a rien de plus élevé. Bien que nous soyons dans la chair, sous la loi et dans les clivages de l’existence, nous sommes, en même temps, dans l’Esprit, dans l’accomplissement, unis au sens ultime de notre vie. Ce paradoxe est pour Paul, à vue humaine, le contenu étonnant et incroyable du Christianisme. Cette certitude l’a poussé à prêcher son message dans le monde entier afin de l’y gagner. Elle lui a donné la force de rompre avec sa caste, avec sa nation et de supporter beaucoup de souffrances, beaucoup de conflits et finalement le martyr. Christ est vainqueur de la loi, du système de commandements, qui fait de nous des esclaves, parce que nous ne pouvons pas lui échapper, et qui nous plonge dans le désespoir, parce qu’il nous rend ennemis de notre destin et de notre bien ultime. Avoir la certitude d’être enfants de Dieu, c’est pour Paul «avoir l’Esprit». De cette certitude découle toute l’existence chrétienne. Tout d’abord, cette certitude nous donne la possibilité de crier Abba, Père ! c’est-à-dire, de prier le Notre Père. Seul celui qui a l’Esprit peut dire à Dieu : «Père» !
Tout le monde peut dire le «Notre Père». Il est récité des millions et des millions de fois chaque jour. Mais, parmi ceux qui le récitent, combien ont reçu la capacité de le prier ? La paternité de Dieu, le concept le plus grand et le plus incroyable du Christianisme, est devenue au quotidien un mot très ordinaire et très insignifiant. Le Christianisme a oublié que chaque fois que Dieu est invoqué en Père, l’inimitiée contre Dieu est vaincue et la certitude extatique de notre filiation est reçue de l’Esprit. En dehors du Christianisme, beaucoup de gens le savent mieux que ceux qui se trouvent à l’intérieur. Ils savent qu’il est paradoxal et impossible de nommer Dieu «Père». Mais, quand cela se produit, l’homme trouve la liberté ; l’ «esprit d’esclavage» de la peur disparaît ; l’obéissance cesse d’être une obéissance pour être une disposition spontanée; le «moi» et le «surmoi» sont unis. Telle est la liberté des enfants de Dieu ; libérés de la loi, ils sont aussi libérés de la condamnation et du désespoir.
Ceux qui ont reçu l’Esprit ne marchent pas selon la chair, mais selon l’Esprit. La puissance infinie du désir, et de la volonté de puissance illimitée, sont brisées. Mais elles ne sont pas éteintes ; la faim et la soif de la vie demeurent. Mais, quand l’Esprit est présent en nous, le désir se transforme en amour et la volonté de puissance en justice. Dans le grand chapitre sur l’amour de la Première lettre de Paul aux Corinthiens (9), Paul précise que l’amour est le fruit de l’Esprit et qu’il n’existe pas d’amour sans l’Esprit. L’amour n’est pas une affaire de loi. Il n’existe pas s’il est commandé. Il n’est pas, non plus, une affaire d’affectivité. Il est impossible à l’homme naturel. Sa manifestation est extatique, comme celle de tous les dons de l’Esprit.
Enfin, l’Esprit est la vie : si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. L’un de nos contemporains, Sigmund Freud, a découvert la volonté de mort à la racine de notre désir infini. L’individu sentant l’impossibilité de réaliser son désir, veut s’en débarrasser en se perdant comme individu. La mort est inévitable ; elle est aussi un choix. Nous ne devons pas seulement mourir, nous voulons aussi mourir, car vivre selon la chair, c’est mourir.
Paul ajoute, si par l’Esprit vous faites mourir les agissements de la chair, vous vivrez. L’Esprit est la vie, la vie créatrice. comme le chante l’hymne ancien Veni Creator Spiritus. Le mot «esprit» a largement disparu du langage quotidien et presque complètement de la terminologie scientifique. On l’a remplacé par «raison». Mais la raison raisonne sur ce qu’elle a ; elle analyse la vie, et souvent la tue. Elle n’est pas la vie ; elle n’a pas de puissance créatrice. L’Esprit est puissance et aussi raison ; il les unit l’une et l’autre et les transcende. Il est la créativité de la vie. La puissance seule, la raison seule, ne créent ni œuvre d’art, ni poésie, ni philosophie, ni politique ; seul l’Esprit peut les créer avec puissance et dans la raison, individuellement et universellement. Nous admirons en toute grande œuvre humaine, la profondeur inexhaustible de son caractère individuel et incomparable, la puissance de ce qui se produit une fois sans pouvoir être répétée, à toutes les époques, siècles après siècles, visiblement et universellement. Aucun argument rationnel ne peut donner la certitude. Le fini ne peut pas démontrer l’infini ; il ne peut atteindre jamais Dieu et sa propre éternité. Mais, il y a deux certitudes. L’une se trouve en chaque âme qui se connaît soi-même. C’est la certitude imposée par la loi, que ni la mort ni la vie, ni le courage ni la fuite, ne peuvent nous libérer d’être ce que nous devons être, avec l’impossibilité de l’être, dont le désespoir est la condamnation. Le désespoir éternel nous saisit au moment où nous devenons conscients que la loi témoigne contre nous. L’autre certitude se trouve en ceux qui ont l’Esprit ; ils sont au-delà de leur finitude et ils n’ont pas besoin de démonstration, l’éternité est présente. Ce n’est pas une affaire de vie future après la mort, c’est la présence saisissante de l’Esprit qui est la Vie au-delà de la vie et de la mort.
Dans le récit de la Pentecôte (10), la créativité de l’Esprit du Christ se manifeste dans les deux directions de l’individuel et de l’universel. Chaque disciple reçoit la langue de feu de la nouvelle créativité de l’Esprit. Les membres de toutes les nations, séparés par leurs langues différentes, se comprennent les uns les autres dans l’Esprit nouveau qui crée la paix nouvelle au-delà des divisions de Babel qu’est la paix de l’Église. En outre, pour Paul, l’Esprit est la vie éternelle. Il est clair que la certitude d’être des enfants de Dieu, celle d’être unis au sens éternel de la vie, est soit éternelle, soit n’est rien. On ne peut démontrer l’immortalité de notre âme. Nous sommes, ici et maintenant, plongés sans cesse dans le désespoir que la loi attire sur nous. Nous sommes, ici et maintenant, plongés dans la vie inépuisable que crée l’Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu.
On dira : «Je n’ai pas reçu ce témoignage. Je n’ai pas fait l’expérience de l’Esprit dont parle Paul. En ce sens, je ne suis pas chrétien.» Écoutons la réponse de Paul. C’est, probablement, la plus troublante et la plus mystérieuse de ses paroles : De même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l’Esprit ; car c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. Paul reconnaît que nous sommes ordinairement prisonniers de notre faiblesse et que celle-ci rend impossible l’expérience de l’Esprit, et la prière authentique. Il nous dit aussi, que nous ne devons pas croire que l’Esprit est loin de nous en ces moments-là. Il est en nous, sans que nous en fassions l’expérience. Les soupirs ineffables des profondeurs de notre âme, Dieu les considère comme l’œuvre en nous de son Esprit. À celui qui cherche Dieu et qui ne peut le trouver, à celui qui recherche à sa vie un sens nouveau et impérissable, et qui ne le découvre pas, Paul dit : Nous sommes tous cet homme. Dans cette situation, quand, précisément, l’Esprit est loin de notre conscience, quand nous sommes incapables de prier ou de faire l’expérience d’un sens à la vie, l’Esprit travaille silencieusement la profondeur de nos âmes. Au moment où nous nous sentons séparés de Dieu, dépourvu d’un sens à notre vie, et condamnés au désespoir, nous ne sommes pas seuls. L’Esprit, en nous et avec nous, soupire et désire. Il nous représente. Il rend manifeste ce que nous sommes réellement. Éprouvant cela en dépit de toute expérience, le croyant en dépit de toute croyance, le sachant, en dépit de tout savoir, nous, comme Paul, nous possédons tout. En dehors de cette expérience, nous ne possédons rien. Paul, malgré sa foi courageuse et son mysticisme profond, est plus humain, plus réaliste, plus proche des faibles que des forts. Il sait que nous tous, ainsi que toute créature, nous sommes en attente ; avec les animaux et les fleurs, les océans et les vents, nous sommes tous des êtres désirants et souffrants. Le deuil insondable de toutes les créatures fait écho au deuil insondable de l’âme. Et pourtant il écrit a lettre sur l’Esprit et la Vie comme un chant de triomphe et d’extase. Son esprit ne lui a inspiré d’écrire les paroles qu’il a écrite mais c’est l’Esprit qui a témoigné à son esprit et qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Paul Tillich
Attendre, une prédication de Paul Tillich sur Romains 8, 24-25
La condition de l’attente spirituelle
L’Ancien et le Nouveau Testament, décrivent tous les deux notre existence en relation avec Dieu comme une attente. Chez le psalmiste, l’attente est angoissée ; chez l’apôtre, l’attente est patiente. Attendre signifie simultanément : ne pas avoir et avoir. Car nous n’avons pas ce que nous attendons, ou, comme le dit l’apôtre : si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons… La condition de la relation de l’homme avec Dieu est en premier lieu ne pas avoir, ne pas voir, ne pas connaître, ne pas saisir. La religion qui oublie cela , qu’elle soit extatique, pratique, ou raisonnable, cette religion substitue à Dieu une image de Dieu de sa création. Notre vie religieuse est caractérisée beaucoup plus par ce genre de création, que par toute autre chose. Je pense au théologien qui n’attend pas Dieu, parce qu’il le possède enclos dans une doctrine. Je pense au bibliste qui n’attend pas Dieu parce qu’il le possède enclos dans un livre. Je pense à l’homme d’Église qui n’attend pas Dieu, parce qu’il le possède enclos dans une institution. Je pense au croyant qui n’attend pas Dieu, parce qu’il le possède enclos dans sa propre expérience. Il n’est pas facile de supporter le non avoir Dieu, l’attente de Dieu. Il n’est pas facile de prêcher dimanche après dimanche sans chercher à se convaincre, et à convaincre autrui, que nous avons Dieu, que nous disposons de lui. Il n’est pas facile de parler de Dieu aux enfants et aux païens, aux sceptiques et aux laïques, tout en disant clairement que nous ne possédons pas Dieu, que, nous aussi, nous l’attendons. Je suis persuadé qu’une bonne part de la révolte contre le Christianisme a pour cause la prétention manifeste, ou dissimulée, des chrétiens de posséder Dieu, et, par conséquent, la perte de l’attente, si décisive chez les prophètes et les apôtres. Ne nous leurrons pas en pensant qu’en parlant de la fin, ils n’attendaient que la fin dernière, le jugement et l’accomplissement de toute chose, et non pas Dieu, celui de qui procède la fin. Ils ne possédaient pas Dieu ; ils l’attendaient. Comment posséder Dieu ? Dieu est-il une chose qu’on peut saisir et connaître comme n’importe quoi? Dieu est-il moins qu’une personne humaine ? Nous attendons toujours un être humain. Le non avoir et le non connaître de l’attente est présent jusque dans la communion la plus intime entre deux êtres. Du fait que Dieu est infiniment caché et incommensurable, nous devons l’attendre de la manière la plus absolue et la plus radicale. Il est Dieu, précisément, parce que nous ne le possédons pas. Le psalmiste en disant qu’il attend le Seigneur de tout son être montre que l’attente de Dieu n’est pas un simple aspect de notre relation avec Dieu, mais qu’elle est la condition même de cette relation. Nous avons Dieu en ne l’ayant pas.
Mais, bien qu’attendre ne soit pas avoir, c’est aussi avoir. Le fait que nous attendons une chose montre que nous la possédons déjà d’une certaine façon. L’attente devance ce qui n’est pas encore réel. Si nous attendons avec espérance et patience, ce que nous attendons produit déjà en nous son effet. Celui qui attend, en sens ultime, n’est pas loin de ce qu’il attend. Celui qui attend absolument sérieusement a déjà reçu la puissance de ce qu’il attend. Celui qui attend passionnément est déjà lui-même une puissance active, la plus grande puissance qui transforme la vie personnelle et la vie historique. Nous sommes plus fort quand nous attendons que quand nous possédons. Quand nous possédons Dieu, nous le réduisons au peu de chose que nous connaissons et que nous saisissons de lui ; nous en faisons une idole. Dans les cultes idolâtres, on croit posséder Dieu. Cette idolâtrie est très répandue parmi les Chrétiens.
Mais si nous savons que nous ne le connaissons pas, et si nous attendons qu’il se fasse connaître lui-même, alors nous connaissons vraiment quelque chose; alors nous sommes saisis, connus et possédés par Dieu. C’est alors que nous sommes croyants en dépit de notre incroyance, et qu’il nous accepte malgré que nous soyons séparés de lui.
Toutefois, n’oublions pas la tension formidable qu’est l’attente. Elle empêche toute complaisance à l’égard de la non-possession, l’indifférence ou le mépris cynique à l’égard de ceux qui possèdent quelque chose. l’indulgence à l’égard du doute et du désespoir. Ne nous-nous vantons pas de ne rien posséder comme s’il s’agissait d’une possession nouvelle. C’est l’une des grandes tentations de notre temps, car il ne reste plus grand chose que nous ne puissions prétendre posséder. Nous succombons à la même tentation, quand nous-nous vantons de ne pas posséder Dieu dans notre tentative pour le posséder. La réponse divine à ce genre de tentative est le vide complet. Attendre n’est pas désespérer. C’est accepter le non-avoir par la puissance de ce que nous avons déjà.
Notre époque est un temps d’attente ; attendre est son destin particulier. Et tout temps est un temps d’attente, le temps d’attendre l’irruption de l’éternité. Le temps avance. Le temps, tout entier est attente, dans l’histoire et dans la vie personnelle. Le temps lui-même est attente, non pas l’attente d’un autre temps, mais de ce qui est éternel.
Paul Tillich
Le paradoxe de la prière, une prédication de Paul Tillich sur Romains 8, 26-27
La prière comme acte de l’Esprit
Ce passage de l’épître aux Romains sur l’Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables est l’une des paroles les plus mystérieuses de Paul. Il exprime l’expérience d’un homme qui sait comment prier, et parce qu’il sait comment prier, dit qu’il ne sait pas comment prier. Nous pouvons, probablement, tirer de cette confession de l’apôtre la conclusion que ceux qui, parmi nous, font comme s’ils savaient comment prier, ne le savent pas du tout. À l’appui de cette conclusion nous pourrions trouver beaucoup d’exemples dans la vie quotidienne. Les ministres des Églises sont habitués à prier publiquement à toutes sortes d’occasions, certaines s’offrant naturellement à la prière, d’autres artificiellement et contre tout bon goût. Il n’est pas inutile de connaître le bon moment, ou le mauvais moment, de prier. Cet avertissement est à la périphérie de ce que Paul veut dire, mais il est nécessaire, spécialement à l’intention des ministres et des responsables laïcs de l’Église.
Le pas suivant nous rapproche du centre du propos de Paul. Il existe deux types de prières : les prières liturgiques fixes et les prières spontanées. Ces deux types montrent la vérité de l’affirmation de Paul que nous ne savons pas prier comme il faut. Les prières liturgiques deviennent souvent mécaniques ou incompréhensibles, et souvent les deux à la fois. L’histoire de l’Église montre que cela a été le sort même de la prière du Seigneur. Paul connaissait certainement le Notre Père, quand il a écrit que nous ne savons pas comment prier. Faire de l’exemple de prière donnée par Jésus à ses disciples une règle liturgique, ne prouve pas qu’on sache comment prier.
Si maintenant nous passons de la prière liturgique à la prière spontanée, les choses ne se présentent pas mieux ! Souvent, la prière spontanée n’est qu’une conversation ordinaire avec quelqu’un qu’on appelle Dieu, mais qui pourrait être un autre homme, auquel on raconterait ceci et cela, souvent longuement, que l’on remercierait et dont on attendrait des faveurs. Cela non plus ne prouve pas que nous savons comment prier.
Les Églises utilisant dans leurs liturgies des formules classiques devraient se demander si elles n’empêchent pas les gens d’aujourd’hui de prier, comme ils le pourraient honnêtement. Les Églises sans liturgie, qui laissent la liberté de prononcer des prières à tout moment, devraient se demander si elles ne profanent pas la prière en la privant de son mystère.
Maintenant avançons d’un troisième pas, au centre de la pensée de Paul. Au bon ou au mauvais moment, que la prière soit formulée ou spontanée, la question décisive demeure : la prière est-elle possible ou non ? D’après Paul, elle est humainement impossible. Nous ne devrions jamais oublier, quand nous prions, que nous faisons quelque chose d’humainement impossible. Nous parlons à quelqu’un qui n’est pas quelqu’un d’autre, mais qui est plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Nous nous adressons à quelqu’un qui ne devient jamais l’objet de notre discours parce qu’il est toujours sujet, toujours en train d’agir, toujours en train de créer. Nous lui racontons ce qu’il sait déjà, et, le lui racontant, nous exprimons les tendances inconscientes sur lesquelles poussent nos paroles conscientes. C’est pourquoi la prière est humainement impossible. Sur le fondement de cette idée, Paul apporte une solution mystérieuse à la question de la prière authentique. C’est Dieu lui-même qui prie en nous quand nous le prions. Dieu en nous : c’est ce que signifie «Esprit». Le mot Esprit est un mot différent pour dire «Dieu présent», avec sa puissance qui nous ébranle, nous inspire, et nous transforme. En nous, quelque chose qui ne vient pas de nous, intercède pour nous devant Dieu. Nous ne pouvons franchir le fossé qui nous sépare de Dieu, même avec les prières les plus intenses et les plus fréquentes. Seul Dieu peut franchir le fossé entre lui et nous. Ce symbole est absurde si on le prend à la lettre. Mais comme symbole authentique, il est profond. Le symbole de Dieu intercédant pour nous auprès de lui, dit que Dieu, en sait davantage sur nous que ce dont nous sommes conscients. Il sonde les cœurs des hommes. Ce sont des mots qui anticipent sur des conceptions contemporaines dont nous sommes fiers à juste titre, selon lesquelles les faibles lumières de notre conscience émergent sur la base plus large des pulsions et des images inconscientes. S’il en est ainsi, qui d’autre que Dieu lui-même, peut présenter notre être à Dieu ; il est le seul qui connaisse les profondeurs de notre âme ?
Cela va nous aider à comprendre la partie la plus mystérieuse de la description de la prière, où Paul dit que l’Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Précisément, parce que toute prière est impossible à l’homme ; précisément parce qu’elle présente à Dieu des niveaux profonds de notre être plus profond que la conscience, quelque chose advient qui ne peut se dire avec des mots. Les mots, créés et utilisés par et dans notre vie consciente ne sont pas l’essence de la prière. L’essence de la prière est l’acte de Dieu travaillant notre être et le présentant à lui. Paul appelle «soupir» la façon dont cela se produit. Le soupir est l’expression de la faiblesse dans notre existence de créature. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu qu’avec des soupirs inexprimables, et ces soupirs sont son œuvre en nous.
C’est enfin la réponse à la question que posent souvent les chrétiens : quelle est la prière qui convient le mieux à notre relation à Dieu ? La prière de remerciement, ou la prière de demande, la prière d’intercession, de confession ou de louange ? Paul ne fait pas ces distinctions. Elles dépendent des mots. Le soupir de l’Esprit est en nous trop profond pour les mots et pour la distinction en types de prières. La prière spirituelle élève à Dieu par la puissance de Dieu et elle inclut tous les types de prières.
Un dernier mot à l’intention de ceux qui sentent qu’ils ne trouvent pas de mots pour prier et qui restent en silence devant Dieu. Ce peut être l’absence de l’Esprit. Il se peut aussi que leur silence soit une prière silencieuse, autrement dit, des soupirs trop profonds pour les mots. Alors celui qui sonde le cœur de l’homme, les écoute et les comprend.
Paul Tillich
Principats et puissance, une prédication de Paul Tillich sur Romains 8, 36-39
Vaincre les forces du destin
Ces paroles sont parmi les plus fortes jamais écrites. Leur ton est capable de saisir l’âme humaine dans les situations désespérées. D’après mon expérience, elles se sont montrées plus fortes que le tonnerre de l’explosion des obus, que les larmes au bord d’une tombe et plus que le râle des mourants. Elles sont plus fortes que le dénigrement de soi de ceux qui désespèrent d’eux-mêmes et elles l’emportent dans les profondeurs de notre être sur les chuchotements de l’angoisse. Qu’est ce qui rend ces paroles si fortes ?
Ce n’est pas leur sens littéral ; il nous est étranger à bien des égards. Les anges et les principats, la hauteur et la profondeur, et même la vie et la mort, désignent les constellations d’étoiles qui, selon d’anciennes croyances, déterminent le destin des hommes et l’histoire. Sous leur coupe les hommes sont menés par la peur ; ils luttent avec courage, parfois victorieusement, mais le plus souvent sont défaits. C’était la condition des hommes auxquels Paul s’adressait. À plusieurs reprises, il résume dans ses lettres le sens du Christianisme avec le message que le Christ a vaincu les puissances qui gouvernent le monde, mais nulle part il ne l’affirme de façon aussi triomphale que par ces mots forts et beaux qu’il adresse aux Romains.
Pour que ces mots parlent à nos âmes aujourd’hui puissamment, ils doivent nous dire quelque chose dont nous sentons la vérité, en dépit du fait que nous ne partageons plus les anciennes croyances aux étoiles et aux constellations. Ils nomment les puissances sous la servitude desquelles nous sommes tous, avec tous les hommes à toutes les périodes de l’histoire, et la création toute entière. Ils montrent ce qui nous donne la certitude que ces puissances ne l’emporteront pas contre nous, qu’elles sont vaincus et que nous pouvons participer à la victoire remportée sur elles.
Qui, au cours des années récentes, en vérité au cours de ce siècle tout entier, n’a pas senti les forces irrésistibles qui déterminent notre destin personnel et celui de l’histoire ? Elles poussent les nations et les individus dans d’insolubles conflits intérieurs et extérieurs ; à l’insolence et la folie, à la révolte et au désespoir, à l’inhumanité et à l’autodestruction. Chacun de nous est engagé plus ou moins dans ces conflits menés par ces forces. D’une certaine manière, elles déterminent la vie personnelle de chacun d’entre nous. La sécurité n’est garantie à personne ; aucune maison, aucun travail, aucune amitié, aucune famille, aucun pays, où que ce soit dans le monde, n’est à l’abri ; aucun plan n’est certain de sa réalisation ; l’espérance est menacée. Ce n’est pas nouveau dans l’histoire humaine. Il est nouveau, par contre, qu’en quelques années de sécurité relative, nous ayons oublié, que tel est le cours véritable des choses. Nous le voyons de nouveau partout, parce que soudainement nous vivons en plein milieu sur toute la terre.
Poussés par les forces du destin, nous posons les questions que l’humanité a toujours posées : Qu’est-ce qu’il y là dessous ? Quel sens à cela ? Comment supporter cela?
Bien avant l’ère chrétienne, les peuples parlaient de la Providence divine à l’œuvre derrière les forces qui mènent la vie et l’histoire. Les paroles de Jésus sur les oiseaux du ciel et les lys des champs ; son commandement de ne pas se soucier du lendemain, ont fortifié dans le Christianisme la foi en la Providence. Elle est devenu la croyance la plus commune du peuple chrétien. Elle lui a donné le courage dans le danger, la consolation dans la tristesse, l’espérance dans l’effondrement. Mais, de plus en plus, cette foi a perdu sa profondeur. Elle allait de soi. Elle a perdu le caractère irrésistible, surprenant, triomphant, qu’elle a dans les paroles de Paul.
Quand les soldats allemands entrèrent dans la Première Guerre mondiale, la plupart partageaient la croyance au bon Dieu qui arrange au mieux les choses. Aujourd’hui tout va au pire parmi les nations et presque pour tout le monde. Dans les tranchées de la guerre, la croyance populaire en la Providence personnelle s’est effondrée graduellement, et à la cinquième année de la guerre, il n’en restait plus rien. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale un phénomène semblable s’est produit dans ce pays (4). La croyance à la Providence historique s’est écroulée dans les tensions politiques et les peurs des dix dernières années (5). La croyance que l’histoire arrange tout pour le mieux, largement partagée dans ce pays, a maintenant presque complètement disparue. Aujourd’hui, il n’en reste plus grand-chose.
Ni la croyance en une Providence personnelle ou une Providence historique n’ont de racines profondes ou de fondements réels. Ces croyances sont les produits de nos illusions (6) et non de la foi. La foi en la Providence n’est pas un élément de la foi Chrétienne ; un élément plus facile à comprendre que ses autres éléments. Comme, Les gens croient en la Providence, me dit un jour un vieux pasteur rural, mais les contenus plus élevés de la foi chrétienne, le péché et le salut, le Christ et l’Église, leurs restent étrangers. Si tel est le cas, le sens de la Providence devrait leur être aussi étranger et leur croyance en la Providence, comme toutes les croyances, devrait s’effondrer dans les tempêtes de notre histoire. La foi en la Providence est la toute foi. C’est le courage de dire oui à sa vie, et à la vie en général, malgré les forces du destin, malgré l’insécurité de l’existence quotidienne, malgré les catastrophes de l’existence et l’effondrement du sens.
Paul parle de ce courage dans notre texte. Mais d’abord, il parle des puissances qui essayent de rendre ce courage impossible. Que font ces puissances ? Elles nous séparent de l’amour de Dieu. L’affirmation est surprenante. Nous insisterions plutôt sur les dangers de la souffrance et de la mort, qui menacent nos vies jours après jours. Paul, certes, ne les méconnaît pas. Il énumère : la détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, ou l’épée (7). Mais il se feel victorieux. C’est alors qu’il nomme les puissances qui menacent de nous séparer de l’amour de Dieu. Ces puissances ont quelque chose de mystérieux. Elles ne portent pas de noms épouvantables comme celles que Paul précédemment vient de nommer ; la plupart portent des noms glorieux : «anges», «principats», «vie» et «hauteurs». Pourquoi, sont-elles les plus menaçantes ? Parce qu’elles sont à l’œuvre dans nos vies à tout moment et qu’elles ont un double visage. Ce sont les puissances qui dirigent le monde, et elles le dirigent pour le bien et pour le mal. Elles nous saisissent par le bien qu’elles nous apportent et elles nous détruisent par le mal qu’elles recèlent. C’est ce qui les rend plus dangereuses que les maux évidents. Voilà pourquoi en triompher est le test ultime prouvant que Jésus est le Christ, celui qui apporte un nouvel état de choses.
Voyons quelle est leur nature, non pas comme celle de réalités étrangères, mais comme celle de force à l’œuvre dans notre être. Certaines portent le nom d’»ange» et de «principat». Ces deux noms désignent la même réalité ; une réalité qui n’a rien de commun avec le mignon chérubin ailé de l’imagerie populaire des anges. Ils désignent des réalités à la fois glorieuses et terribles, des réalités pleines de beauté et destructives. Quelles sont ces réalités ? Il n’est pas nécessaire de chercher loin pour les découvrir. Elles sont en nous tous, dans nos familles, dans notre nation, dans notre monde. À quel signe les reconnaît-on ? Au mélange de fascination et d’angoisse insurmontables qui les caractérise. Le nom d’une de ces puissances à la face angélique est l’amour. La poésie de toutes les langues loue abondamment ce principat qui gouverne la vie de tous les humains. Tableaux et statues montrent sa face angélique. Sa beauté angélique retentit dans la musique. Les figures des dieux et des déesses du Paganisme expriment sa fascinante divinité. En même temps, toutes les œuvres d’art et tous les mythes sont remplis des œuvres tragiques et mortifères de l’ange de l’amour. Ce grand souverain de nos vies unit la fascination et la crainte, la joie et la culpabilité, la création et la destruction. La joie et l’angoisse tendent ensemble à nous séparer de l’amour de Dieu, l’une en nous attirant loin de Dieu, l’autre en nous projetant dans les ténèbres d’un désespoir où voir Dieu n’est plus possible.
Un autre principat à la fois angélique et démonique est le «pouvoir». Il a la beauté mâle et sévère qu’on voit sur certaines peintures représentant le grand archange. C’est un grand ange, bon et mauvais et, comme l’amour, un puissant principat. C’est le constructeur et le protecteur des cités et des nations ; la force créatrice à l’œuvre en toute œuvre humaine, en toute communauté humaine, en toute réalisation humaine. Il est responsable de la conquête de la nature, de l’organisation des États, de l’administration de la justice. Sa puissance est alliée à celle d’une autre figure angélique bonne et mauvaise : la connaissance. Nous sommes tous sous leur férule. L’histoire du monde est le domaine où le règne de l’ange du pouvoir manifeste le plus sa gloire et son tragique. Que dire de plus aux gens de notre temps ? Chaque matin nous apporte des nouvelles de son gouvernement du monde ! Nous sommes fascinés par la créativité angélique et terrorisés par la destructivité démonique qu’il manifeste dans notre vie personnelle et dans celles des nations. Quand le pouvoir est allié avec la connaissance – une connaissance dont jamais on a rêvé auparavant dans l’histoire – la fascination et l’horreur grandissent infiniment. Ensemble, ils nous séparent de l’amour de Dieu, l’un nous pousse à l’adoration du pouvoir et de la connaissance, l’autre nous pousse au cynisme et au désespoir.
Paul mentionne encore deux autres paires de réalités capables de nous séparer de l’amour de Dieu : «la hauteur et la profondeur» et le «présent et l’avenir». Tout le monde comprend sans difficulté ce que cela signifie. Mais, il est difficile d’épuiser leur signification. La hauteur et la profondeur sont l’apogée et l’hypogée dans le mouvement des étoiles, les points où leur influence est la plus forte ou la plus faible, pour le bien ou le mal. La hauteur est le point où le processus de la vie atteint son maximum de vitalité, de réussite et de puissance, et la profondeur celui de sa plus faible réalisation, celui, peut-être, de sa fin. La hauteur et la profondeur sont des moments de victoire ou de défaite, de plénitude ou de vide, d’élévation ou de dépression, de fascination et d’angoisse. Toutes les deux, la hauteur autant que la profondeur, essayent de nous séparer de l’amour de Dieu ; toutes les deux rendent Dieu invisible.
«Les choses présentes et les choses à venir.» Les premières désignent l’impact sur nous du présent. Elles désignent la puissance séductrice du présent, notre refus de regarder en arrière ou en avant quand nous sommes sous l’emprise da la joie intense ou de la peine intense du moment présent. Les «choses à venir» désignent l’attente de la nouveauté, la joie de l’inattendu, le courage du risque. Mais, elles désignent aussi l’incommensurable, le contingent, et l’angoisse devant l’étrange et l’inconnu.
Achevons cette énumération avec la paire de puissance la plus redoutable, celle par laquelle Paul a commencé : «la Vie et la Mort». Ces deux puissances vont de pair. La mort est présente en toute vie. Elle travaille notre corps et notre âme, de notre conception à notre décomposition. Elle est autant présente au commencement de notre vie, qu’à sa fin. Nous avons commencé. Grandir c’est mourir, parce que la mort mine les conditions de la vie même dans sa croissance. Ne pas croître c’est la mort immédiate. Tous, nous nous tenons entre la fascination de la vie et l’angoisse de la mort, et parfois, entre l’angoisse de la vie et la fascination de la mort. La «Vie» et la «Mort» sont les deux puissances les plus grandes, les plus compréhensives, de toutes celles qui essayent de nous séparer de l’amour de Dieu.
Nous avons considéré les puissances qui gouvernent le monde sur lesquelles la foi en la Providence doit triompher. Quelle est cette foi ? Ce n’est, certainement, pas la croyance que tout aboutira à une heureuse fin ! Ce n’est pas non plus la croyance que tout marche d’après le plan préétabli d’un planificateur, qu’on appelle Dieu, la Nature ou le Destin. La vie n’est pas une machine bien construite par son fabricant fonctionnant avec les moyens et selon les lois de son mécanisme. La vie, personnelle et historique, est un processus créateur et destructeur, où la liberté et le destin, le hasard et la nécessité, la responsabilité et le tragique, s’entremêlent en tout et à tout moment. Ces tensions, ces ambiguïtés, ces conflits, font de la vie ce qu’elle est. Ils créent la fascination et l’horreur de la vie. Ils nous conduisent à poser la question du courage qui permet d’accepter la vie sans être vaincu par elle : c’est la question de la Providence.
Abandonnons maintenant le mot «providence» avec ses fausses connotations et cherchons ce qu’il veut dire réellement. Il désigne le courage d’accepter la vie sous l’influence de ce qui est plus que la vie. Paul l’appelle l’amour de Dieu. L’amour est au-dessus de la figure angélique et démonique dont nous avons parlé. L’amour est la puissance ultime de l’union, la victoire ultime sur la séparation. Être uni à l’amour rend capable de se maintenir au-dessus de la vie au sein même de la vie. Cela rend capable d’accepter les souverains bifaces de la vie, avec leur fascination et l’angoisse, leur gloire et leur horreur. Cela donne la certitude, qu’à tout moment, il est impossible que nous soyons empêchés d’atteindre l’accomplissement auquel aspire toute vie. C’est le courage d’accepter la vie par la puissance, où la vie est enracinée et surmontée.
Si, maintenant, on demande comment cela est possible, revenons à l’hymne de Paul. Nous y trouvons deux solutions. Il conclut sa liste des puissances, qui règnent sur le monde, par les mots suivants : …, ni aucune autre création. Les puissances du monde sont des créatures comme nous le sommes. Elles ne sont rien de plus que nous ; elles sont limitées. Nous sommes unis à ce qui n’est pas créature, au fondement créateur qu’aucune créature ne peut détruire. C’est ce qui nous permet de savoir que ces puissances ne peuvent détruire le sens de notre vie, même si elles peuvent détruire nos vies. Cela nous donne la certitude que dans la nature et dans l’histoire, aucune créature ne peut détruire le sens de la vie universelle dont nous sommes une parcelle, quand bien même la nature et l’histoire s’autodétruiraient demain. Aucune créature ne peut nous priver de ce courage ultime. Aucune ? Une, peut-être ! C’est nous-même ! Le courage de maintenir l’unité avec Dieu tient face aux puissances et aux principats, y compris face à la Vie et face la Mort. Mais, nous le perdons, quand la culpabilité nous sépare de l’amour de Dieu. Nous ne pouvons pas faire face à la mort, parce que l’aiguillon de la mort c’est le péché. Nous ne pouvons pas faire face à la vie, parce que la culpabilité mène à l’autodestruction tragique de la vie, et nous ne pouvons pas faire face à l’amour, parce que l’amour est rongé par la culpabilité. Nous fuyons le futur parce qu’il peut nous apporter les fruits de nos fautes passées. Nous ne pouvons nous reposer dans le présent, parce qu’il nous accuse et nous repousse. Nous ne pouvons pas supporter la hauteur, parce que nous avons peur de tomber. Nous ne pouvons pas supporter la profondeur, parce que nous nous sentons responsables de notre chute. Les souverainetés du monde ne peuvent accomplir ce qu’une conscience tourmentée peut accomplir : miner le courage d’accepter la vie. C’est pourquoi le message final de Paul est : la conscience de votre culpabilité ne peut vous séparer de l’amour de Dieu. Car l’amour de Dieu signifie que Dieu accepte celui qui sait qu’il est inacceptable. C’est le sens de la conclusion de Paul… en Jésus-Christ notre Seigneur. Il remporte la victoire sur ceux qui gouvernent le monde, parce qu’il est vainqueur dans nos cœurs. Son image nous donne la certitude que, même notre cœur, ses auto-accusations, et son désespoir, ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, unité ultime, source et fondement du courage d’accepter la vie.
Paul Tillich
Le sens de la providence, une prédication de Paul Tillich sur Romains 8, 38-39
Une foi paradoxale et audacieuse
Ces paroles très connues de Paul énoncent la foi chrétienne en la Providence. Elles sont la première interprétation de fond des paroles troublantes de l’évangile de Matthieu, où Jésus commande de n’avoir aucun souci au sujet de la vie, de la nourriture et du vêtement et de chercher premièrement le Royaume de Dieu, parce que Dieu connaît déjà notre vie quotidienne et tous nos besoins. Cette interprétation est nécessaire, car peu d’articles de la foi chrétienne, importants pour la vie quotidienne des hommes et des femmes, sont sujets à autant de malentendus et de déformations. Ces malentendus mènent inévitablement à une désillusion, qui, non seulement détourne de Dieu nos cœurs, mais aussi nous révolte contre lui, contre le Christianisme et contre la religion. Quand, entre les batailles de la dernière guerre, je parlais avec des soldats (2), ceux-ci exprimaient leur refus du message chrétien en attaquant la croyance en la Providence – des attaques dont l’âpreté provenait à l’évidence d’une déception fondamentale. Après avoir lu le texte où le grand Einstein combat la foi en un Dieu personnel, je suis parvenu à la conclusion qu’il n’y avait aucune différence entre son sentiment et celui de ces simples soldats. L’idée de Dieu semble impossible parce que la réalité de notre monde semble opposée à la toute puissance d’un Dieu juste et sage.
J’ai eu une fois l’occasion d’interpréter le caractère paradoxal du gouvernement divin du monde devant un groupe de réfugiés juifs et chrétiens. L’un d’eux, un Juif autrefois éminent en Allemagne de l’Est, me dit qu’il avait reçu de nombreux télégrammes de France du Sud l’informant de l’histoire épouvantable d’environs dix mille Juifs Sudètes, de quatre vingt dix ans, et plus, qui avaient été évacués en Allemagne et transportés dans les camps de concentration. Il dit que la pensée d’une misère aussi inimaginable l’empêchait de trouver un sens au message puissant concernant la Providence divine. Quelle réponse donner ? Quelle réponse pouvons-nous donner à un problème aussi crucial ; un problème où le Christianisme est en cause ; un problème qui n’a rien de commun avec la critique théorique de l’idée de Dieu, mais qui exprime surtout l’angoisse d’un cœur humain qui ne parvient plus à résister à la puissance engendrée sur terre par les forces démoniques?
Paul parle de ces forces. Il les connaît toutes : l’horreur de la mort et l’angoisse de la vie, la force irrésistible des puissances de la nature et de l’histoire, l’ambiguïté du présent et l’obscurité inscrutable du futur ; l’incommensurable retournement du destin de haut en bas et de bas en haut, et la destruction dans la nature de la créature par la créature. Il les connaissait toutes, autant que nous, qui les avons redécouvertes après l’époque brève au cours de laquelle la Providence et la réalité semblaient aller de soi. Mais, jamais ce n’est allé de soi et cela n’ira jamais de soi! La Providence est affaire de foi, de la foi la plus forte, la plus paradoxale, et la plus audacieuse. C’est seulement ainsi que la foi en la Providence a son sens et sa vérité.
Quel est son contenu ? Certainement pas la promesse vague qu’enfin tout ira pour le mieux avec l’aide de Dieu ! Beaucoup de choses ont une fin malheureuse ! Ce n’est pas non plus garder l’espérance en toute situation, car il y a des situations où l’espérance n’est plus possible. Ce n’est pas anticiper une période de l’histoire où la Providence divine sera démontrée par le bonheur et la bonté humaine. Jamais la Providence divine n’a été moins paradoxale que dans notre génération. Voici le contenu de la foi en la Providence : quand la pluie tombe du ciel, comme maintenant; quand la cruauté a la haute main sur les nations et les individus, comme maintenant ; quand la faim et la persécution poussent des millions de personnes de lieux en lieux, comme maintenant ; quand les prisons et les taudis dans le monde entier dégradent le corps et l’âme des hommes, comme maintenant ; alors, à ce moment précisément, nous pouvons nous vanter de ce que rien ne nous sépare de l’amour de Dieu. C’est en ce sens, et en ce sens seulement, que tout concourre au bien, au bien ultime, à l’amour éternel, au Royaume de Dieu. La foi en la Providence est la foi que rien ne peut nous empêcher d’atteindre le but ultime de notre vie. La Providence ne signifie pas que tout est prédéterminé d’après un plan, comme par une machine efficace. La Providence signifie qu’une indestructible possibilité créatrice et salvatrice est impliquée en toute situation. La Providence signifie que les forces démoniques et destructrices ne pourront jamais avoir en nous et dans notre monde la haute main sur nous et que le lien nous liant à l’accomplissement de l’amour ne sera pas ébranlé.
L’amour est apparu ; il a pris corps en Jésus-Christ, notre Seigneur. En ajoutant ces mots, Paul ne phrase pas, comme nous le faisons souvent quand nous les répétons. Il les prononce après avoir montré que seule l’incrédulité à l’égard de l’amour de Dieu, la défiance envers Dieu, la peur de sa colère, la haine de sa présence, l’idée que nous avons de lui comme d’un tyran nous condamnant, nous, notre péché et notre culpabilité, peut détruire notre foi en la Providence. Elle n’est pas détruite par la profondeur de la souffrance, mais par la séparation d’avec Dieu, La Providence et le pardon des péchés ne sont pas deux aspects distincts de la foi chrétienne : ils sont une seule et même chose : la certitude de parvenir à la vie éternelle en dépit de la souffrance et du péché. Paul les réunit en disant: qui accusera ceux que Dieu a choisit ? Jésus-Christ… intercède pour nous (3). Et il poursuit en affirmant : Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l’épée ?… Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimé. La foi en la Providence ; c’est cela !
Paul Tillich
Les prédications de Paul Tillich sur ce site :
- Paul Tillich : 4 Prédications sur le sens de l’existence et l’Être nouveau
- Paul Tillich : 3 prédications pour trouver la Joie et le Sens dans la Profondeur de l’Existence
- Paul Tillich : 3 Prédications sur le Mystère du Temps et la Signification de l’Éternel Maintenant
- Paul Tillich : 5 Prédications sur Romains 8 pour une spiritualité de l’être
Notes :
- Alain Badiou, Saint Paul, p.1. Presses universitaires de France, 1997.
- Paul Tillich était aumônier militaire pendant la Première Guerre mondiale, notamment dans les lignes allemandes devant Verdun. Cf. Documents biographiques p. 130 à 142. (Labor et Fides 2002)
- Romains 8, 32-35.
- Les Etats-Unis.
- 1945-1955
- wishful thinking ! Prendre ses désirs pour des réalités.
- Romains 8, 35.
- Actes 17, 28. NTS
- 1 Corinthiens 13.
- Actes 2, 1-13.